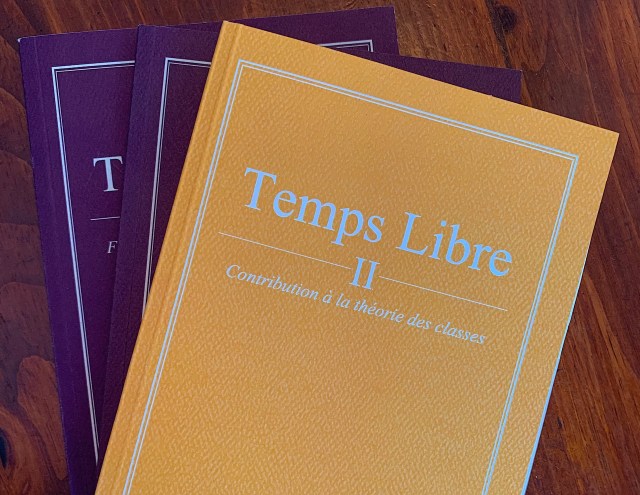Temps Libre III – Portrait d’une société de classes : le Québec peut désormais être téléchargé sur la page dédiée de notre site ou ici même :
Retour sur une fuite en avant : Théorie Communiste face à la question des classes sociales

Ce texte de réponse paraît pratiquement trois ans après les critiques formulées dans le vingt-septième numéro de la revue Théorie Communiste (TC) à l’encontre des thèses défendues dans Temps Libre no 2. Plutôt que de chercher à répondre à ces critiques de façon exhaustive, il nous a semblé plus pertinent de nous confronter directement aux développements théoriques positifs de TC no 27. En ce sens, le texte qui suit s’organise autour de la problématisation des idées centrales développées dans ce dernier numéro : le « passage à la vie quotidienne », la priorité accordée aux apparences et la mise au second plan du mouvement réel et, enfin, le prolétariat pensé comme un « moment » de la classe ouvrière. À travers cette discussion, ce texte se veut l’occasion de dénouer certains nœuds théoriques qui, s’ils ont été tenus à l’écart du troisième numéro de Temps Libre, méritent néanmoins d’être traités pour eux-mêmes. Ou autrement dit, abstraction faite du sentiment de devoir rendre hommage à l’énergie que TC a déployée pour nous répondre, c’est la volonté de faire progresser la théorie communiste des classes, en nous attaquant à ce qui la retient en arrière, qui nous pousse à revenir sur ces différents éléments.
Et ce qui pose problème dans la manière dont nos camarades pensent les classes sociales, c’est précisément l’idée, exprimée de cent façons différentes, qu’il n’est ni possible ni même pertinent de connaître ces classes en tant que groupes de la société empiriquement observables. Refusant la position selon laquelle la place occupée dans les rapports de production et de subordination puisse déterminer de façon suffisamment claire l’appartenance de classe, et ce, sous prétexte que ces rapports se métamorphosent nécessairement en « formes d’apparition », que cela « change tout » et que les choses sont toujours « plus compliquées » que ce qu’en dit Temps Libre, TC n’a pas le choix de se rabattre sur une approche strictement intuitive des classes. Inaccessibles à la connaissance autrement que sous la forme de généralités abstraites, les classes réelles deviennent quelque de chose de nébuleux, d’insaisissable. Or, inutile d’insister sur le fait que la défense, même sophistiquée, de ce genre de position nuit sérieusement au travail de clarification censé être au centre de toute entreprise théorique. C’est un constat identique, quant au fond, à celui que nous faisions dès la rédaction de Temps Libre no 2, lorsque nous avons été amené·es à évaluer les contributions de TC à propos de la définition du prolétariat et des classes moyennes.
Ces contributions avaient pourtant le double mérite de poser les termes du problème qui s’impose à la théorie communiste des classes et d’y apporter une réponse minimale : comment rendre compte, de façon matérialiste, non seulement de la division de la société en groupes antagonistes, mais également de la possibilité que cette société soit dépassée grâce à l’action révolutionnaire de l’un de ces groupes, le prolétariat? Ou encore, comment tenir ensemble l’appréhension de la situation objective d’une classe dans la reproduction de la société capitaliste et celle de sa capacité à communiser cette même société? En mettant l’accent sur l’activité propre du prolétariat – le travail productif –, sur le fait que cette classe est contrainte de produire de la plus-value pour le compte du capital et que c’est donc elle qui reproduit le capital lui-même et, partant, les éléments les plus déterminants de la totalité capitaliste, TC offrait la clé d’une compréhension plus profonde non seulement de ce qui définit réellement le prolétariat, mais aussi, par le fait même, de ce qui est définitoire de toutes les classes du mode de production capitaliste. En plaçant l’activité spécifique du prolétariat plutôt que son statut de non-propriétaire au centre de sa saisie théorique, on parvenait beaucoup plus facilement à penser ce qui fait de lui une classe révolutionnaire, à savoir : le fait qu’il est immédiatement en relation d’antagonisme avec le capital, que ses luttes « réalisent » la contradiction en laquelle consiste le capital et, surtout, qu’il a précisément la capacité de s’attaquer au capital dans son objectivité sociale et matérielle. Si tout cela n’est pas aussi explicite chez TC, on retrouve de nombreux éléments qui concourent à transformer positivement la façon d’appréhender les classes du mode de production capitaliste.
Néanmoins, nous jugions que d’importantes imprécisions et ambiguïtés plombaient l’élément novateur de leurs contributions. D’un côté, le rapport du prolétariat à la distinction travail productif/travail improductif demeurait mystérieux : censé « fonder » le prolétariat, le travail productif semblait parfois essentiel à la définition du prolétariat, parfois parfaitement contingent – impossible de savoir, donc, si le travail productif devait fonctionner comme un critère discriminant de l’appartenance de classe. De l’autre côté, le fait que le prolétariat soit défini par son rapport contradictoire au capital demeurait lui aussi ouvert à l’interprétation : cela signifie-t-il qu’il faut être directement exploité·e par le capital et lutter sur cette base pour être en contradiction avec lui ou, au contraire, est-il suffisant de s’attaquer à celui-ci pour être membre du prolétariat? Or, selon que l’on opte pour l’une ou l’autre de ces réponses concurrentes, l’extension du prolétariat et celle, corollaire, des classes moyennes, se voient dramatiquement affectées : le prolétariat peut alors tout aussi bien composer le cinquième de la population d’une société donnée que ses neuf dixièmes.
Toujours est-il que ce flou quant à la délimitation des différentes classes est inacceptable et c’est précisément pour résoudre ce problème que nous avons jugé nécessaire de situer clairement les différentes classes par rapport, d’une part, à l’effectuation d’un travail productif et, d’autre part, à l’occupation d’une place subordonnée au sein des rapports de subordination politico-idéologique. Ces deux grands axes permettent de circonscrire les agents qui entrent non seulement dans le rapport d’exploitation fondamental du mode de production capitaliste, mais également ceux qui, parmi eux, y entrent en tant qu’agents subordonnés, c’est-à-dire ceux qui entretiennent un rapport d’antagonisme franc avec la structure sociale existante et qui sont à même de la renverser. En opposition à une tradition communiste vieille de cent cinquante ans et encore bien tenace, il nous fallait marquer nettement et simplement que seuls ces agents peuvent être tenus pour des membres actifs du prolétariat1.
En ce sens, avec la critique de Théorie Communiste que nous avons incluse dans notre deuxième numéro, il s’agissait en quelque sorte de mettre en demeure nos camarades de clarifier leur pensée et de répondre franchement à la question : quelles conditions doivent être réunies pour qu’on puisse affirmer qu’un agent fait partie de telle ou telle classe? Qui sont réellement les prolétaires, les membres des classes moyennes, de la classe capitaliste? Comment TC peut savoir, en analysant une lutte concrète, qui appartient effectivement au prolétariat? Mais comme nous le verrons, plutôt que de tenter d’apporter une réponse à ces questions, nos camarades, en montrant comment les déterminants objectifs des classes sont en réalité solubles dans l’expérience vécue des individus, ont choisi de dépenser une grande quantité d’énergie à prouver l’impossibilité de connaître la composition concrète des différentes classes. Par cette fuite en avant dans le brouillard de la « vie quotidienne », TC a non seulement continué de se satisfaire de sa connaissance approximative des classes existantes, mais elle a également fait s’évanouir à peu près tout ce qui, dans sa propre théorie, aurait pu l’aider à en rendre compte.
1. Vie quotidienne, apparence et mouvement réel
1.1. La vie quotidienne : éléments de définition
Avant de présenter de quelle façon TC invoque la vie quotidienne afin d’éviter d’avoir à tenir compte des rapports de production et de subordination dans la détermination de l’appartenance de classe, il faut s’arrêter sur la notion de vie quotidienne elle-même. Cette dernière est définie à plusieurs reprises dans TC no 27 et ses occurrences ne sont pas toujours équivalentes, loin de là. Comme elle joue un rôle central dans les raisonnements de nos camarades, il faut tenter de saisir ce qu’il faut entendre par là. Pour TC,
La vie quotidienne est alors le lieu où se nouent toutes les instances de la reproduction, mais aussi le lieu où toutes ces instances ne se présentent pas dans leur hiérarchie théorique et déterminative entre la «base économique» et les «superstructures». Les « surdéterminations » sont la chair de la vie quotidienne2.
Cette façon de comprendre la vie quotidienne est en réalité ambiguë, car elle fait intervenir deux idées concurrentes qui sont tout simplement juxtaposées : dans la première partie de la phrase, la vie quotidienne est définie de façon « spatiale », comme une sphère particulière de la réalité sociale, tandis que dans le reste de la citation, elle est rapportée à une forme de conscience, à un type d’expérience de la réalité.
Ainsi, en écrivant qu’il s’agit du « lieu où se nouent toutes les instances de la reproduction », TC suggère d’abord que la vie quotidienne appartient, du point de vue des pratiques qu’elle recouvre, au même « côté » de la réalité sociale que les sphères ayant pour fonction d’assurer la continuité de la production capitaliste : sphères de la famille, du droit, de la religion, etc. Si la vie quotidienne est « le lieu où se nouent toutes les instances de la reproduction », c’est donc que les instances qu’elle recouvre s’opposent à celle de la production, c’est-à-dire à l’élément décisif de la détermination de la totalité sociale3. Cette idée est exprimée encore plus clairement un peu plus loin :
L’économie (forme transformée/objectivée des rapports de production) est le concept général de l’autonomisation de toutes les conditions de la production et de la reproduction, l’économie n’existe alors qu’en relation et possédant son corollaire (son autre), la vie quotidienne4.
Autrement dit, la « chair de la vie quotidienne», c’est ce qui a lieu à l’extérieur de « son autre », « l’économie» ; c’est l’école, les loisirs, le magasinage, les élections municipales, le souper en famille, le litige avec son voisin, le lavage, l’assemblée générale étudiante, etc. Ce sont, comme le dit TC, les innombrables « surdéterminations » qui, par toutes sortes de détours, finissent par conditionner l’exploitation capitaliste. C’est à cette acception de la vie quotidienne qu’on réfère implicitement lorsqu’on énonce que les luttes, depuis la restructuration, ont changé de terrain et se placent désormais sur celui de la vie quotidienne.
Or, c’est tout autre chose de penser la vie quotidienne comme la forme inversée ou mystifiée sous laquelle se présente, dans la conscience, la réalité sociale. C’est pourtant ces deux idées que TC tente de faire passer pour équivalentes. On l’a vu, pour TC, la vie quotidienne est aussi ce « lieu où toutes [les instances de la reproduction] ne se présentent pas dans leur hiérarchie théorique et déterminative entre la “base économique” et les “superstructures” ». Plutôt que ce soit la superstructure qui apparaisse comme l’élément déterminé et la base économique, comme l’élément déterminant, c’est l’inverse qui semble être le cas dès lors que les agents évoluent dans la « quotidienneté » :
Le monde familier, quotidien, c’est la métamorphose nécessaire des rapports de production en formes d’apparition, la marchandise et son fétichisme, la subsomption du travail sous le capital, les rapports de distribution, l’autoprésupposition du capital, l’idéologie sous laquelle opèrent toutes les pratiques, elle inclut les différences du quotidien, de vécu comme sujet, entre les hommes et les femmes, entres les classes. C’est sous les formes ultimes, les plus médiatisées, sous des formes où à la fois la médiation non seulement est devenue invisible, mais où s’exprime leur contraire direct, que les figures du capital apparaissent comme les agents réels et les supports immédiats de la production et qu’ils affrontent5.
La vie quotidienne apparaît ainsi comme une modalité de l’expérience de la réalité capitaliste. Vivre « quotidiennement », faire l’expérience de la vie quotidienne, c’est baigner dans la confusion, dans l’idéologie, dans le monde des apparences, dans la fausse conscience. C’est prendre ce qui surdétermine6 le rapport social capitaliste pour le décisif, c’est prendre le secondaire pour le principal. En ce sens, la vie quotidienne n’est plus circonscrite à une sphère particulière de la réalité sociale, il s’agit de cette réalité elle-même, mais telle qu’elle est vécue par « le travailleur » :
Nous appellerons vie quotidienne l’ensemble des activités par lesquelles le travailleur se met en relation, de façon régulière et prévisible, avec ses conditions aussi bien de travail (les moyens de production) que de consommation, à partir du moment où ces activités ne sont plus présupposées par l’appartenance préalable du travailleur à une communauté et où le travail n’est plus, pour le travailleur, qu’une activité particulière dans la division du travail [?] et isolée de ses forces sociales, sans présupposition et toujours à renouveler. La vie quotidienne est la routine de cette mise en relation en ce qu’elle est constituée par l’ensemble des formes d’apparition des rapports de production comme vécu par l’activité d’un sujet7.
La vie quotidienne renvoie par conséquent à la façon dont « le travailleur » fait l’expérience de sa propre vie dans un contexte d’atomisation sociale qui, par le fait même, échoue à produire chez lui un quelconque sentiment d’appartenance. Sa participation au procès de la production sociale devient une activité contingente, non définitoire de son identité. Ce n’est plus d’abord en tant qu’ouvrier·ères, en tant que membre d’une classe clairement identifiable, que les travailleur·ses subordonné·es se rapportent au capital et se conçoivent eux et elles-mêmes. C’est dans cet espace laissé plus ou moins vacant que se loge, à en croire TC, la vie quotidienne.
Remarquons au passage que cette spécification, celle qui lie la vie quotidienne à l’affaiblissement de l’identité ouvrière, n’est pas anodine. Si ce n’est qu’à partir des années 1980 que cette dernière cesse d’être reproduite et qu’elle se met à péricliter, si c’est seulement à partir de ces années-là que « l’appartenance préalable du travailleur à une communauté » commence réellement à faire problème, cela veut-il dire que la vie quotidienne n’a que quarante ans? Cela implique-t-il qu’auparavant, les rapports de production et leurs « formes d’apparition » apparaissaient en clair? Le travailleur a-t-il commencé à avoir un « vécu » depuis quarante ans seulement? A-t-il fallu attendre plusieurs siècles de capitalisme pour que les travailleur·ses deviennent enfin des « sujets »? Autant de questions laissées sans réponses réelles, mais qui sont de toute façon d’un intérêt secondaire pour une théorie des classes.
1.2. Sur le « passage à la vie quotidienne »
Dans l’avant-propos du numéro considéré, nous trouvons une définition de la notion de « vie quotidienne » qui reprend presque à l’identique celle présentée à la page 29 :
La vie quotidienne est devenue [nos italiques, ndr] le lieu où se nouent toutes les instances de la reproduction, mais aussi le lieu où toutes ces instances ne se présentent pas dans leur hiérarchie théorique et déterminative entre la « base économique » et les « superstructures »8.
La différence peut paraître anodine, mais elle joue un rôle important pour les thèses défendues dans le numéro. En effet, dans l’avant-propos, la vie quotidienne n’est pas seulement « ce lieu où se nouent toutes les instances de la reproduction », elle « est devenue ce lieu où se nouent toutes les instances de la reproduction ». La formulation de l’avant-propos rend explicite le caractère historique de la vie quotidienne et montre qu’elle acquiert une importance nouvelle avec la restructuration néolibérale. C’est que pour TC, la restructuration bouleverse la hiérarchie entre vie quotidienne et production : « avant les années 1970, les conditions de vie jouaient leur rôle dans les luttes ouvrières, mais elles étaient comme incluses dans les conditions de travail9 », alors que, désormais, « c’est la vie quotidienne, avec toute sa confusion et ses aléas qui est destinée, dans la situation présente, à être l’élément subsumant la distinction [?] dans une jonction qui ne laissera aucun de ses termes identiques à ce qu’il était10 ». De « déterminations en conséquence11 » de la sphère de la production, les éléments appartenant à la vie quotidienne sont devenus centraux : « la vie quotidienne est devenue le lieu et l’enjeu des luttes des classes dans toute leur complexité, leur confusion, à la fois le problème, limite et dynamique de leur possible dépassement12 ».
Ce diagnostic énonce une vérité indubitable : personne ne peut nier le déplacement du centre de gravité des luttes opposant le prolétariat à la classe capitaliste. Les luttes sur les lieux de travail ont perdu la centralité qu’elles avaient dans le cycle de luttes précédent, précisément parce que les conditions ne sont plus réunies, depuis la fin des années 1970, pour que des gains substantiels puissent être obtenus sur ce terrain. Prenons le cas du Québec. D’un côté, les syndicats ont été acculés à la défensive par les menaces de délocalisation et de fermeture d’entreprises13 et, de l’autre, on a assisté à un recours quasi systématique à des lois spéciales forçant le retour au travail, ainsi qu’à la mise en place de dispositifs légaux rendant les débrayages tout à fait inoffensifs, voire simplement impossibles14. Dans un tel contexte de désarmement politico-idéologique et de défaites prolétariennes répétées, il est évident que les revendications liées à la vie quotidienne (coût des principaux produits de consommation, préservation des acquis de l’État providence-national, etc.) apparaissent beaucoup plus mobilisatrices : pourquoi lutter dans un syndicat dont la marge de manœuvre est inexistante, débrayer, avoir recours aux tribunaux, etc., si l’on sait que ces formes de lutte aboutissent tout au plus à la préservation d’un pouvoir d’achat déjà mis à mal par l’inflation? En comparaison, les luttes contre la cherté de la vie, dans tout ce qu’elles ont d’incontrôlable et d’explosif, apparaissent d’autant plus pertinentes à mener que leur dénouement amer n’est pas écrit d’avance. De ce point de vue, il faut donner raison à TC.
Par contre, la façon dont ce « passage à la vie quotidienne » est expliqué pose certains problèmes, desquels il faut dire quelques mots. Pour TC, deux éléments ont joué un rôle crucial dans l’importance qu’a prise la vie quotidienne comme champ de la lutte des classes depuis la restructuration : d’abord, la déconnexion récente entre valorisation du capital et reproduction de la force de travail15 et, ensuite, le fait que les crises se présentent, depuis celle de 2008, comme étant identiquement des crises de suraccumulation et de sous-consommation16.
1.2.1 La double déconnexion entre valorisation du capital et reproduction de la force de travail
Quant au premier élément, TC juge que depuis la restructuration, la valorisation s’opèrerait à l’échelle mondiale de façon plus ou moins homogène, tandis que la reproduction de la force de travail se ferait de façon hautement segmentée, à travers des zones distinctes17. Auparavant, il aurait été possible de parler d’une classe ouvrière nationale plus ou moins homogène, dont le salaire aurait été plus ou moins en rapport avec la valeur produite, tandis qu’aujourd’hui (depuis la restructuration), la rémunération de la force de travail sur un point de la carte n’entretiendrait plus de lien avec la valeur effectivement produite sur ce même point. Exprimé un peu vite, cela revient à dire que la force de travail des second et tiers mondes contribuerait autant que celle du premier monde à valoriser le capital, mais que la première ne serait reproduite qu’avec peine, tandis que celle des zones privilégiées serait (relativement) bien payée. Ce qui a lieu à l’échelle de l’économie mondiale aurait en fait lieu, comme en une « mise en abyme », à l’intérieur des économies nationales, accroissant par le fait même la déstructuration de ces dernières et brisant la « cohérence » qu’elles avaient jusque-là.
S’il est certain que la reproduction de la force de travail se fait de façon segmentée, que ce soit à l’échelle internationale ou même nationale, il est douteux que la valorisation, elle, se fasse de façon homogène, comme le prétend pourtant TC. Des auteurs comme Samir Amin18 et Christian Palloix19 sont justement parvenus, chacun par des voies différentes, à la conclusion que la valorisation du capital, à l’échelle mondiale, est précisément hautement hétérogène, en ce sens qu’il s’opère un transfert de valeurs des économies des périphéries vers celles du centre. Pour ces auteurs, la faiblesse de la rémunération de la force de travail des économies périphériques reflète justement la faiblesse de la valorisation qui s’y opère. Bien loin d’être déconnectées, valorisation et reproduction de la force de travail ont toujours été et restent intimement liées – d’où la nécessité, selon Amin, pour les économies dominées de se « déconnecter » elles-mêmes des rapports de dépendance qu’elles entretiennent avec les économies centrales. En effet, c’est seulement ainsi qu’elles peuvent mettre fin aux désavantages de l’hétérogénéité de la valorisation. Les modèles d’affaires d’entreprises telles que Nike, Zara, Apple, etc. sont des exemples extrêmes de segmentation du procès de valorisation : alors que la production matérielle peu valorisante est sous-traitée à des entreprises tierces qui ne font qu’exécuter les commandes que leur passent les designers des grandes villes nord-américaines, les entreprises mères se réservent les activités au sein desquelles la plus grande part de la valeur est ajoutée20. Et cette segmentation de la valorisation a tout aussi bien lieu dans l’industrie lourde, segmentation dont la sidérurgie et l’industrie automobile sont des exemples paradigmatiques.
Mais admettons, pour le besoin de la cause, qu’il serait légitime de parler de déconnexion entre, d’un côté, valorisation homogène du capital et, de l’autre, reproduction hétérogène de la force de travail. Pour que le raisonnement de TC tienne, il faudrait réussir à prouver que non seulement cette déconnexion est plus forte dans le présent cycle d’accumulation que dans le précédent, mais également, qu’il s’est produit un changement qualitatif nous autorisant à parler d’une déconnexion. Autrement dit, il ne suffit pas de montrer que les inégalités salariales ont augmenté entre pays riches et pays pauvres, entre centres d’accumulation et « poubelles » sociales (ce qui est certainement le cas), il faut montrer qu’elles ont séparé deux termes autrefois connectés. Or, il suffit d’ouvrir un seul ouvrage traitant du rapport entre colonialisme et capitalisme pour s’apercevoir que ces asymétries n’ont rien de nouveau et que les prolétaires des zones périphériques sont, probablement depuis l’émergence du mode de production capitaliste, beaucoup plus faiblement rémunéré·es que leurs homologues des zones centrales. Cette « déconnexion » ne peut donc absolument pas être invoquée pour expliquer le « passage à la vie quotidienne ».
1.2.2. La crise de 2008 comme identité entre crise de suraccumulation et crise de sous-consommation
Attardons-nous maintenant au second élément expliquant, selon TC, la prééminence de la vie quotidienne au sein des sociétés capitalistes actuelles, à savoir l’identité advenue entre crise de suraccumulation et crise de sous-consommation. L’étrangeté de cette thèse nous oblige à prendre un pas de recul et à rappeler à quoi renvoient ces notions. Car de fait, contrairement à ce que TC avance, ce qui s’oppose, ce ne sont pas deux types de crises du mode de production capitaliste, ce sont bien plutôt deux explications concurrentes des crises.
D’un côté, nous trouvons la variante sous-consommationniste, la plus répandue, celle qui explique la crise par l’incapacité des agents de consommer la totalité de ce qui est produit, étant donné la faiblesse relative de leurs revenus. La crise éclate, parce qu’on a produit une trop grande masse de valeurs par rapport aux revenus effectivement distribués, ce qui empêche la valeur produite d’être entièrement réalisée et avec elle, la reprise d’un nouveau cycle productif. La crise est en ce sens essentiellement pensée comme un problème de réalisation. Si les revenus manquants existaient, l’accumulation aurait pu reprendre son cours.
De l’autre côté, la variante faisant intervenir la suraccumulation explique la crise par le fait que trop de capital, notamment sous forme de moyens de production, a été immobilisé pour permettre une exploitation du prolétariat qui en vaille la peine. Parce que les entreprises, ayant étendu l’échelle de la production, ont désormais cruellement besoin des prolétaires pour les exploiter et que ces dernier·ères sont en position de refuser une réduction de leur salaire nominal, les investissements en capital constant destinés à accroître la productivité du travail et, par là, le taux d’exploitation, se révèlent stériles et contribuent à la diminution du taux de profit. Produire la même masse de plus-value coûte donc plus cher qu’auparavant. La crise éclate lorsque suffisamment de capitalistes jugent que le taux de profit effectif ou escompté est si bas qu’il est préférable de diminuer, voire de stopper la production. Par conséquent, selon cette dernière explication, ce qui fait enrailler le procès de reproduction du capital, ce n’est donc pas une trop grande production de plus-value matérialisée dans des marchandises invendables, c’est la pénurie de plus-value, laquelle décourage les capitalistes de continuer à produire et engendre nécessairement un problème de réalisation.
Revenons à TC. Avec la crise de 2008, nous dit-on, ces deux explications concurrentes auraient non seulement cessé d’être concurrentes, mais il serait également devenu nécessaire de les faire toutes deux intervenir pour rendre compte des crises à venir. Pourquoi? Parce que la crise serait elle-même devenue identiquement crise de suraccumulation et crise de sous-consommation. Nous nous attarderons longuement sur ce point, mais pour l’instant, l’important à garder en tête est que cette cette identité récente aurait eu pour résultat de placer la faiblesse de revenu au centre de la contradiction prolétariat-capital. Parce qu’il ne s’agit plus seulement d’une crise de suraccumulation et d’un problème de valorisation – lesquels renvoient directement à la capacité du capital à exploiter le prolétariat à un degré suffisant, donc à un problème de production –, mais aussi d’une crise de sous-consommation, la question du revenu aurait acquis une importance autrement plus forte. La crise de 2008, « qui a éclaté parce que des prolétaires n’ont pas pu payer leurs crédits21 », est devenue une « crise de la société salariale et de la légitimité de l’État. C’est ainsi que, dans la confusion, elle s’ouvre à la vie quotidienne22 ». Puisqu’il s’agit d’une crise affectant d’abord la reproduction du rapport prolétariat-capital (les prolétaires sont trop pauvres, donc le capital ne peut vendre et se reproduire), ce sont les sphères de la vie sociale apparentées à celle de la reproduction qui deviennent décisives. D’où le passage à la vie quotidienne.
Ce raisonnement plus qu’approximatif ne nous intéresse pas tant pour lui-même que dans la mesure où il fait intervenir une théorie des crises hautement critiquable. Pour traiter de celle-ci, il nous faut revenir à leur vingt-deuxième numéro, duquel les thèses principales quant à la caractérisation de la crise sont reprises. Dans ce numéro, TC essaie de montrer que bien qu’il faille « partir » d’une théorie de la suraccumulation pour expliquer les crises, l’explication par la sous-consommation n’en finit pas moins par être identique à celle de la suraccumulation (celle « fondée sur la baisse tendancielle du taux de profit23 », selon des termes que TC juge, à tort, interchangeables). Il n’y aurait donc non seulement aucune raison particulière de rejeter l’explication sous-consommationniste, mais il faudrait la faire intervenir pour expliquer l’importance prise par la vie quotidienne.
Mais d’abord, pourquoi peut-on être d’avis qu’il faut préférer l’explication par la suraccumulation à celle par la sous-consommation? Pour des auteurs tels que Paul Mattick, la faiblesse intrinsèque des explications sous-consommationistes, c’est qu’elles se focalisent sur l’aspect le plus superficiel des crises – la mévente –, sans voir que le problème de réalisation qu’elles décrivent s’explique lui-même par l’incapacité du capital à se valoriser suffisamment24. Par ailleurs, les tenants de l’explication par la suraccumulation n’affirment pas qu’il n’y a pas d’enjeu de réalisation, mais bien que ce dernier résulte de la perturbation de la reproduction du capital consécutive à l’interruption de l’accumulation. Ce qui est confondant, c’est que les crises prennent toujours la double apparence d’une crise de réalisation et d’une crise monétaire : la crise devient précisément patente lorsque les marchandises restent invendues et lorsque les vendeurs ne peuvent donc ni payer leurs factures, ni satisfaire leurs obligations financières. Or, le problème fondamental vient du fait que la production n’était plus rentable compte tenu de la masse de capital investi – ce qui a entraîné la réduction de la production, la fermeture d’usines, le chômage et, inévitablement, une crise de réalisation encore plus importante (la demande solvable n’existe plus pour pouvoir réaliser toute la valeur contenue dans les marchandises attendant d’être vendues) et une crise monétaire (plus personne ne prête, tout le monde fait des réserves de liquidités, le crédit se rétrécit, les défauts de paiement s’enchaînent, etc.). La difficulté, encore une fois, c’est que les mêmes phénomènes traduisent des causes qui ne peuvent être confondues. C’est pourquoi il faut s’attarder attentivement aux types de causalité manifestés par ces phénomènes. Pour l’explication de la crise par la suraccumulation, donc pensée comme une crise de valorisation, trois grands cas de figure se présentent, qui peuvent naturellement se combiner dans la pratique :
1) Accumulation → augmentation de la demande de forces de travail → hausse des salaires → diminution du taux d’exploitation (pour une composition organique inchangée) → baisse de rentabilité (taux de profit diminué) → ralentissement/fermeture d’entreprises → chômage → diminution de la demande solvable → problème de réalisation pour les entreprises en activité → problème de liquidité → défaut de paiement → ralentissement/fermeture d’entreprises → etc.
2) Accumulation → augmentation de la demande en matières premières/auxiliaires → hausse du prix de ces mêmes matières → hausse de la composition organique (pour un taux d’exploitation inchangé) → baisse de rentabilité (taux de profit diminué) → idem.25
3) Accumulation → investissement productif → hausse de la composition organique (pour un taux d’exploitation inchangé) → baisse de rentabilité (taux de profit diminué) → idem.
Dans le premier cas, c’est le taux d’exploitation qui fait diminuer le taux de profit, tandis que dans les deux seconds, c’est la hausse de la composition organique. Pour que le taux de profit diminue effectivement, il suffit que le taux d’exploitation diminue plus vite que la composition organique ou, au contraire, que l’augmentation de la composition organique soit plus rapide que celle du taux d’exploitation. Ce qui est en jeu, c’est chaque fois la rentabilité de la production. Dans une explication sous-consommationniste maintenant, la faiblesse de la rentabilité n’intervient jamais en tant que cause de la crise. Ce qui explique la crise, c’est toujours la faiblesse du pouvoir d’achat des consommateur·rices, laquelle empêche que la totalité de la valeur du capital-marchandise (et donc la plus-value qu’il recèle ) soit réalisée :
Accumulation → distribution limitée de revenus → incapacité de vendre → problème de liquidité → défaut de paiement → ralentissement/fermeture d’entreprises → problème de réalisation pour les entreprises qui vendaient à celles qui ont fermé → etc.
On peut certes expliquer, comme Marx le fait lui-même, la faiblesse du pouvoir d’achat par l’exploitation capitaliste elle-même : c’est précisément parce qu’une part importante de la société est exploitée que sa capacité à consommer est limitée. Ne fait-on pas ainsi le pont entre les deux explications? Non. Car, ce faisant, on dit que la production capitaliste entre en crise parce qu’elle exploite trop bien, parce qu’elle crée plus de valeur et de plus-value que ce qu’elle peut effectivement réaliser, là où l’explication par la suraccumulation énonce précisément qu’il existe une pénurie de plus-value eu égard à la masse de capital à valoriser. Et c’est là que gît l’opposition entre les deux explications. Dans un cas, la solution consiste à transformer les conditions de production pour favoriser une extraction accrue de plus-value, dans l’autre, la solution consiste à trouver des débouchés ou à en créer par l’endettement ou le crédit.
Il faut concéder à TC que, chez Marx, ces deux explications concurrentes coexistent et sont fréquemment accolées comme si l’explication par la sous-consommation ne faisait que traduire ou exprimer différemment celle par la suraccumulation. Toujours est-il que TC semble juger que ces juxtapositions sont une invitation à persévérer en ce sens et à montrer en quoi l’une et l’autre de ces explications aboutissent, une fois bien comprises, à une seule et même explication. Qu’en prouvant ainsi leur identité essentielle, TC sape son propre raisonnement – à savoir que c’est la crise de 2008 qui pose la première fois l’identité entre suraccumulation et sous-consommation et qui fonde ainsi le passage à la vie quotidienne –, cela ne semble pas trop leur poser problème.
Attardons-nous maintenant à la démonstration que fait TC de l’identité entre suraccumulation et sous-consommation, que nous traiterons segment par segment :
[1] Le but de la production capitaliste est, avec une masse de richesse donnée, de rendre le surproduit ou la plus-value les plus grands possible. Ce but est atteint par une croissance du capital constant relativement plus rapide que celle du capital variable, ou par la mise en œuvre du plus grand capital constant possible avec le plus petit capital variable possible. [2] La même cause (la recherche de la plus grande plus-value possible) produit la croissance de la masse du profit et la baisse de son taux par la diminution du fonds d’où les ouvriers tirent leur revenu. [3] Dans la reproduction du capital, cette diminution devient la cause qui entrave la conversion des marchandises en nouveaux moyens d’accroître l’exploitation du travail. Prise dans ce sens, la relation entre surproduction et suraccumulation devient : c’est parce que le fonds de consommation des ouvriers est constamment réduit vis-à-vis de la masse de la production, donc à partir de la sous-consommation que l’on parvient à la surproduction de capital, c’est-à-dire à l’impossibilité de renouveler l’exploitation du travail de façon efficace. Il ne s’agit pas, dans le passage entre surproduction et suraccumulation, de la possibilité d’un renversement de causalité, car il n’y a pas de rapport de causalité entre les deux termes, il s’agit [d’un] même phénomène sous deux aspects différents, chacun des deux permettant de trouver l’autre26.
Avec [1], nous avons déjà affaire à une fausseté criante. Premièrement, ce n’est pas du tout l’augmentation de la composition organique du capital (la « croissance du capital constant relativement plus rapide que celle du capital variable ») qui permet d’atteindre le but dont parle TC, à savoir celui de produire, avec une masse de valeur donnée, la plus grande masse de plus-value possible. L’augmentation de la composition organique n’est absolument pas un « moyen » pour les capitalistes d’augmenter la masse de plus-value produite pour une masse de capital donnée. Outre la diminution du temps de rotation du capital, le seul moyen grâce auquel ils peuvent y parvenir – en supposant constante la valeur des éléments du capital qui étaient mobilisés jusque-là27 –, c’est par l’augmentation de la productivité, par l’introduction de moyens de production plus performants. Or, c’est en voulant accroître la productivité que les capitalistes sont amenés à investir dans du capital constant plus performant et donc, à faire croître la composition technique de leur capital. Cette croissance, n’intéressant d’abord que la matérialité du procès de production, peut tout aussi bien se traduire par une croissance de la composition organique (si le capital constant est relativement plus coûteux) que ne pas le faire28. C’est dire qu’elle peut laisser inchangée la façon dont les éléments constants et variables du capital contribuent respectivement à la valorisation du produit. Par conséquent, non seulement la hausse de la composition organique est un résultat involontaire du moyen mis en œuvre par les capitalistes pour produire davantage de plus-value (augmenter la productivité), mais c’est même un obstacle direct à l’atteinte de ce but : pour un taux de plus-value donné, une composition organique accrue diminue le taux de profit29. Donc, là où l’accroissement de la productivité produit des effets à priori indéterminés sur le taux de profit (son effet peut être positif, mais il peut être négatif s’il accentue davantage l’effet déprimant de la composition organique sur le taux de profit qu’il accentue l’effet vivifiant du taux de plus-value sur ce même taux), l’accroissement de la composition organique a, au contraire,toujours pour conséquence immédiate de contribuer à plomber le taux de profit. D’où l’action salutaire des crises, qui ont pour effet de dévaluer massivement le capital et donc de faire régresser sa composition organique (et non pas technique) – ce qui permet précisément un relèvement du taux de profit et la reprise de l’accumulation. Continuons.
[2] La même cause (la recherche de la plus grande plus-value possible) produit la croissance de la masse du profit et la baisse de son taux par la diminution du fonds d’où les ouvriers tirent leur revenu.
TC dit que les tentatives des capitalistes de créer la plus grande masse de plus-value possible ont deux effets, à savoir une croissance de la masse du profit et une diminution de son taux. C’est effectivement là l’une des « contradictions internes » de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit analysées par Marx : en parvenant à accroître le taux de plus-value, les capitalistes peuvent parvenir à extraire une plus grande quantité de plus-value, mais cette réussite tendrait à se conjuguer à une hausse de la composition organique venant annuler l’effet positif de l’accroissement du taux de plus-value sur le taux de profit. Mais TC dit autre chose encore, à savoir que ces effets sont redevables de « la diminution du fonds d’où les ouvriers tirent leur revenu » ou, en d’autres mots, de la diminution du capital variable, de la somme d’argent destiné à acheter la force de travail. Ce serait grâce à la diminution de cette somme que la masse du profit augmenterait et que le taux de profit diminuerait. Or, la diminution du capital variable, même par rapport à la valeur du capital constant,ne peut jamais expliquer à elle seule l’augmentation de la masse de profits.
En effet, au moins deux variables peuvent faire augmenter la masse de profits générés au terme d’une rotation du capital : l’accroissement du taux de plus-value (donc la façon dont le travail nécessaire et le surtravail se départagent) ou la multiplication de journées de travail avec un taux de plus-value constant, voire diminué. D’un côté, dans le cas de l’accroissement du taux de plus-value, c’est tout autant l’accroissement de pl par rapport à v qui explique l’accroissement de son taux que l’inverse. C’est donc faux de soutenir que l’accroissement du rapport pl/v s’explique nécessairement par la diminution du dénominateur (v). La diminution de v peut tout à fait correspondre à une baisse du taux de plus-value, si pl baisse dans une plus grande proportion. Même que, si le taux de plus-value est donné, une baisse absolue de v correspond à une diminution de la masse de profits! De l’autre côté, l’accroissement de la masse de profits peut découler d’une simple juxtaposition des journées de travail. Ce qui signifie que non seulement la croissance de la masse de profits s’accommode parfaitement d’une croissance de v, mais que des profits croissants peuvent même précisément être redevables de la croissance de v, dans la mesure où cette dernière traduit la multiplication des sources d’extraction de plus-value.
En somme, si la diminution de v peut être responsable de l’augmentation de la masse de profits, il faut insister sur le fait que c’est seulement à certaines conditions bien précises qu’elle entraîne une augmentation de la masse de profits. Si TC va donc trop vite en affirmant que c’est la « diminution du fonds d’où les ouvriers tirent leur revenu » qui cause l’accroissement de la masse de profits, c’est d’autant plus vrai lorsque cette diminution est censée expliquer la diminution du taux de profit, puisque les variables dont il faut tenir compte sont encore plus nombreuses. En effet, v peut tout à fait rester stable alors que le taux de profit diminue, comme c’est le cas lorsqu’il y a augmentation du temps de rotation du capital : parce qu’il faut plus de temps pour produire et écouler une masse de capital-marchandise donnée, la somme de capital avancé sur cette période s’est révélée génératrice d’une masse réduite de plus-value. Il y a donc diminution du taux de profit. Mais aussi, comme on pouvait aussi le déduire des lignes qui précèdent, le taux de profit peut diminuer en raison d’une diminution de pl sans changement au niveau de v. Mieux : lorsque la quantité de plus-value est donnée et que v diminue alors que c reste constant, bien loin de faire diminuer le taux de profit, cela le fait croître. Tout ceci fait bien voir qu’il est faux d’affirmer, sans spécification, que c’est la « diminution du fonds d’où les ouvriers tirent leur revenu » qui explique la baisse du taux de profit. La diminution de v peut même expliquer l’inverse de ce que TC veut lui faire expliquer, à savoir une diminution de la masse du profit et une augmentation du taux de profit.
[3] Dans la reproduction du capital, cette diminution devient la cause qui entrave la conversion des marchandises en nouveaux moyens d’accroître l’exploitation du travail. Prise dans ce sens, la relation entre surproduction et suraccumulation devient : c’est parce que le fonds de consommation des ouvriers est constamment réduit vis-à-vis de la masse de la production, donc à partir de la sous-consommation que l’on parvient à la surproduction de capital, c’est-à-dire à l’impossibilité de renouveler l’exploitation du travail de façon efficace. Il ne s’agit pas, dans le passage entre surproduction et suraccumulation, de la possibilité d’un renversement de causalité, car il n’y a pas de rapport de causalité entre les deux termes, il s’agit [d’un] même phénomène sous deux aspects différents, chacun des deux permettant de trouver l’autre.
On comprend mieux aussi pourquoi TC tenait tant à faire admettre l’idée – fausse – que c’est la diminution de v par rapport à c qui explique l’accroissement de la masse de profit et la baisse de son taux : la diminution de v, dans la mesure où elle correspond à une diminution du poids des salaires dans le produit national, nous ramène à la théorie sous-consommationniste des crises. En effet, TC suggère que cette diminution relative de v crée, par elle-même, une disproportion entre la valeur du produit global et les capacités du marché à payer pour celle-ci, ce qui fait surgir un problème de réalisation et aboutit « à l’impossibilité de renouveler l’exploitation de travail de façon efficace ». Or, cette inférence est fausse. La diminution du poids relatif de v par rapport à c et à pl n’implique en soi aucun problème de réalisation, cela signifie seulement qu’une plus grande part de la production nationale est destinée à la reproduction du capital constant, à la consommation capitaliste et à l’accumulation. De façon générale, avec le progrès de la productivité du travail, une part sans cesse plus réduite du travail social est consacrée à produire des marchandises destinées à la reproduction des travailleur·ses productif·ves (les seul·es dont le salaire correspond effectivement à v) et, inversement, une part sans cesse plus grande est destinée à la reproduction des autres classes et à la production de nouveaux moyens de production. Dans l’hypothèse considérée par TC, le poids des salaires diminue parce que la valeur du panier de subsistance des travailleur·ses productif·ves, du fait de l’augmentation de la productivité, a diminué. Le prolétariat reçoit peut-être moins, mais c’est uniquement parce qu’il doit payer moins. Autrement dit, si son salaire diminue uniquement parce que la valeur des marchandises qu’il achète a diminué, on n’a absolument pas le droit de parler de « sous-consommation »30. En effet, la diminution du poids de v n’implique pas plus de problèmes de réalisation que le ferait l’augmentation de celui de c.
TC nous dit : « c’est parce que le fonds de consommation des ouvriers est constamment réduit vis-à-vis de la masse de la production, donc à partir de la sous-consommation que l’on parvient à la surproduction de capital, c’est-à-dire à l’impossibilité de renouveler l’exploitation du travail de façon efficace ». Il est très clair, à lire ces lignes, que la « surproduction de capital » n’entretient aucun lien avec un quelconque problème de rentabilité, avec l’incapacité à se valoriser suffisamment, alors que c’est précisément ce dont il est question avec la notion de suraccumulation de capital. Bien plutôt, à chaque fois que TC invoque cette dernière, on est tout simplement renvoyé à l’idée de surproduction de marchandises, à l’idée de disproportion entre la masse de marchandises produites et les capacités insuffisantes du marché à l’absorber. En effet, selon TC, qu’est-ce qui, dans la suraccumulation, empêche de « renouveler l’exploitation du travail de façon efficace »? Les obstacles à la valorisation? L’impossibilité de produire suffisamment de plus-value? La faiblesse du taux de profit? Pas du tout, c’est bien plutôt le fait que les capitalistes sont incapables de vendre, parce qu’ils ont payé trop chichement leurs prolétaires qui, en retour, n’ont pas l’argent suffisant pour acheter tout ce qui a été produit. La suraccumulation dont parle TC n’est que l’autre face de l’explication par la sous-consommation : il est indifférent de dire que la demande solvable n’existe pas pour écouler tout ce qu’on a produit ou qu’on a trop produit relativement à cette même demande. Dans un cas comme dans l’autre, cela revient à dire qu’il y a, en un point de la circulation du capital – ce point qui fait se rencontrer les capitalistes en tant que vendeurs et les prolétaires en tant qu’acheteurs –, un blocage, et c’est ce qui empêche « le renouvellement de l’exploitation du travail de façon efficace ». Nous ne sommes pas sortis du Livre II.
Pour clore cette discussion, il est remarquable que TC cherche à établir un rapport d’implication réciproque entre sous-consommation ouvrière et loi de la baisse tendancielle du taux de profit, alors qu’il s’agit pour elle de montrer en quoi les explications des crises par la sous-consommation et par la suraccumulation sont identiques. En effet, quand bien même on serait parvenu à établir que la sous-consommation entretient un rapport nécessaire avec la loi de la baisse tendancielle du taux de profit (ce qui n’est pas le cas), on n’aurait toujours rien dit de son identité avec… la suraccumulation. Pourquoi? Parce qu’il s’agit de deux phénomènes distincts. Et à ce titre, c’est certainement un fait à regretter que la discussion de la suraccumulation, par Marx, ait lieu dans la partie sur les contradictions internes de la loi de la baisse du taux de profit31. Cela donne précisément l’impression que les deux phénomènes s’impliquent réciproquement ou, à tout le moins, qu’ils font partie d’une même structure explicative. Mais la lecture attentive de cette partie ne laisse aucun doute : si la crise de suraccumulation est évidemment liée à la faiblesse du taux de profit, elle n’entretient aucun lien nécessaire avec le progrès de la productivité, ni d’ailleurs avec la hausse de la composition organique. Autrement dit, il peut y avoir suraccumulation de capital sans qu’il y ait eu de changements significatifs au niveau du progrès de la productivité du travail ou de la composition organique, précisément parce que c’est le taux d’exploitation – la capacité à exploiter le prolétariat – qui détermine dans la plus grande mesure si le capital existant peut effectivement être valorisé32.
Contrairement à ce qui se passe dans l’hypothèse de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit que Marx analyse en long et en large, la chute du taux de profit apparaît ici causée non pas par une augmentation trop importante de la composition organique pour un taux d’exploitation donné (voire croissant), mais à l’inverse, par une diminution du taux d’exploitation pour une composition organique donnée. Ici donc, « suraccumulation de capital » signifie : suraccumulation de « moyens à extraire de la plus-value », suraccumulation de capitaux cherchant à s’approprier du travail non payé par rapport à la main-d’œuvre disponible. Il y a un trop plein de capacités productives relativement à la quantité de forces de travail disposées à se faire exploiter. On a accumulé frénétiquement sur une base extensive, c’est-à-dire qu’on a agrandi les entreprises existantes, construit de nouvelles usines, creusé de nouvelles mines, installé de nouveaux restaurants, etc. Le hic, c’est que la population prolétarienne est momentanément trop restreinte et l’armée de réserve industrielle, trop réduite. Pour subvenir à leurs besoins accrus de main-d’œuvre et s’approvisionner en forces de travail, les entreprises n’ont alors pas le choix de tirer les salaires vers le haut. Mais par là, le taux d’exploitation qu’on retrouve dans ces entreprises et, partant, le taux de profit, diminuent. Étant donné qu’elles sont contraintes de payer leurs salariés « au-dessus de leurs moyens », les entreprises ne sont plus rentables. Lorsqu’elles et leurs bailleurs de fonds s’aperçoivent du manque à gagner au niveau de la plus-value, la crise éclate33.
Dans cette explication, il n’est en aucun cas besoin de faire intervenir l’étroitesse de la consommation pour rendre compte de la crise. Certes, lorsque le taux de profit baisse, les entreprises réduisent leurs activités ou ferment leurs portes, ce qui réduit à la fois la demande au niveau du marché du travail et au niveau des matières premières et auxiliaires, machines et produits semi-transformés. Il est inévitable que cette réduction de l’activité réduise la demande solvable et entraîne une mévente (beaucoup d’entreprises se révéleront incapables de vendre ce qu’elles avaient produit). Une crise ne peut se produire sans entraîner un blocage de la consommation et, partant, un enjeu de réalisation. Mais il faut voir comment se résorbe la crise pour comprendre ce qui en était la cause. Qu’est-ce qui fait disparaître, momentanément au moins, le problème de la réalisation? C’est justement la reprise de l’accumulation. Or, comment cette reprise est-elle elle-même possible? Par le rétablissement du taux de profit. Et qu’est-ce qui permet de rétablir le taux de profit? Serait-ce l’augmentation des salaires des prolétaires, pour ainsi stimuler la demande de marchandise, comme l’implique l’explication sous-consommationniste? Pas du tout. Au contraire, comme le rappelle Mattick, c’est dans les premiers moments de la crise que les salaires atteignent leur maximum et donc, que la consommation prolétarienne est la plus intense34. Or, cela entre en conflit avec l’hypothèse selon laquelle la crise est causée par un problème de réalisation : si, juste avant que la crise n’éclate, les salaires augmentent et, avec eux, la consommation, c’est qu’il doit y avoir un autre problème qu’un problème de réalisation pour expliquer la crise. Ce problème, c’est celui de la rentabilité. Cette hypothèse est attestée par le fait que c’est justement le rétablissement des conditions de la profitabilité qui fait sortir de la crise, conditions qui renvoient respectivement aux deux grandes variables affectant le taux de profit : la composition organique et le taux d’exploitation.
Voyons comment cela se produit. Avec la crise, il se produit une dévaluation massive, voire une destruction pure et simple du capital. Pour un même taux d’exploitation, le taux de profit subit un bond, qui est lui-même fonction de la profondeur de la dévaluation du capital existant. En effet, si c diminue alors que v et pl restent constants, le taux de profit augmente nécessairement et permet la relance de l’accumulation (les investisseurs gagnent confiance dans la rentabilité de leurs capitaux). Mais la crise agit d’une autre façon encore, puisqu’avec la faillite de nombreuses entreprises et le ralentissement de la production, l’offre de forces de travail, autrefois trop faible, devient surabondante. Les capitalistes ont alors le beau jeu d’offrir des salaires beaucoup plus bas ou de dégrader les conditions de travail de leurs travailleur·ses pour ainsi augmenter le taux d’exploitation35. Les crises, en affamant le prolétariat, le contraignent par des voies purement économiques à la docilité et permettent d’accroître le taux d’exploitation. Au moment où éclate la crise, le capital était pléthorique, ce qui causait une pénurie de plus-value. Ensuite, c’est l’inverse qui a lieu : il existe peu de capitaux cherchant activement à se valoriser et, corollairement, beaucoup de plus-value potentielle. En détériorant le rapport de force du prolétariat face au capital, la crise crée donc les conditions d’un rétablissement du taux de profit qui, lui, permet simultanément de relancer l’accumulation et de solutionner les problèmes de réalisation.
De toute évidence, nos camarades ont cherché à parer leur approche sous-consommationniste de la crise d’un verni « suraccumulationniste » en invoquant la grosseur relative de c par rapport à la petitesse de v, entretenant ainsi l’illusion que leur explication a un lien quelconque avec la structure de valorisation du capital et, partant, avec les éléments causant un déficit de rentabilité. Or, le mécanisme central que met au jour la théorie de la suraccumulation – la diminution du taux d’exploitation et du taux de profit consécutive à la multiplication des capitaux –, n’est pas même mentionné. Pour TC, tout se ramène à la faiblesse relative de v, c’est-à-dire à l’étroitesse de la consommation prolétarienne. Pourquoi? Parce que cette dernière empêche que toute la plus-value matérialisée dans les marchandises mises sur le marché soit réalisée. Le problème, l’élément appelant une solution, ce n’est donc pas la pénurie de plus-value, c’est le trop-plein de plus-value. Aussi doit-on convenir que le projet de nos camarades de montrer que sous-consommation et suraccumulation sont identiques tombe à plat, faute d’avoir saisi ce qui fait la spécificité d’une crise de suraccumulation.
Pour conclure là-dessus, l’ironie ultime, c’est que la volonté d’établir l’identité de ces deux explications, et ce, afin d’expliquer le passage à la vie quotidienne, s’enferme dans une antinomie. En effet, ou bien l’explication « unifiée » de la crise (sous-consommation = suraccumulation) est l’explication véritable et a donc toujours été la seule explication satisfaisante des crises du mode de production capitaliste. Mais si on parvient à le démontrer, alors cette identité ne nous aide pas à saisir la spécificité de la crise « actuelle » et ne peut pas davantage être invoquée pour expliquer l’importance qu’a prise la vie quotidienne depuis la restructuration. Ou bien – hypothèse plus favorable – fut une époque où l’explication par la suraccumulation était la meilleure, mais cette époque étant révolue, une nouvelle explication plus complète serait devenue nécessaire. Dans ce cas, il faudrait être en mesure de prouver que la sous-consommation joue un rôle accru, un rôle qu’elle ne jouait pas auparavant, et que ce rôle s’articule effectivement à la suraccumulation. Malheureusement, les tentatives qui vont en ce sens ont abouti à l’évacuation pure et simple de l’explication par la suraccumulation de capital36.
1.3. Le concept de vie quotidienne comme panacée
Nous avons vu que deux des principales raisons invoquées par TC pour expliquer l’actualité de la vie quotidienne sont loin d’être convaincantes. Cela n’implique pourtant pas que cette partie de la réalité sociale soit dénuée d’importance dans le cycle de luttes actuel. On peut parfaitement expliquer, comme nous avons essayé de le faire plus haut, l’importance accrue qu’ont prise les luttes portant sur les conditions de vie par la fin de la reproduction de l’identité ouvrière consécutive à la contre-offensive néolibérale. Ce sont les échecs répétés des luttes portant sur les salaires et sur les conditions de travail qui ont imposé un déplacement des énergies prolétariennes vers des enjeux non directement liés au travail. Cela dit, dans cette partie, nous verrons que nos camarades vont encore plus loin et font jouer à la notion de vie quotidienne un rôle autrement plus important, à même d’éclipser ce qui a lieu au sein du procès de production. Ce rôle central, nous le verrons dans la deuxième partie du texte, a d’importantes conséquences sur leur théorisation des classes sociales.
En effet, pour TC, non seulement la vie quotidienne et la question des conditions de vie délimiteraient désormais le terrain sur lequel les luttes les plus marquantes des dernières années ont lieu, mais c’est là que la contradiction fondamentale prolétariat-capital se serait déplacée. Alors que cette contradiction se situait au niveau de la production (de l’exploitation du prolétariat par le capital), elle serait passée au niveau de la reproduction de ce rapport, donc au niveau de la vie quotidienne :
[1] La restructuration des années 1970-1980 fit passer la contradiction entre le prolétariat et le capital au niveau de sa propre reproduction, [2] en tant que crise de cette relation, la crise de 2008, à son tour, posa la surdétermination des rapports de distribution sur les rapports de production [3], il s’en est suivi que l’exploitation et la production de valeur qui sont le cœur du mode de production capitaliste se sont répandus et existent dans la reproduction d’ensemble, globale qu’est la vie quotidienne dans son fétichisme, ses idéologies et ses mythes, mais aussi et par là-même dans sa capacité à remettre en cause toutes les instances du mode de production et avant tout l’économie comme détermination en dernière instance37.
Étant donné sa densité et son caractère alambiqué, reconstruisons, phrase par phrase, le raisonnement de TC.
[1] La restructuration des années 1970-1980 fit passer la contradiction entre le prolétariat et le capital au niveau de sa propre reproduction
Si nous comprenons correctement TC, cette phrase impliquerait qu’avant 1970-1980, la contradiction entre le prolétariat et le capital se situait au niveau de la production elle-même. On peut expliciter cette idée de la façon suivante : il y a contradiction dans la production, parce que le capital ne se valorise qu’en exploitant le prolétariat, mais qu’afin de se valoriser davantage, le capital tend paradoxalement à expulser le prolétariat du procès de travail38. TC nous dit toutefois que la restructuration modifie cet état de choses et que la contradiction serait depuis lors située « au niveau de sa reproduction » (celle du prolétariat? celle du capital?). Cherchons à expliquer cette affirmation en supposant d’abord qu’il s’agit de la reproduction du prolétariat.
On sait qu’avec la restructuration, le prolétariat cesse de voir sa propre reproduction « prise en charge » par le capital. En effet, à partir de la Seconde Guerre mondiale, les prolétaires ont bénéficié d’une certaine forme de reconnaissance de la part du capital à travers le rapport salarial fordiste (croissance plus ou moins constante des salaires, plein emploi, stabilité du travail, participation à la gestion de la production par le biais de « ses » organisations syndicales, etc.), mais aussi à travers la reconnaissance de ses organisations politiques (partis ouvriers). Mais tout ceci vacille à partir des années 1970-1980. L’existence institutionnelle du prolétariat, à travers celle de la classe ouvrière comme sujet politique clairement identifiable, est brusquement remise en question. Les moyens par lesquels les prolétaires parvenaient à se négocier une place relativement respectable ont massivement été neutralisés au terme d’offensives patronales vigoureuses, appuyées par l’État. Il en résulta que l’État et les entreprises cessèrent de trouver face à elles un prolétariat bien organisé et sûr de lui-même : ils eurent bien plutôt affaire à des prolétaires plus ou moins atomisés et, partant, beaucoup moins combatif·ves. Ce qui explique ces transformations et ces revers, c’est notamment la réaction capitaliste à l’intensité dangereuse qu’avaient prise les luttes du prolétariat. Pour maintenir l’accumulation à flot, il fallait remettre ce dernier à sa place et, pour ce faire, faire jouer tout à la fois la contrainte économique et les contraintes juridico-politiques39. Ce n’est donc pas la restructuration qui a mis le rapport prolétariat-capital en crise, c’est au contraire la crise de ce rapport qui a rendu nécessaire une restructuration, de même que l’institution d’un nouveau type de relation entre la classe capitaliste et le prolétariat. La restructuration – comme TC le sait très bien – répond à une crise qui, dès lors qu’elle atteint son but, crée les conditions d’un rapport prolétariat-capital plus ou moins stable et fonctionnel. Ou, à tout le moins, suffisamment stable pour redresser le taux de profit et relancer l’accumulation. C’est ce retournement qui a lieu au courant des années 1980-1990.
Par conséquent, est-il légitime d’affirmer, comme le fait TC, que depuis la restructuration, la contradiction a lieu « au niveau de sa reproduction [celle du prolétariat] »? Si l’on peut tout à fait admettre que cette reproduction est devenue beaucoup plus problématique du point de vue des prolétaires (ils et elles en arrachent davantage), il faut bien voir, à l’inverse, que cette forme de reproduction remplit correctement son rôle : le prolétariat est reproduit en tant que classe atomisée, politiquement et idéologiquement désarmée, et ce, de façon à l’empêcher de lutter efficacement contre son exploitation, permettant ainsi aux capitalistes de maintenir une rentabilité suffisante. Cela ne signifie pas que la reproduction du prolétariat se fasse sans difficulté ou sans lutte de part et d’autre. Pourtant, du point de vue de la totalité, ce n’est tout simplement pas le cas que c’est « au niveau de la reproduction du prolétariat » qu’est passée la contradiction : les prolétaires continuent d’aller se faire tanner chez leurs capitalistes locaux, en dépit de l’aggravation des conditions dans lesquelles leur reproduction a lieu. Et si l’on acceptait cette proposition, si l’on admettait que la contradiction était rendue « interne au prolétariat », alors il faudrait se demander : qu’en est-il maintenant de la contradiction entre le prolétariat et le capital? Si elle s’est déplacée, c’est qu’elle n’est plus là, c’est que ce n’est plus à ce niveau que se joue l’important. Mais est-ce vraiment ce que TC veut dire? Qu’il n’y a plus tant de contradictions entre le prolétariat et le capital qu’au sein de la reproduction du premier? Ce faisant, on aurait certes mis en lumière le caractère plus défavorable encore de la situation dans laquelle se trouve le prolétariat du double point de vue du succès de ses luttes quotidiennes et de sa capacité à s’attaquer à la racine de son exploitation. Mais on y serait parvenu au prix d’une mystification formidable : celle de laisser croire que ce n’est plus entre le prolétariat et le capital que se joue la contradiction.
Admettons cette fois que « sa reproduction » désigne celle du capital ou encore, celle du rapport prolétariat-capital. Nous sommes insensiblement ramenés au même point : si c’était auparavant au sein de la production du capital qu’il y avait contradiction, qu’elle se trouve maintenant au niveau de la reproduction générale (au niveau de la production des conditions de possibilité du rapport prolétariat-capital), c’est que la contradiction ne se trouve plus dans la production. Qu’est-ce à dire? Que la production, donc l’exploitation capitaliste, ne pose plus problème sur ce terrain et qu’il faille donc en sortir, regarder du côté de la vie quotidienne pour l’apercevoir? Si TC cherche à maintenir que les luttes les plus impressionnantes auxquelles participent les prolétaires se déroulent à l’extérieur de l’entreprise, personne ne peut lui donner tort. Pourtant, TC va plus loin et soutient que la contradiction s’est déplacée. Or, il n’en est rien. La contradiction entre le prolétariat et le capital demeure fondée sur l’exploitation du premier par le second, laquelle a fondamentalement lieu dans le procès de production. Mieux, du point de vue des prolétaires, on peut même dire que c’est uniquement la considération du procès de production qui permet de trancher sur le caractère exploité de leur travail : que les marchandises matérialisant leur exploitation soient vendues ou non, que la plus-value qu’elles recèlent soit réalisée ou pas, ils et elles ont « surtravaillé » et ont fourni un surproduit dont la trajectoire ultérieure ne les regarde plus. Leur salaire ayant été versé et pas davantage, il en découle inéluctablement que les prolétaires doivent, d’un côté, se contenter des marchandises plus ou moins nécessaires à leur reproduction et, de l’autre, chercher à vendre leur force de travail à nouveau. Économiquement, leur vie quotidienne est prédéterminée de façon écrasante par ce qui a lieu au niveau de la production. Que ce soit sur ce terrain que la contradiction éclate ne signifie pas du tout que la contradiction s’est déplacée.
[2] en tant que crise de cette relation, la crise de 2008, à son tour, posa la surdétermination des rapports de distribution sur les rapports de production
Il est évident que la crise de 2008 est la crise du rapport (de la « relation ») entre le prolétariat et le capital, car toute crise économique est une crise du rapport dans le cadre duquel a lieu l’accumulation. La crise n’est jamais autre chose que la preuve pratique du caractère dysfonctionnel du rapport d’exploitation capitaliste et de ses configurations historiques particulières. Celle de 2008 n’a absolument rien de particulier de ce point de vue. La crise de 1973-1974, celle qui inaugure la restructuration néolibérale, représente en fait une crise beaucoup plus profonde du rapport entre prolétariat et capital. Cette crise a manifesté la caducité d’un modèle fondé sur le progrès technique et l’achat de la paix sociale par le maintien de salaires élevés et la reconnaissance du prolétariat en tant que sujet sociopolitique légitime. En misant sur l’augmentation de la productivité pour ainsi accroître le taux d’exploitation et, partant, le taux de profit (plutôt que de s’attaquer frontalement au prolétariat et à ses conditions de vie), le capital dans sa figure « fordiste » produisait les conditions de son blocage, parce que ses concessions au prolétariat eurent précisément pour résultat d’engendrer une pénurie de plus-value. Incapable de valoriser leur capital à un taux suffisant, les entreprises durent ou bien ralentir leur production, voire fermer leurs portes, ou bien accepter de s’en prendre aux prolétaires eux et elles-mêmes. Pour produire à un taux de profit susceptible de relancer l’accumulation, il fallait, d’un côté, que soit dévalué le capital existant et, de l’autre, que les salaires et les conditions de travail des travailleur·ses productif·ves soient sérieusement dégradés. La restructuration néolibérale et l’étendue des bouleversements qu’elle a entraînés sont à la mesure de la profondeur des crises qui ont secoué le monde durant la décennie 1970. De même, sur le plan de la lutte des classes, il y a un avant- et un après-crise qui sont incomparablement plus marqués que ceux qui ont jouxté la crise de 2008. En quoi, donc, cette dernière peut-elle être spécifiquement présentée comme une crise du rapport prolétariat-capital susceptible de « [poser] la surdétermination des rapports de distribution sur les rapports de production »?
Cet usage surprenant de la notion de « surdétermination » justifie que nous la définissions nous-mêmes. Il ne s’agit pas de jouer aux professeurs, mais de s’assurer que l’on parle bien de la même chose. Est surdéterminé un élément conditionnant, mais qui est lui-même conditionné par d’autres éléments. Exemple classique : dans les sociétés de classes, l’élément économique est surdéterminé par l’élément juridique. Si ce sont bel et bien les rapports économiques qui déterminent dans leurs grandes lignes les rapports juridiques d’une société de classes donnée, qui leur donnent leur contenu et les font évoluer de telle ou telle façon, il est aussi vrai que ces rapports économiques n’apparaissent pas ex nihilo. Ils se forment au contraire sur la base d’un substrat social préexistant, lequel est notamment déterminé sur un plan juridique (préexistence de certaines lois, coutumes, etc.). Les rapports juridiques préexistants sont donc transformés par le développement de ces nouveaux rapports économiques, mais ils conditionnent aussi ces derniers, de sorte que ce qui en ressort n’est pas que le pur résultat des déterminants économiques. Exprimé simplement, le concept de surdétermination cherche à mettre l’accent sur le fait que même l’élément le plus déterminant d’une totalité n’est jamais lui-même purement et absolument conditionnant, mais qu’il est lui-même codéterminé (surdéterminé, en l’occurrence).
Ayant une idée plus claire de ce à quoi peut rassembler une relation de surdétermination, passons maintenant à la question de savoir de quelle façon elle peut s’appliquer au couple conceptuel rapports de production/rapports de distribution. Pour ce faire, il n’est pas inutile de renvoyer à la façon dont Marx l’utilise, étant donné que c’est de lui dont s’inspirent nos camarades de TC. Celui-ci souligne que, bien que les rapports de distribution soient eux aussi susceptibles de rendre compte de la structure économique d’une société donnée40, il demeure que ce sont les rapports de production qui sont les mieux placés pour le faire. Pourquoi? Parce qu’en partant des rapports de production, donc de la place qu’occupent les agents de la production par rapport aux instruments de travail d’un côté et du produit du travail de l’autre, on déduit immédiatement les rapports de distribution qui leur correspondent. Par exemple, c’est une condition absolument essentielle au mode de production capitaliste que la rémunération des prolétaires soit si basse qu’elle les empêche d’accumuler et de rassembler des réserves qui leur permettraient de ne pas travailler pour le compte d’autrui. Sans cette situation de dénuement généralisé, le travail salarié et, partant, la production de plus-value seraient impossibles sur une large échelle. Si cette condition n’était pas remplie, la prestation de surtravail, la production de plus-value et, avec elles, l’accumulation elle-même seraient économiquement impossibles. En ce sens, les rapports de distribution entre capitalistes et prolétaires « sont identiques, pour l’essentiel, avec ces rapports de production41 » et ne peuvent donc varier qu’à l’intérieur de certaines limites étroites : si elles les outrepassent, l’exploitation capitaliste n’est plus possible42.
Or, une fois minimalement clarifié le lien réel entre rapports de production et rapport de distribution, on voit bien que l’idée selon laquelle les premiers peuvent être « surdéterminés » par les seconds est dénuée de sens : les rapports de distribution ne font que décrire la façon dont le produit social se répartit parmi les classes sur la base de rapports de production déterminés dont ils « constituent l’autre face43 », de façon à ce que ces derniers puissent se reproduire à l’identique44. Si donc TC entend par « surdétermination des rapports de distribution sur les rapports de production » que les premiers sont devenus indépendants des rapports de production, autonomes, nos camarades doivent expliquer clairement comment une chose aussi improbable est possible. Et si, comme ça semble être le cas, ils et elles soutiennent que les rapports de distribution sont devenus « prédominants45 » au point de pouvoir contrecarrer l’effet des rapports de production sur l’appartenance de classe, alors il faut qu’on leur apporte un grand verre d’eau.
[3] il s’en est suivi que l’exploitation et la production de valeur qui sont le cœur du mode de production capitaliste se sont répandues [?] et existent dans la reproduction d’ensemble, globale qu’est la vie quotidienne dans son fétichisme, ses idéologies et ses mythes, mais aussi et par là-même dans sa capacité à remettre en cause toutes les instances du mode de production et avant tout l’économie comme détermination en dernière instance.
Solidement posé sur les prémisses [1] et [2], le raisonnement de TC atteint ici un sommet d’irrationalité. Après la crise de 2008, l’exploitation et la production de valeur se seraient « répandus » et existeraient « dans la reproduction d’ensemble, globale qu’est la vie quotidienne dans son fétichisme, ses idéologies et ses mythes ». Dans cette phrase se retrouvent, comme en concentré, toutes les inepties sur l’extension du travail productif sur l’ensemble de la société et sur l’élargissement concomitant du prolétariat à l’ensemble des travailleur·ses. TC est à un cheveu de soutenir que les utilisateur·rices d’Instagram et de Tiktok produisent de la valeur et viennent gonfler les rangs du prolétariat mondial. Expliquez-nous comment, chers camarades, la production de valeur et l’exploitation peuvent-elles avoir lieu dans « la reproduction d’ensemble, globale qu’est la vie quotidienne »? Suis-je exploité lorsque je me rends au cinéma, lorsque je dors, lorsque je me fais du macaroni chinois, lorsque je gratte ma guitare? Produis-je de la valeur lorsque je lis le dernier numéro de TC, lorsque je participe à une manifestation? On ne peut décrire la jubilation des capitalistes si TC avait raison et que de la valeur (ne parlons pas de la plus-value!) commençait à être produite lorsque les personnes concernées par « la reproduction d’ensemble, globale qu’elle la vie quotidienne » (bref, tout le monde) se brossent les dents ou rangent leur chambre. Mais malheureusement pour la classe capitaliste mondiale (et pour TC, bien que pour des raisons différentes), il n’en est rien46.
Sur la base du fait que la reproduction d’ensemble et, plus précisément, la vie quotidienne seraient devenues des espaces où valeur et plus-value sont créées et où l’exploitation capitaliste a lieu, TC soutient que la « vie quotidienne » acquiert la capacité corollaire (la vie quotidienne est devenue un sujet, elle a la « capacité » de faire x ou y?) de « remettre en cause toutes les instances du mode de production et avant tout l’économie comme détermination en dernière instance ». Or, les luttes s’inscrivant dans « la vie quotidienne », dans la mesure même où elles restent sur ce terrain (celui du fétichisme et de la fausse immédiateté selon TC même), sont précisément incapables de s’attaquer au capital lui-même et donc, à la structure sociale dans son ensemble. Nul doute que les luttes qui y parviendront émergeront des luttes qui se tenaient initialement sur ce terrain. Mais tant qu’elles relèvent de la vie quotidienne, c’est-à-dire tant qu’elles s’en tiennent à interpeller l’État et à lui rappeler ses « responsabilités », tant qu’elles revendiquent un plus grand respect des droits, une fixation du prix de telle ou telle denrée de base, donc tant qu’elle laisse intacte l’exploitation capitaliste et son cortège d’évidences, elles demeurent par définition incapables de remettre en cause « toutes les instances du mode de production et avant tout l’économie comme détermination en dernière instance ».
Résumons le raisonnement de TC. Partant de la restructuration et de ses effets dévastateurs sur les organisations prolétariennes appartenant au cycle de lutte précédent, TC conclut à une diminution de l’importance du moment de l’exploitation proprement dite dans la contradiction opposant prolétariat et capital, et ce, au profit de ce qui fait qu’une telle exploitation est possible (la reproduction de ses conditions et les activités qui y sont liées). En raison de la restructuration donc, la contradiction n’aurait plus tant lieu au cœur même du rapport entre le prolétariat et le capital (au niveau de l’exploitation, de l’extorsion de plus-value) qu’au niveau de ce qui rend ce rapport possible. Ensuite, TC fait intervenir la crise de 2008 comme un deus ex machina susceptible d’expliquer quelque chose d’aussi lourd de conséquences, du point de vue de la théorie matérialiste de la société, que la relativisation de la primauté des rapports de production au profit des rapports de distribution : la crise de 2008, en tant que crise particulièrement grave du rapport prolétariat-capital (ce qui est faux), aurait fait en sorte que ce sont maintenant ces derniers qui « surdéterminent » (?) les premiers. Or, c’est en semant de la confusion autour de ce qui est décisif du point de vue de la reproduction de la société capitaliste que TC peut affirmer, au bout du compte, que ce sont précisément les luttes menées sur le terrain de la vie quotidienne et menées dans ses termes à elle qui nous rapprochent le plus d’un bouleversement révolutionnaire de la société.
1.4. Les apparences comme degré ultime de la réalité
Les récentes découvertes théoriques de TC ne sont pas des moindres : absence de primauté de l’économie sur la vie quotidienne, absence de primauté de l’exploitation sur la reproduction de ses conditions, surdétermination des rapports de distribution sur les rapports de production, extension et généralisation de l’exploitation et de la production de plus-value au sein des activités propres à la vie quotidienne, etc. Conscient·es de leur audace théorique, nos camarades técéistes ont fait le choix judicieux de venir asseoir leurs conceptions sur un socle philosophique plus approprié, c’est-à-dire moins embarrassant que l’ontologie matérialiste héritée de Marx. En effet, étant donné que plusieurs des idées développées dans TC 27 contredisent frontalement celles qui découlent de l’ontologie marxiste (primauté de la production sur la reproduction, de l’économie sur la « vie quotidienne », des rapports de production sur les rapports de distribution, etc.), mieux valait y renoncer et la remplacer par une ontologie plus souple.
C’est qu’en dépit de certains préjugés « néo-programmatistes », nous dit TC, la vie quotidienne joue un rôle privilégié non seulement au niveau de la lutte des classes en tant qu’enjeu immédiat des différents conflits, mais aussi au niveau de la constitution de la société en classes. Ou encore, bien qu’on puisse croire que l’exploitation capitaliste occupe une place à part lorsqu’il s’agit de rendre compte de ce qui définit les classes et de ce qui les oppose pratiquement, TC nous rappelle que l’admission de cette primauté repose sur une interprétation grossière de Marx. En effet, pour penser que quelque chose comme l’occupation d’une place déterminée au sein du système des rapports de production et de subordination puisse être considérée comme l’élément déterminant de l’appartenance de classe, il faut se méprendre sur le sens de la distinction marxienne entre mouvement réel et apparence. À l’inverse, si l’on comprend que le mouvement réel n’est qu’un concept, un « concret de pensée » et que seules les apparences constituent la réalité, alors on pourra éviter de tomber dans la grossièreté.
Présentons cette interprétation grossière. Si l’on suit l’exemple de Marx, on est nécessairement amené, afin d’analyser la société capitaliste et ses mécanismes, à distinguer deux niveaux de réalité : les apparences et le mouvement réel. Les apparences ou formes d’apparition, c’est ce qui se donne immédiatement à l’observation, mais qui, après analyse, se révèle ne pas correspondre parfaitement à la vérité de l’objet étudié. Plus encore, ces apparences ne peuvent être comprises pour elles-mêmes sans être mises en relation avec ce dont elles sont les formes d’apparition : le mouvement réel. Et précisément, le mouvement réel, c’est ce qui a effectivement lieu en dépit des apparences, mais qui, paradoxalement, ne se manifeste qu’au travers de ce qui, à première vue, va jusqu’à le contredire. D’un point de vue phénoménal, du point de vue de l’observateur, c’est tout à fait le cas que ce niveau (le mouvement réel) n’existe pas à côté de l’autre, celui des apparences. La réalité ne se manifeste pas deux fois : une première fois telle qu’elle est réellement et une seconde fois de façon déformée. Mais ce n’est pas parce que les choses apparaissent d’une certaine façon qu’elles sont effectivement de cette façon. Le salaire paraît être « le prix du travail ». Plus un prolétaire payé à l’heure travaille, plus il gagne. Parce qu’il varie en fonction du nombre d’heures travaillées, le salaire semble rémunérer la dépense de travail et constituer sa récompense. Pourtant, nous savons que le salaire47 ne paie pas le travail, mais l’usage de la force de travail pour une période de temps déterminée. En effet, si c’était le travail qui était payé, l’exploitation capitaliste serait impossible. Or, l’exploitation capitaliste a lieu et les prolétaires reçoivent un salaire, c’est donc que ce dernier rémunère autre chose que ce qu’il semble rémunérer. Cette chose, c’est l’usage de la force de travail. Il faut alors conclure que le salaire, en dépit des apparences, paie cet usage. Ce rapport entre salaire et usage de la force de travail n’est pas un rapport « théorique », c’est un rapport tout à fait réel, c’est-à-dire que c’est ainsi que les choses se passent effectivement, bien que la conscience de ce rapport réel ne s’acquiert que par un travail théorique. Et cela a une valeur générale : le monde, dans sa vérité, ne se donne jamais immédiatement tel quel, il doit être théoriquement reconstruit. C’est en ce sens qu’il faut entendre que le mouvement réel correspond bel et bien à l’objet. Mais prenons un autre exemple susceptible de clarifier ce qui appartient à l’un et l’autre de ces niveaux, en nous penchant sur le cas du capital financier.
De prime abord, tout se passe comme si l’argent était en mesure, lorsqu’il est « bien placé », de fructifier et de faire des petits. C’est précisément de cette façon que fonctionne le capital financier, c’est-à-dire grâce à l’investissement de sommes considérables dans des affaires lucratives, aboutissant à accroître la masse de capital-argent initialement détenue. Cette description correspond à un certain niveau de réalité (c’est effectivement ainsi qu’on peut décrire le circuit du capital-argent : A – A’), mais elle demeure incomplète, parce qu’elle ne fait que décrire, pour reprendre l’expression de Marx, « des phénomènes qui apparaissent à la surface », par opposition, justement, à « l’élément invisible », au « point essentiel qu’il faut élucider48 ». En effet, elle manque l’essentiel, à savoir que c’est, en amont, le travail productif qui crée la plus-value que finit par s’approprier le capital financier, cette fois, sous forme de richesses proprement financières (intérêts, « rémunération du capital », etc.). Donc si l’on souhaite rendre compte de l’objet « capital financier », il faut tenir compte de ce qui s’impose à n’importe quel observateur (son circuit manifeste), mais il faut dépasser ce niveau et remonter à celui du « mouvement réel » pour ensuite pouvoir l’expliquer. Ce faisant, on découvre quels sont les liens étroits qui le font dépendre à la fois de la rentabilité propre des capitaux productifs (la masse brute de plus-value qu’ils s’approprient), du rapport de forces entre fractions capitalistes (lesquelles se partage cette masse brute), mais aussi, et surtout, de l’exploitation du prolétariat, et ce, en dépit de la capacité apparente du capital financier à faire naître un profit de nulle part. Bien que ces liens internes ne sont jamais « réels » au sens où le sont les phénomènes (ils ne se donnent jamais comme des choses apparemment immédiates), ils sont pourtant plus « réels » au sens où ils s’approchent davantage de ce qu’est l’objet en vérité.
Le travail d’exposition théorique, tel qu’il est à l’œuvre dans les trois livres du Capital de Marx, se fait ainsi en deux grandes étapes. La première consiste à partir des « apparences », des phénomènes qui se situent à la surface de société capitaliste, pour atteindre leur essence ou, autrement dit, leur vérité. Il s’agit donc de produire des abstractions rationnelles. En tournant notre regard vers la production, on parvient précisément à saisir l’essence de ces phénomènes, c’est-à-dire à faire voir qu’ils s’expliquent par l’existence d’un mode de production ayant pour contenu l’exploitation et ayant pour logique la production sans cesse plus grande de plus-value. Il n’y a pas de phénomène propre au mode de production capitaliste explicable de façon satisfaisante sans, à un moment ou à un autre de l’explication, être rapporté à ces éléments. C’est seulement à partir de là que s’ouvre la seconde étape, celle de la concrétisation, donc celle qui consiste à partir de l’essence (obtenue par abstraction) pour remonter graduellement aux apparences (en produisant des abstractions de moins en moins abstraites, donc de plus en plus riches) et ainsi, montrer en quoi ces apparences valent comme les formes d’apparition nécessaires de l’essence, comme des produits objectifs du mouvement réel49. Si le travail est bien fait, on aura donc, au terme de cette seconde étape, supprimé la contradiction apparente entre mouvement réel et apparences, parce qu’on aura expliqué comment ces dernières traduisent, à leur façon, le mouvement réel.
Le problème avec cette façon de voir les choses, nous dit TC, c’est qu’elle présuppose que le mouvement réel est lui aussi quelque chose d’objectif et d’irréductible aux apparences, alors que « ce “mouvement réel” n’est qu’un concept50 », n’est qu’un pur « objet de pensée51 ». Pour TC précisément, l’essence ou le mouvement réel – ce que Marx nomme aussi les « liens internes réels52 » – est quelque chose de purement idéel, dont la théorie est le démiurge. Il s’ensuit nécessairement que la réalité objective est, elle, entièrement épuisée par les apparences. Par conséquent, sous ce que Marx appelle « la surface des phénomènes », derrière les « formes illusoires au milieu desquelles [les agents réels de production] se meuvent tous les jours et auxquelles ils ont affaires53 », on ne trouve… rien. Selon TC, il n’y a rien auquel viendrait référer le concept de mouvement réel, puisqu’il s’agit strictement d’un « concept produit par la science ». Nos camarades ont une drôle de conception de la pratique scientifique s’ils jugent « scientifique » la production de concepts qui n’ont aucun référent et qui, par conséquent, ne correspondent à rien. Un concept ne renvoyant à rien de réel peut certes exister (par ex. : le concept de Dieu), mais il n’a rien à voir avec la science. Lorsque TC dit que le concept de mouvement réel est un concept produit par la science, c’est tout à fait correct, mais il en va de même pour le concept de capital, de marchandises, de plus-value, de valeur, etc. En quoi, de ce point de vue, le concept de mouvement réel diffère-t-il de ceux de valeur et de plus-value? Ni la valeur ni la plus-value ne s’observent immédiatement et pourtant, elles s’imposent et font sentir leurs effets, bien que par des voies détournées. Mais on peut poser la question plus simplement : si le mouvement réel n’est rien à l’extérieur de la pensée, comment peut-il être un « objet de connaissance » susceptible de nous intéresser? De deux choses l’une. Ou bien le « mouvement réel » est un concept qui nous aide à rendre compte de la réalité, parce qu’il a un référent dans l’objet et dans ce cas-ci, le mouvement réel « objectif » peut être connu et investigué. Ou bien il s’agit d’un pur concept, d’un strict jeu de l’esprit, et dans ce cas, il est oisif de s’y intéresser, parce que l’étude des apparences est tout ce qui compte. Mais cette deuxième alternative est une contradiction dans les termes, parce que l’apparence n’existe qu’en relation à l’essentiel, c’est-à-dire en relation à ce qui ne peut être connu que de façon médiatisée. Parler d’apparences, c’est déjà reconnaître qu’il existe autre chose à connaître, c’est reconnaître que le monde n’est pas épuisé par ce qui est caractérisé comme « formes d’apparition » ou comme « apparences ».
En effet, le concept de mouvement réel, qui est structurellement similaire à la catégorie logique d’essence, sert précisément à insister sur le caractère réfléchi de l’objet étudié. Parler d’essence ou de mouvement réel, c’est parler d’un objet en tant qu’il est médiatisé, c’est faire voir qu’il n’« est » pas simplement. À l’inverse, penser un objet complexe sur le mode de l’« être », comme une chose qui, simplement, est, plutôt que comme une chose qui n’est pas telle qu’elle apparaît, c’est être incapable d’en rendre compte correctement. En ce sens, dire, comme le fait TC, que le mouvement réel de la production capitaliste est un pur concept, qu’il n’y a rien qu’il lui corresponde à l’extérieur de la pensée, c’est ne reconnaître d’objectivité qu’aux phénomènes qui surgissent à sa surface. Mais encore une fois, c’est une position impossible à tenir pour qui pense ces derniers comme des formes d’apparition ou comme des apparences, parce que ces catégories impliquent leur « Autre », à savoir : le mouvement réel, ou l’essence, en tant que noyau rationnel, en tant que « quelque chose » qu’il s’agit précisément de connaître54.
Cette position de TC, bien qu’elle se réclame du nec plus ultra de la dialectique marxiste, n’est qu’une nouvelle occurrence de la position idéaliste subjective que raille Hegel dans sa Logique. Des sceptiques à Fichte, en passant par Kant, l’idéalisme subjectif a ceci de paradoxal qu’il mobilise des catégories liées à la logique de l’essence (phénomène, apparence, etc.) pour penser le contenu du monde (ce qui suggère que notre connaissance, en tant qu’elle a pour objet des apparences, n’est pas une connaissance satisfaisante du monde), mais se satisfait néanmoins, en pratique, de le penser sur le mode de l’être, c’est-à-dire comme quelque chose d’immédiat et de simplement donné, donc comme si les apparences épuisaient le monde :
Ainsi l’apparence – le phénomène [Phänomen, ndr] du scepticisme ou encore ce que l’idéalisme nomme phénomène [Erscheinung, ndr] – est une immédiateté qui n’est pas un quelque-chose ou n’est pas une chose, qui n’est pas du tout un être indifférent qui serait en dehors de sa déterminité et de sa relation au sujet. « C’est » : voilà ce que le scepticisme ne se permettait pas de dire ; l’idéalisme moderne ne se permit pas de regarder les connaissances comme un savoir de la chose-en-soi ; l’apparence évoquée ne devait pas avoir la moindre base d’un être, dans les connaissances à l’instant citées la chose-en-soi ne devait pas s’introduire. Mais, en même temps, [nos italiques, ndr] le scepticisme admettait des déterminations variées de son apparence, ou, bien plutôt, son apparence avait pour contenu toute la richesse variée du monde. De même, le phénomène dont parle l’idéalisme comprend en lui tout le champ de ces déterminités variées. Cette apparence-là et ce phénomène-ci sont immédiatement déterminés selon une telle variété. Ce contenu peut bien n’avoir pour fondement aucun être, aucune chose ou chose-en-soi ; pour lui-même, il reste tel qu’il est ; il a seulement été transposé de l’être dans l’apparence [nos italiques, ndr], de telle sorte que l’apparence a à l’intérieur d’elle-même les déterminités variées à l’instant évoquées, qui sont des déterminités immédiates, ayant un caractère d’étant, autres les unes par rapport aux autres. L’apparence est donc elle-même quelque chose d’immédiatement déterminé. Elle peut avoir tel ou tel contenu ; cependant, celui qu’elle a n’est pas posé par elle-même, mais elle l’a immédiatement. L’idéalisme leibnizien ou kantien, fichtéen tout comme d’autres formes d’idéalisme, ne sont pas allés davantage que le scepticisme au-delà de l’être comme déterminité, au-delà de cette immédiateté55.
Cette critique s’applique directement à TC. D’un côté, en parlant du monde qui l’entoure comme d’un monde phénoménal, comme du monde de l’apparence, TC reconnaît que celui-ci n’est rien par lui-même et qu’il ne doit son existence qu’à autre chose, à savoir : à l’essence elle-même. Mais de l’autre côté, TC nie que cette essence ait un quelconque rapport avec la détermination du monde phénoménal : le monde phénoménal est tel qu’il se donne, un point c’est tout, c’est l’unique pôle constituant la réalité. Autrement dit, on sait qu’il faudrait chercher plus avant pour connaître le monde tel qu’il est véritablement (c’est-à-dire en soi ou essentiellement), mais on nie en même temps que cette partie de la réalité – dont on suggère pourtant qu’elle existe – a une incidence sur le monde qu’il faut connaître. Le mouvement réel de TC, en tant « pur concret de pensée », donc en tant que concept privé de référent objectif, est à ce titre aussi impensable et inintéressant que la chose-en-soi l’est pour Kant. Or, la conséquence la plus grave de cette ontologie, c’est qu’en niant tout fondement objectif aux apparences et aux phénomènes, on échoue précisément à penser le caractère objectivement médiatisé des phénomènes et des apparences, c’est-à-dire le fait qu’ils ne doivent leur existence qu’à celle de rapports plus fondamentaux. On pense alors en pratique les apparences sur le mode de réalités subsistantes par soi, d’êtres-là, alors qu’il s’agit bien plutôt de phénomènes produits par le mouvement réel, lequel apparaît à travers elles. Pour le dire de façon plus précise, TC a parfaitement raison de dire que le mouvement réel « n’existe lui-même que par la totalité de ses formes56 », que « le mouvement réel ne se fait pas sentir en dehors, mais à l’intérieur de toutes les formes d’apparition de par leurs relations réciproques ». Le problème, c’est que TC néglige absolument la réciproque, à savoir le fait que ces formes d’apparition, ces apparences n’existent pas à l’extérieur du mouvement réel et que ce ne sont donc pas des réalités indépendantes. Parce qu’elle nie ainsi l’objectivité de l’un des deux pôles de l’essence (le mouvement réel) tout en parlant d’« apparences » et des « formes de manifestation », TC ne fait que traduire dans le langage de la médiation, dans la logique de l’essence, une conception réifiée, platement empiriste du monde.
Revenons à l’exemple du capital financier discuté plus haut pour bien mesurer les implications théoriques de l’ontologie técéiste. Dans cet exemple, nous avons vu que c’est du capital productif et, plus précisément, de la création de la plus-value qu’est tiré en dernière instance le profit que s’approprie le capital financier, bien que sous des formes modifiées (intérêts et rémunération du capital). Ce fait correspond au mouvement réel, c’est-à-dire aux choses telles qu’elles ont lieu malgré les apparences, malgré les représentations des agents et dont la « science » a précisément pour mission de rendre compte. À ce titre, il s’oppose précisément à l’apparence selon laquelle l’argent permet de faire de l’argent. Or, pour TC, le fait que le capital financier dépend structurellement du capital productif, le fait qu’il existe une différence entre travail productif et improductif, le fait que le prix des marchandises ne correspond généralement pas à leur valeur bien qu’il soit explicable par elle, tout cela est ontologiquement soluble dans ce qui, seul, aurait de la consistance : les apparences. Le monde objectif, ce qui existe à l’extérieur de la pensée, se résume à ce que nous appelons « apparences ». Le reste est une production théorique. En fait, ce que TC ne peut pas constater en regardant le téléjournal « n’est qu’un concept ». Les rapports de production? Un pur concept. L’exploitation capitaliste? Rien qu’un concept. La valeur? Une production strictement théorique. Et le salaire comme prix du travail maintenant? Ah… voilà la réalité ultime! Les rapports de prix? Le roc dur. Le travail du capitaliste comme source du profit industriel? Idem.
Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser TC à soutenir une position aussi étrange? On peut, comme première hypothèse, supposer que les incursions de TC sur le terrain de l’ontologie visent à protéger les apparences contre ceux et celles qui cherchent à les dénigrer en les tenant pour une partie seulement de la réalité, et sa partie la plus superficielle de surcroît. En effet,
bien souvent, avec les meilleures intentions du monde, la production théorique affirme le « mouvement réel » dans une sorte de négation dogmatique et condescendante des « apparences ». Les formes du fétichisme sont « exorcisées », mais non comprises comme formes d’apparition du mouvement réel ainsi que le mouvement réel seulement comme concept, dans la distinction radicale entre le procès de pensée et le procès réel57.
Il est vrai que « bien souvent », la production théorique, surtout en la personne de la critique de l’économie politique, a quelque chose de parfaitement cruel. Elle considère les apparences « avec condescendance » – c’est-à-dire qu’elle les traite pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire comme des apparences plutôt que comme le summum de la connaissance scientifique – et s’attache à rendre compte de son objet tel qu’il est réellement, plutôt que tel qu’il semble être. Ainsi, Marx d’affirmer :
Comme le lecteur l’a constaté à ses dépens, l’analyse des rapports internes réels du procès de production capitaliste est chose très compliquée qui exige un travail minutieux. Si c’est faire œuvre scientifique que de réduire le mouvement visible, simplement apparent au mouvement interne réel, il va de soi que dans les têtes des agents de production et de circulation capitalistes naissent nécessairement des conceptions sur les lois de la production qui, s’écartant complètement de ces lois, ne sont plus que le reflet dans leur conscience du mouvement apparent. Les idées d’un commerçant, d’un spéculateur en bourse, d’un banquier sont nécessairement tout à fait déformées ; celles des producteurs sont faussées par les actes de circulation auxquels leur capital est soumis par l’égalisation du taux général de profit. En plus, la concurrence joue nécessairement dans ces têtes un rôle tout aussi dénaturé. Si les limites de la valeur et de la plus-value sont données, il est facile de comprendre comment la concurrence des capitaux transforme les valeurs en prix de production, puis en prix commerciaux et la plus-value en profit moyen. Mais, sans ces limites, il est absolument impossible de comprendre pourquoi la concurrence réduit le taux général de profit à telle ou telle limite, à 15 % plutôt qu’à 1 500 %58.
Comme en atteste ce passage, ceux et celles qui s’occupent de production théorique sont amené·es à produire des connaissances qui contredisent les apparences59 et, en l’occurrence, celles selon lesquelles le prix des marchandises et le profit que s’approprie chaque capitaliste commercial sont d’abord déterminés par la vitesse de rotation de leur propre capital. Pour TC, il semble que ce type de négation des apparences soit le comble de la petitesse théorique, puisqu’on en reste, ce faisant, à exorciser les apparences. Or TC estime que son geste est théoriquement plus porteur : à la différence de ces dogmatiques qui s’intéressent d’abord aux liens internes « dissimulés » des phénomènes pour pouvoir ensuite montrer en quoi ces phénomènes sont des formes d’apparition du mouvement réel, TC maintient que les apparences sont les formes d’apparition… d’un concept, d’un « concret de pensée ». Pour les chercheur·ses dogmatiques à la Marx, les formes d’apparition traduisent la façon dont le mouvement réel se phénoménalise, sans se confondre avec ce mouvement lui-même. Ce qui revient à dire qu’elles ne sont pas le fin mot de l’histoire, mais qu’elles valent bien plutôt comme une invitation à chercher plus loin et à appréhender ce qui les explique elles. Pour TC au contraire, les formes d’apparition traduisent la façon dont le concept qu’est le mouvement réel se manifeste : le concept produit par les théoricien·nes, que TC posait comme strictement interne à la pensée, est maintenant présenté comme quelque chose qui se transmue et possède ses propres manifestations indépendantes et extérieures à la pensée60. C’est donc en retirant toute réalité au mouvement réel – lequel est justement susceptible de contredire les apparences – que TC démontre son respect et sa profonde considération pour ces dernières.
Mais cette motivation semble bien mince, compte tenu du nombre de pages consacrées à défendre l’idée que le mouvement réel n’appartient pas à la réalité. Tentons une deuxième hypothèse. S’il faut insister sur le fait que le mouvement réel n’existe nulle part ailleurs que dans la tête des critiques de l’économie politique, sur le fait que les apparences épuisent la réalité, c’est parce qu’en s’intéressant au mouvement réel, on est amené à produire une théorie qui secondarise les apparences et qui, corollairement, priorise l’essentiel. C’est précisément ce contre quoi s’élève TC. En effet, cela aurait pour conséquence fâcheuse de « postuler la nécessité d’une pureté de l’action au niveau de ce “mouvement réel » qui n’est pas d’ailleurs, plus “profond”61 ». Premièrement, il est évident, étant donné le point de vue de TC, qu’un pur concept ne peut être « plus profond » que des phénomènes objectifs. Deuxièmement, qu’est-ce que veut vraiment dire TC en disant que les gens tels que « Debord, Lefebvre, Kosik, Lukács, etc. et même Marx62 » postulent « la nécessité d’une pureté de l’action au niveau de ce “mouvement réel” »? Réfère-t-on à la façon dont ces auteurs ont cherché à identifier quels types de pratiques ou quelles formes de lutte étaient les plus à même d’abolir le capital, sur la base d’une analyse de ce en quoi consiste le mode de production capitaliste et de la conjoncture? Renvoie-t-on au combat théorique que Marx a mené pour s’attaquer aux Weitling et Proudhon de ce monde, lesquels en restent à la critique d’aspects superficiels de la société capitaliste? Peut-être aurait-il fallu, inversement, faire semblant qu’il existait quoi que ce soit de pertinent, du point de vue de la révolution communiste, dans ces situations où l’« On s’étripe parce qu’on est Français ou Allemand et on s’égorge à propos de l’Immaculée Conception63 »? Cet appel à faire « l’éloge » des apparences, à tenir compte du fait qu’on s’étripe parce qu’on est Français ou Allemand, à faire comme si le mouvement réel n’est rien d’autre qu’une idée, doit laisser absolument de glace quiconque cherche à comprendre la réalité sérieusement. Pour ces personnes, c’est précisément la connaissance du mouvement réel qui est première et qui permet seulement ensuite d’expliquer les apparences et les comprendre pour ce qu’elles sont : des phénomènes qui ne traduisent pas immédiatement ce dont il faut précisément rendre compte et ce qui, ultimement, les fonde. TC croit énoncer une vérité très profonde en opposant à Marx et à ceux et celles l’ayant suivi que « Personne ne vit, n’agit et ne lutte dans la pureté existante des rapports de production, ni les individus, ni les classes64 ». Mais qui suggère une telle chose? Qui a pu affirmer que les membres des classes vivent « dans la pureté existante des rapports de production », alors que les rapports de production sont précisément une abstraction – certes nécessaire et renvoyant à quelque chose de réel –, mais une abstraction quand même?
2. Précisions sur la conception técéiste des classes
2.1. Théorie des classes et matérialisme
La discussion du rapport entre mouvement réel et apparence que l’on retrouve dans TC no 27 aboutit pratiquement à la mise entre parenthèses des déterminants essentiels de la réalité sociale. En effet, puisque le mouvement réel n’est qu’une idée, un procès de pensée, il est évident que les éléments que l’on rangerait normalement parmi la rubrique du « mouvement réel » perdent par le fait même leur primauté explicative. Comment quelque chose de purement interne à la pensée pourrait-il déterminer le monde objectif? Inversement, et c’est précisément là l’effet que cherchait à créer TC, les éléments qu’on rangerait parmi la rubrique des « apparences » acquièrent une importance inversement proportionnelle dans la « constitution des classes » :
Contre des visions « puristes » (plus « althussériennes » qu’elles ne l’imaginent) faisant des classes un calque des rapports de production, l’existence de chaque classe intègre dans sa constitution, à partir de leur existence de « support », l’idéologie et l’existence des individus comme sujets et que c’est ainsi qu’ils agissent et luttent quotidiennement65.
Dire que la classe « intègre dans sa constitution […] l’idéologie et l’existence des individus comme sujets », et dire cela précisément en opposition aux visions « puristes », cela veut dire, dans le langage de TC, qu’il est théoriquement absurde de formuler des critères d’appartenance de classe basés sur la place occupée au sein des rapports de production (et de subordination), parce que « l’idéologie et l’existence des individus comme sujets » comptent tout autant.
Pourtant, TC doit bien savoir que « l’idéologie et l’existence des individus comme sujets » (la façon dont on se représente soi-même, le menu de la semaine, les loisirs qu’on pratique, la musique qu’on écoute, le quartier où on vit, etc.) n’entretient qu’un rapport indirect à l’appartenance de classe, et ce, au sens où tous ces éléments ne participent d’aucune manière à définir les classes. En effet, pas besoin de détenir un doctorat en théorie marxiste des classes pour savoir qu’un patron de cantine de village et ses employé·es peuvent plus ou moins « vivre de la même façon », tout en faisant partie de classes distinctes66. Pourquoi? Parce que la façon dont on vit, si elle participe certainement de la réalité des classes sociales, n’entretient aucun rapport nécessaire à l’appartenance de classe. Or, TC n’ignore probablement pas l’existence de ces rapports qui, eux, inversement, doivent absolument être pris en compte pour déterminer si tel ou tel groupe appartient à telle ou telle classe : les rapports de production et les rapports de subordination. Mais le problème du point de vue de TC, c’est qu’admettre tout cela, reconnaître que les classes sont définies par leur place au sein des rapports de production et de subordination et donc, au final, par le type de rapport qu’elles entretiennent à la reproduction de la totalité, l’obligerait à reconnaître qu’il existe des critères d’appartenance de classe stricts. Or, cela empêcherait nos camarades de parler du prolétariat de façon aussi légère et les forcerait à se poser la question : qui fait vraiment partie du prolétariat, des classes moyennes, de la classe capitaliste, étant donné ce qui définit chacune de ces classes? Il deviendrait alors impossible d’analyser un épisode de lutte sans, en même temps, chercher à identifier avec clarté les acteur·rices en présence. On comprend donc toute la résistance qu’on peut opposer aux démarches qui permettent d’opérationnaliser les concepts de classe et d’en faire des outils d’investigation de la réalité.
Ainsi, plutôt que de nier, par exemple, que les rapports de production et de subordination façonnent prioritairement la structure de classes d’une société, et donc que les rapports entre nations, religions, riches et pauvres, fans et calomniateurs de Lidl sont secondaires, TC affirme tout simplement qu’on ne peut distinguer le principal du secondaire :
Dans la constitution des classes, on ne peut pas séparer d’une part, l’historique, le conjoncturel, les aléas sociologiques, géopolitiques, culturels, et, d’autre part, le structurel (ou alors seulement comme la nécessité proprement intellectuelle de cette construction des classes). C’est le structurel lui-même qui produit, se reproduit, et n’existe que dans ses manifestations par laquelle seulement il se reproduit dans la lutte des classes. Mais si être une classe est une situation objective donnée comme une place dans une structure, parce que cela signifie une reproduction conflictuelle et donc la mobilisation de l’ensemble du mode de production, cela implique une multitude de rapports, qui ne sont pas strictement économiques, dans lesquels les individus vivent cette situation objective [purement intellectuelle?], se l’approprient et s’auto-construisent comme classe67.
En admettant qu’il existe quelque chose de l’ordre du « structurel » et du « conjoncturel » dans la construction des classes, donc de l’essentiel et de l’inessentiel, ou en admettant qu’« être une classe [?] est une situation donnée comme une place dans une structure », TC entretient l’illusion que sa conception des classes s’inscrit dans une problématique matérialiste. Mais cette illusion s’évanouit dès qu’on ajoute qu’on ne peut séparer le structurel (la place occupée au sein des rapports de production et de subordination) du conjoncturel (« les aléas sociologiques, géopolitiques, culturels ») dans la détermination de l’appartenance de classe. TC admet volontiers qu’il y a de l’essentiel et de l’inessentiel dans la constitution des classes, que certains éléments en « fondent » ou en « construisent » d’autres, mais ces catégories sont pensées d’une telle façon que leur essentialité ou non-essentialité ne se traduit jamais dans leur capacité plus ou moins grande à façonner et à définir les classes : on qualifie d’essentiels des rapports, mais sans tirer les conséquences nécessaires de leur essentialité. En ce sens, on ne voit absolument pas à quoi bon distinguer différents types de rapports s’ils concourent indifféremment et dans la même mesure à déterminer la réalité sociale. Pour être clair, TC dit bien, textuellement, que le travail productif « construit » ou « fonde » le prolétariat, mais étant donné les conséquences qui en sont tirées du point de vue du découpage de la société capitaliste en classes (c’est-à-dire aucune), on aurait tout aussi bien pu dire que la prestation de surtravail, le fait d’être sans-réserve, le fait de s’attaquer au capital, le fait d’être pauvre, le fait d’être salarié, etc. « construit » le prolétariat. En diluant le définitoire dans l’accessoire, en diluant les rapports de production et de subordination dans (ce que TC présente comme) leurs formes d’apparition, en diluant la place objective qu’occupent les agents dans l’expérience qu’ils en ont, on transforme la conception matérialiste des classes en blobfish.
Autrement dit, si c’est le cas que les rapports de production et de subordination ne sont pas les seuls à déterminer la réalité des classes – les rapports sociaux de sexe et de race, les rapports coloniaux, contribuent notamment à faire des classes ce qu’elles sont dans la réalité –, ce sont les seuls grâce auxquels les classes peuvent être effectivement délimitées, parce qu’ils atteignent l’essence des différentes classes, ce qu’elles sont par définition. Certes, cette place occupée au sein des rapports de production et de subordination n’épuise pas ce qu’il y a à dire à propos des classes, mais cela, tout simplement parce que l’essence n’épuise pas la réalité. Ce qu’il faut retenir, méthodologiquement, c’est que ce n’est qu’une fois cette étape franchie qu’il devient possible de s’intéresser à la réalité concrète des classes et de s’étendre sur la façon dont elles se décomposent, sur ses particularités historiques, conjoncturelles, etc. Ce n’est qu’à partir de ce point de départ qu’il devient possible de reconstruire théoriquement ce que sont effectivement les classes. Le propre de la méthode scientifique marxienne (pour utiliser de grands mots) est précisément de procéder par abstraction « dosée », c’est-à-dire d’accepter de ne s’intéresser, dans un premier temps, qu’aux éléments essentiels de la réalité, tout en sachant qu’on laisse ainsi inexpliqués des pans entiers de la réalité. Mais la reconstruction du concret dans la pensée auquel doit tendre la théorie, si l’on veut qu’elle tienne debout, ne doit pas saper ses propres fondations : elle doit tenir compte de l’ordre de détermination du réel, aller du déterminant vers le déterminé. Partir de la primauté des rapports de production et de subordination dans la construction des classes, ne jamais les laisser tomber une seule seconde, est la seule façon de ne pas se perdre dans l’infinie diversité des situations de classe. Et c’est précisément ce que TC ne voit pas.
En effet, quelle est l’alternative? Premier choix. On reconnaît que les classes peuvent être définies et que, de ces définitions, découlent des critères d’appartenance, ce qui nous permet de discriminer leurs membres respectifs. On peut alors dire : voici une prolétaire, voici un membre de la classe moyenne indépendante et ainsi de suite. Il existe bien entendu des cas limites, des situations de classe objectivement difficiles à trancher. Mais en choisissant cette voie, on fait aussi le choix d’affiner nos analyses et, partant, nos propres conceptions des classes, plutôt que d’abdiquer devant les difficultés. Deuxième choix. On ne fait rien de tel, parce que les classes « n’ont pas d’être », parce qu’elles ne « sont pas des substances », parce qu’elles sont bien trop complexes pour être saisies par de pauvres définitions, parce que parler de rapports de production et de subordination a un accent trop « programmatiste ». Or, puisqu’il n’existe aucune façon de discerner, avec un minimum de précision, les frontières entre les classes, on se rabat sur ses propres préconceptions de ce que sont les classes, on se rabat sur un « flou étudié »… Le prolétariat, c’est donc tantôt les ouvriers de Renault aux mains calleuses, tantôt les piqueteros, tantôt les émeutiers de 2005, tantôt les paysans andins, tantôt les petits commerçants ruinés, tantôt les chômeurs, tantôt les Palestinien·nes pris en bloc, tantôt les « jeunes », etc. Selon quels critères : être salarié? être employé·e par du capital? être pauvre? occuper une place subordonnée? effectuer un travail manuel? être sans-réserve? être ouvrier? TC nous laisse dans un « flou savamment étudié ». Mais de tout manière, on n’aurait jamais pu le savoir, parce qu’il se trouve que « le prolétariat se définit lui-même », « est pratiquement sa propre production » et « excède toutes ses définitions68 ». Ce qui revient à dire, en pratique, qu’on peut appeler prolétariat tout et n’importe quoi. Et de fait, ces catégories sociales-là apparaissent à TC comme faisant partie du prolétariat et TC, particulièrement attentive aux apparences, n’en demande pas plus. Il est toujours très commode que l’objet que l’on cherche à connaître se définisse lui-même, s’auto-produise et excède toutes ses définitions, car cela nous libère de la tâche de chercher à le définir pour nous-mêmes et de vérifier ensuite si nos définitions valent quelque chose.
Il faut insister, c’est seulement en produisant des définitions claires des différentes classes qu’on peut s’aider, en pratique, du concept de « classe » pour faire l’analyse de l’activité des groupes en lutte. Or, c’est précisément là le rôle d’une théorie des classes : permettre d’appréhender les pratiques structurantes grâce auxquelles la société capitaliste contemporaine se reproduit et peut être abolie, mais surtout, pouvoir rendre compte des luttes particulières que mènent les classes. En sachant ce qu’est une classe et qui la compose effectivement, nous sommes alors à même de repérer, dans des épisodes de luttes donnés, cette même classe en action. Il devient alors possible, pour telle ou telle lutte, d’évaluer dans quelle mesure les membres du prolétariat luttent conformément à leurs intérêts ou prennent des mesures à même d’abolir le capital, dans quelle mesure ils sont embarqués dans un projet qui, à terme, se révélera incompatible avec la défense et la promotion conséquentes de ces mêmes intérêts ou, même, dans quelle mesure ils prennent part à un projet qui ne les regarde en rien. Certes, on pourra trouver que ces formulations ont quelque chose d’un peu trop « normatif », ou qu’elles évoquent une volonté « d’intervenir » malvenue. Mais ces scrupules n’ont pas leur place ici. Il faut que nous puissions reconnaître, clairement et simplement, que nous sommes intéressé·es au succès de la révolution communiste mondiale – aussi éloignée cette perspective soit-elle – et que c’est à l’aune de cet intérêt que notre pratique théorique prend son sens. Or, présenté ainsi, le critère de pertinence d’une théorie des classes coule de source : du point de vue de la communisation, est pertinente une théorique des classes nous aidant à rendre compte, de façon relativement précise, de la structure de classes d’une société donnée; est pertinente une théorie nous aidant à clarifier, lorsqu’elles éclatent, les tenants et aboutissants des luttes; est pertinente une théorie nous aidant à cerner les perspectives de rupture d’avec le cours quotidien de la lutte des classes et, partant, les perspectives de succès d’un mouvement révolutionnaire.
Autrement dit, on ne s’intéresse pas à la théorie des classes pour le plaisir, mais parce qu’elle nous permet de mieux saisir la réalité dans sa complexité. Il faut que TC nous éclaire sur ce point : si ses contributions théoriques relatives aux classes ne permettent même pas de distinguer une classe d’une autre dans une lutte concrète, à quoi servent-elles? Pourquoi écrire un numéro complet sur le rôle de la vie quotidienne dans la constitution des classes si, malgré toutes ces sophistications apparentes, on ne saura jamais qui, parmi les Gilets jaunes par exemple, appartenait au prolétariat, à la classe moyenne indépendante, à la classe moyenne subordonnée ou encore à la classe moyenne subordonnante? TC prétend parler de la lutte des classes, des luttes du prolétariat, de l’interclassisme, mais en niant la possibilité de circonscrire les classes elles-mêmes, elle s’interdit par principe d’en dire quoi que ce soit.
2.2. La réification de la classe ouvrière et l’évanescence du prolétariat
Jusqu’ici, nous avons vu que TC s’efforce de montrer que la vie quotidienne, l’idéologie, le conjoncturel et l’historique ont un effet sur la constitution des classes et que cet effet est si important qu’il serait insuffisant, donc erroné, de définir les classes par la place qu’elles occupent au sein des rapports de production et de subordination. Aussi faudrait-il nuancer tout cela, cesser de faire des classes « un calque » de ces rapports et s’adonner à des recherches sérieuses. Mais encore une fois, que retrouvons-nous chez TC qui puisse venir pallier ces insuffisances? Que lisons-nous qui puisse nous aider à mieux établir la démarcation entre les classes? Où trouvons-nous une proposition positive, même embryonnaire, de ce que à quoi pourrait ressembler non seulement le prolétariat, mais aussi les classes moyennes et la classe capitaliste, sachant désormais que les classes ne sont pas un calque des rapports de production (et de subordination)? De telles propositions, chez TC, brillent par leur absence, alors que c’est précisément en se confrontant au problème des limites des classes que la nécessité de critères d’appartenance de classe clairs se serait faite sentir69. En revanche, nous avons eu droit, au sein du texte revenant explicitement sur le deuxième numéro de Temps Libre, à des développements inédits sur la nature bien particulière de l’une des classes du mode production capitaliste, à savoir : le prolétariat. Si ces passages ne nous aident en rien à avoir une idée plus claire de ces fameux·ses prolétaires, ils nous aident, en forçant TC à se mouiller, à mieux comprendre ce que nos camarades veulent vraiment dire par « prolétariat ».
Ainsi, afin de nous éclairer sur ce qu’est effectivement une telle classe, TC juge nécessaire de l’opposer à la classe ouvrière, elle-même jamais clairement définie, mais parfois identifiée en bloc aux travailleur·ses productif·ves70 :
Alors que sur la base de la contradiction qu’est pour lui-même le travail productif (…), le prolétariat c’est, dans un premier temps encore objectif, la classe ouvrière se retournant contre elle-même comme catégorie économique dans sa contradiction de catégorie économique [sic] avec le capital. Mais alors elle devient autre, le prolétariat n’est pas un simple moment d’une théodicée nécessaire de la classe ouvrière. Toutes les conditions objectives (économiques) du mode de production sont là et elles sont déterminantes, mais les classes acquièrent, de par ces bases objectives même dans leur existence et métamorphoses propres, une existence qui ne se confond pas avec ces catégories de l’économie politique et leurs contradictions. Le prolétariat se définit lui-même, il est pratiquement sa propre production, il excède toutes ses définitions parce que toutes les définitions deviennent des pratiques convoquant les individus et les re-définissant comme sujets71.
Cherchons à comprendre. Nous avons d’abord la classe ouvrière, classe correspondant selon TC à l’ensemble des travailleur·ses productif·ves, bien que cette correspondance ne soit jamais justifiée. Cette classe inclut par conséquent, chez TC, une partie des agents que nous excluons nous-mêmes du prolétariat, à savoir les travailleur·ses productif·ves effectuant un travail de subordination (contremaîtres, gérant·es, surveillant·es, ingénieur·es, gardien·nes de sécurité, etc.). En effet, bien qu’ils puissent être exploités et produire de la plus-value, ces agents se font les exécuteurs de la volonté du capital, ce qui les lie à ce dernier et les exclut du prolétariat. Plutôt que d’être, comme ce dernier, pur objet de la domination du capital, ces agents prennent sur eux de réaliser sa domination : ils font non seulement respecter son autorité dans le cadre du procès de travail, mais en protégeant la propriété privée et en confirmant le dénuement des prolétaires, ils font en sorte que ces dernier·ères doivent retourner vendre leur force de travail et ainsi, faire fructifier le capital. Pour TC toutefois, ces agents sont bel et bien des ouvrier·ères, c’est-à-dire, comme nous le verrons, des individus amenés à devenir prolétaires.
Selon TC toujours, la classe ouvrière serait une « catégorie économique ». Cette idée a quelque chose d’étrange. Dire que les classes sont entièrement définies par la place qu’elles occupent au sein des rapports de production est certainement réducteur, donc faux, mais cela reste une proposition qui n’est pas dénuée de sens. Mais dire que les classes elles-mêmes sont entièrement solubles dans l’économie, qu’elles sont des catégories économiques, personne ne peut le penser sérieusement : les classes sont toujours des classes sociales, c’est-à-dire des groupements sociaux occupant une place déterminée au sein de la société. En tant que groupe de la société, la classe capitaliste n’est pas réductible à sa fonction économique, même si cette dernière nous permet d’en saisir les traits essentiels.
Il est remarquable que la classe ouvrière soit la seule classe identifiée de façon aussi unilatérale à une catégorie économique. Pourquoi? Parce que TC veut montrer que le prolétariat et la classe ouvrière viennent du même substrat, tout en appartenant à deux « niveaux » différents, économique puis politique :
Le prolétariat est un concept politique. Tous les économistes et sociologues peuvent débattre de ce que sont le mode de production capitaliste, le travail productif ou même la classe ouvrière. Le concept de prolétariat est autre72 .
Ce qui est sous-entendu ici, c’est que la classe ouvrière serait la face objective, économique du prolétariat, sa base terrestre, tandis que le prolétariat serait la face politique, la version consciemment révolutionnaire de la classe ouvrière : la classe ouvrière devenue « sujet révolutionnaire ». Là où la classe ouvrière, en tant que catégorie économique, peut être l’objet des « économistes et sociologues », le prolétariat déborde de leur cadre d’analyse étroit :
le prolétariat est un moment interne, dans le cours de la lutte des classes, de conflits de la classe ouvrière avec elle-même dans sa contradiction avec le capital (ou, si l’on veut, du travail productif avec lui-même)73.
Cela implique que le prolétariat, en tant que « moment interne » de la classe ouvrière, n’existe ni indépendamment d’elle ni hors des périodes de crise. Par conséquent, lorsque la classe ouvrière travaille tranquillement, lorsqu’elle revendique pour un meilleur salaire ou de meilleures conditions de travail sans toutefois « se retourner contre elle-même » – c’est-à-dire 99 % du temps –, les prolétaires n’existent pas. On ne les rencontre nulle part. Tout ce qu’on peut observer dans les rues, à la quincaillerie, dans le transport en commun, ce sont de simples ouvrier·ères. On peut toujours tomber sur des capitalistes, des membres des classes moyennes, mais pas sur des Prolétaires. Il faut attendre ce moment apocalyptique (ou béni) où la classe ouvrière entre en conflit avec elle-même pour que les Prolétaires fassent enfin leur apparition : ce sont des ouvrier·ères transfiguré·es par leur volonté d’en découdre avec le capital74.
Cette distinction entre classe ouvrière et prolétariat, cette version réchauffée de la distinction entre classe en soi et classe pour soi, ne sert qu’à solutionner, par un tour de magie, la difficulté qu’il y a à penser à la fois une classe de la société capitaliste comme une classe réellement existante et comme une classe révolutionnaire. Plutôt que de s’attarder à ce qui peut bien faire de certains groupes réellement existants de la société des groupes révolutionnaires, TC crée sur mesure une « classe révolutionnaire » – le prolétariat – tout en négligeant de s’assurer que cette classe existe. Inversement, TC nous parle bien d’une classe réelle – la classe ouvrière –, mais ajoute que cette classe ne peut pas être une classe révolutionnaire. En effet, si l’on pouvait montrer que la classe des travailleur·ses productif·ves subordonné·es était, étant donnée sa situation, une classe révolutionnaire, on n’aurait pas besoin de la version fumeuse du prolétariat que nous sert TC. Or, cette classe n’a, paraît-il, rien de révolutionnaire. Et qu’est-ce qui, pour nos camarades, empêche le seul groupe réel de la société capitaliste susceptible d’être révolutionnaire de l’être effectivement? Une mystérieuse « propension spontanée de la classe ouvrière à demeurer une catégorie socio-économique du mode de production capitaliste75 ». Et ce, par opposition au prolétariat, immédiatement identifié au sujet révolutionnaire. En voulant montrer que le sujet révolutionnaire ne peut être rapporté à une classe définie par la place qu’elle occupe dans les rapports de production et de subordination, TC va jusqu’à faire jouer l’une contre l’autre la classe ouvrière et le prolétariat. Résultat :
Le prolétariat ne se confond pas avec la classe ouvrière ou les travailleurs productifs, les pratiques par lesquelles il existe peuvent même entrer en conflit avec celles de fractions de la classe ouvrière : Juin 1848, La Commune, Allemagne 1919, Espagne 1936-1937, Italie 1969-1970. Dans une crise révolutionnaire, les travailleurs productifs peuvent parfaitement être amenés à défendre toutes les formes de socialisation autogestionnaire de la production, comme, toutes proportions gardées, en Argentine en 2001, face aux organisations piqueteros76.
Si la classe ouvrière – cette classe que TC fait correspondre aux travailleur·ses productif·ves – s’oppose ainsi aux velléités révolutionnaires du prolétariat, alors c’est bien en ce dernier qu’il faut placer nos espoirs révolutionnaires. Le problème, c’est que ce prolétariat-là n’est malheureusement ni une classe du mode de production capitaliste ni même une classe tout court. C’est tout simplement le concept de ceux et celles qui feront la révolution. Le fait parfaitement banal qu’une classe révolutionnaire puisse rassembler des individus apathiques et même contre-révolutionnaires, cela ne semble pas avoir effleuré l’esprit de nos camarades. D’où le fait que TC exclut et isole de la « classe ouvrière » (c’est-à-dire de la masse des prolétaires réels) les prolétaires qui seront effectivement révolutionnaires, en fait un groupe distinct, et les oppose ensuite à la classe ouvrière. Aussi existerait-il en réalité deux groupes, ou deux classes ne correspondant pas aux mêmes personnes : la classe ouvrière, à propension contre-révolutionnaire, et le prolétariat, à propension révolutionnaire. À partir de là, TC prend un air de triomphe et nous dit : vous voyez bien qu’il n’y a rien de révolutionnaire dans le fait, pour le prolétariat, d’être la classe du travail productif subordonné, car de nombreux exemples historiques [!] montrent que les travailleur·ses productifs se sont opposé·es aux révolutionnaires, c’est-à-dire aux prolétaires! En tant que catégorie économique heureuse de l’être, la classe des travailleur·ses productif·ves ferait tout pour rester une catégorie économique. Il est donc faux de penser que ce qui définit le prolétariat, en tant que classe révolutionnaire, serait la réalisation du travail productif subordonné. CQFD. Mais posons une petite question à nos camarades : TC peut-il nous en apprendre davantage sur ces mystérieux « prolétaires » révolutionnaires, auxquels « s’opposait » la classe ouvrière durant tous ces exemples historiques? Nos propres connaissances historiques rudimentaires nous poussent précisément à penser que ces « prolétaires » étaient pour leur plus grande part… des ouvrier·ères luttant de façon révolutionnaire77.
On voit donc que la façon dont TC pense ici le prolétariat supprime la difficile question, évoquée plus tôt, à laquelle toute théorie des classes communiste doit nécessairement répondre : comment faire le lien entre ce qui définit une classe du mode de production capitaliste – le prolétariat – et sa capacité à faire la révolution? Pour nos camarades, le besoin théorique de formuler des critères d’appartenance de classe afin d’identifier le prolétariat ne se fait jamais sentir, parce que celui-ci surgit des entrailles de la classe ouvrière et se retourne contre elle pour la retrouver ensuite de l’autre côté de la barricade. Concept foncièrement politique, entité évanescente, le prolétariat échapperait par définition à toute analyse de classes, à tout travail qui chercherait à rendre compte de ce qu’est le prolétariat dans les sociétés contemporaines. On n’a donc aucunement à montrer comment, parmi les classes réellement existantes du mode de production capitaliste, l’une d’entre elles est en mesure d’abolir le capital. Il suffit d’invoquer le « prolétariat », en tant que « moment » ou « fonction présente » de la classe ouvrière, en tant qu’entité qui est « pratiquement sa propre production », qui « excède toutes ses définitions » et le tour est joué. La question n’a pas trouvé de solution, on l’a simplement court-circuitée en hypostasiant en une soi-disant classe (le prolétariat de TC) l’ensemble des individus agissant de façon révolutionnaire.
Mais qu’est-ce que le prolétariat, s’il n’est pas « la classe ouvrière se retournant contre elle-même comme catégorie économique78 », s’il n’est pas « la classe ouvrière en contradiction avec sa propre existence79 »? Le prolétariat, c’est ni plus ni moins que la classe des travailleur·ses productif·ves subordonné·es. Il ne renvoie ni d’abord à un mode de vie ni à une forme d’activités salariées, comme le fait par exemple le concept de classe ouvrière, concept ayant valeur strictement sociologique. Il renvoie à une place dans la reproduction de la totalité capitaliste, elle-même définie par les rapports de production et de subordination. TC a donc raison de dire que le concept de prolétariat appartient à un champ théorique distinct, mais se trompe en affirmant que c’est parce qu’il serait plus « politique » et, on imagine, moins « économique ». Bien au contraire, le concept de prolétariat appartient au même champ théorique que celui de mode de production : ils permettent tous deux de rendre compte de la reproduction de la totalité capitaliste et, surtout, de cette reproduction dans ce qu’elle a de problématique. Il n’y a pas d’un côté, l’analyse de la société capitaliste dans son fonctionnement harmonieux, avec ses catégories économiques immanentes capables de se reproduire éternellement, et de l’autre, l’analyse de la révolution comme pur événement avec ses héros venant faire éclater le vieux monde. La théorie des classes (réellement existantes) du mode de production capitaliste est en même temps une théorie de la révolution, parce qu’elle définit les classes en fonction de leur rôle dans la reproduction de la société et, partant, de leur capacité et de leur propension à la transformer (ou non) dans un sens révolutionnaire.
Dans la mesure où le prolétariat est une classe « réellement existante », on peut donc tout à fait l’observer, la circonscrire, la dénombrer et l’étudier80. C’est une classe qui, en produisant de la plus-value, reproduit matériellement le capital et qui, étant donné sa position subordonnée – sans laquelle la prestation de plus-value à grande échelle serait tout bonnement impossible –, est structurellement amenée à entrer en conflit avec les classes qui profitent de son exploitation, que ce soit directement (avec la classe capitaliste) ou indirectement (avec la classe moyenne subordonnante). Or, le prolétariat, dans ses tentatives de rendre son existence vivable, est la seule classe qui est non seulement amenée à s’attaquer au capital lui-même, mais également en mesure de l’abolir, en s’emparant et en transformant les moyens de production qui valaient jusque-là comme du capital, et ainsi organiser la production sur une autre base et en vue d’autres fins. En ce sens, ce qui définit le prolétariat comme classe du mode de production capitaliste – être la classe du travail productif subordonné – est aussi ce qui fait de lui une classe révolutionnaire. Cela, non pas au sens où les prolétaires sont ceux et celles ayant à tout instant la plus grande propension à se révolter, ni au sens où la totalité des prolétaires ont fait et feront à eux et elles seul·es toutes les révolutions à caractère anticapitaliste, mais au sens où le prolétariat est la seule classe effectivement en mesure de communiser la société. S’il existe clairement un recoupement entre l’extension du groupe « prolétariat » et celle du groupe des révolutionnaires, leur extension ne sont nullement identiques. Le fait d’être prolétaire n’implique pas que l’on sera révolutionnaire. Le fait de ne pas être prolétaire n’implique pas que l’on ne sera pas révolutionnaire, parce qu’on peut parfaitement être prolétaire et lutter contre les membres de sa classe, de la même manière qu’un membre de la classe moyenne subordonnante peut lutter contre sa classe.
En fait, lorsque nous disons que le prolétariat est une classe révolutionnaire, nous raisonnons en termes structurels, nous ne nous intéressons pas à ce que chacun des membres de chacune des classes fait effectivement. Ainsi, dans une lutte insurrectionnelle, les travailleur·ses productif·ves subordonné·es qui veulent triompher de la réaction, étant donné la place qui est la leur, non seulement peuvent, mais doivent s’attaquer matériellement au capital, le détruire et le transformer selon leurs besoins. Mais il n’en va précisément pas ainsi des membres des autres classes. Pourquoi? Parce que la place occupée au sein de la structure de classes, donc la place occupée au sein de la reproduction de la société capitaliste, définit à grands traits le registre du possible et du nécessaire pour les individus qui luttent en tant que membres d’une classe. Lutter en tant que membre du prolétariat impose certaines contraintes et ouvre certaines voies qui sont fermées à ceux et celles qui, par exemple, le font en tant que membre de la classe moyenne indépendante (CMI), c’est-à-dire qui cherchent à promouvoir leurs intérêts de producteur·rices et de commerçant·es indépendant·es.
Clarifions notre pensée avec un exemple. Dans une période de crise sociale et de blocage massif de la production, peu de temps sera nécessaire avant que les prolétaires, en tant que sans-réserves, finissent par « nier » la propriété privée et par s’approprier les moyens de subsistance sans lesquels leur survie immédiate devient impossible. De la même manière, les mêmes personnes seront rapidement forcées de prendre possession de ce qui valait autrefois pour du capital et de l’utiliser pour transformer, produire et transporter ce qui doit l’être pour mettre en échec les forces contre-révolutionnaires81. Que la lutte qui les oppose à la réaction capitaliste soit victorieuse ou non, les prolétaires n’ont, en procédant ainsi, aucun intérêt de classe à sacrifier82. En cas d’échec, les prolétaires seront au moins parvenu·es, pendant un temps, à subvenir à leurs besoins autrement qu’en étant exploité·es, donc sans avoir eu à fournir de surtravail au capital. Et en cas de succès, les prolétaires auront rendu leur exploitation tout bonnement impossible et se seront, par le fait même, « auto-aboli·es ».
À l’inverse, les membres de la CMI ne peuvent avoir recours à cette solution sans lutter contre leurs propres intérêts de classe. En laissant la propriété privée des moyens de production et d’échange être attaquée, les producteur·rices et commerçant·es-propriétaires assistent à la sape de leur position sociale spécifique83. En effet, si la propriété privée est pratiquement abolie, parce que tout est constamment redistribué en fonction des nécessités pressantes de la lutte, alors plus aucun individu ne peut faire reconnaître la légitimité de son appropriation unilatérale d’une partie de la richesse sociale : sa capacité à valoir et à être reconnu comme un producteur ou commerçant indépendant disparaît. Or, cette situation oblige précisément les ex-indépendant·es à « travailler » en commun et à renoncer à la liberté (plus ou moins réelle) qu’ils et elles possédaient dans la détermination concrète des fins et des modalités de leurs activités. La CMI, en tant que classe du mode de production capitaliste, ne peut survivre aux épisodes insurrectionnels sans lutter activement pour le maintien de la propriété privée.
De la même manière, étant donné la position hautement défavorable à partir de laquelle s’engage toute lutte ouverte et franche avec l’État, il est évident que les insurgé·es ne peuvent venir à bout de leurs adversaires sans faire preuve d’un haut degré d’initiative et d’imagination politique. Or, en s’auto-organisant, en décidant pour et par eux-mêmes, les membres des classes subordonnées rendent inopérante la division entre travail manuel et travail intellectuel, celle qui les pousse à adopter une attitude de passivité face à la place qu’ils occupent au sein des rapports d’exploitation. Inversement, la classe moyenne subordonnante (CMS) est précisément redevable de l’existence d’une hiérarchie sociale stricte, elle-même garante de la reproduction de ses privilèges sociaux et, de façon dérivée, matériels. D’un côté, les membres de la CMS qui voudraient continuer à lutter en tant que tels n’auraient donc pas le choix de s’opposer à l’auto-organisation des insurgé·es, puisque cette auto-organisation supprime la distinction entre spécialistes et simples exécutant·es, entre ceux et celles « qui savent » et les autres. De l’autre, une partie importante de la CMS a intérêt à ce que l’exploitation du prolétariat reprenne, car autrement, le sursalaire dont cette partie bénéficie s’évanouirait. Autrement dit, alors que les membres des classes subordonnées n’ont pas le choix de nier pratiquement la division entre travail manuel et travail intellectuel afin de lutter de façon efficace, les membres de la CMS n’ont pas le choix, s’ils tiennent à rester tels, de saboter ou de détruire les formes d’auto-organisations que se donnent les insurgé·es.
Encore une fois, le fait que le prolétariat soit une classe révolutionnaire – le fait qu’il soit placé dans une position où l’aggravation de ses luttes pour améliorer son sort le force à prendre des mesures communisatrices – n’implique pas que tous et toutes les prolétaires prendront de telles mesures, ni que ce seront les seul·es à le faire. Par contre, cela nous indique que c’est précisément les luttes du prolétariat contre son exploitation, auxquelles seront certainement amenés à prendre part les membres d’autres classes, qui sont susceptibles de mener à l’abolition du capital et à l’abolition du prolétariat lui-même. C’est que le prolétariat ne peut jamais trouver de repos, de satisfaction définitive, sans supprimer ce qui le produit comme tel. Et contrairement à la classe moyenne subordonnée notamment, son alliée naturelle, le prolétariat trouve précisément dans sa situation le moyen de « supprimer ce qui le produit comme tel ».
***
En guise de conclusion
Quelques mots maintenant pour clore cette discussion du dernier numéro de TC. L’appréhension des classes, on s’en rend bien compte, ne va absolument pas de soi. Il est certes facile de proposer une division de la société en groupes en établissant pour cela tel ou tel critère. Mais on n’obtient pas pour autant une théorie des classes : une telle théorie engage nécessairement une théorie de la société et de sa reproduction. Et dans le cas de ceux et celle qui aspirent à l’abolition révolutionnaire du mode de production capitaliste, la théorie de la révolution ne peut pas davantage être tenue à l’écart.
Mais pour s’en apercevoir de façon indépendante, il faut bien souvent s’être soi-même frotté à cet épineux problème. Dans notre cas, il a fallu que nous soyons amené·es à faire l’analyse d’un mouvement de grève (étudiante), nous engageant directement, pour que nous saisissions la mesure de notre ignorance en ce qui avait trait à la composition de classe, non seulement de cette lutte, mais de la société québécoise en général. C’est là que s’est fait sentir le besoin théorique qui allait donner naissance au deuxième numéro de Temps Libre. Si le travail de Théorie Communiste nous est apparu comme une référence obligée, il en est allé de même de celui de Bruno Astarian et de Robert Ferro, dans Le ménage à trois de la lutte des classes. Mais autant nous avons profité de leurs travaux respectifs, autant ils nous semblaient sujets à discussion, voire simplement problématiques. Notre deuxième numéro en constitue précisément le témoignage. Or, dans une perspective communiste, on ne cherche pas tant à en apprendre sur les classes par amour désintéressé du savoir que pour se donner les moyens de penser la réalité sociale dans ce qu’elle a de contradictoire et de potentiellement explosif. Il fallait alors nous prouver que ce que nous avions appris des classes pouvait nous servir à faire l’analyse de formations sociales déterminées et, en l’occurrence, du Québec. C’est de là que notre plus récent numéro tire son origine.
Pourtant, ce dernier n’est pas réductible à l’application d’une théorie « clés en main » à un matériau empirique docile. Bien plutôt, il s’est avéré que nos propres conceptualisations des classes étaient encore inadéquates – c’est-à-dire incapables de rendre compte de phénomènes marquants de la division sociale du travail84 – et réclamaient, à ce titre, d’être retravaillées. Notre ferme conviction, c’est que c’est justement dans cette direction-là que la théorie communiste peut progresser. Sans cette confrontation inévitable avec l’empirie, la théorie peut bien demeurer cohérente, mais elle se condamne par le fait même à une auto-référentialité dangereuse, si ce n’est à la stérilité.
Or, le corrélat de la fermeture de la théorie sur elle-même et sur les abstractions qu’elle produit c’est, paradoxalement, une fuite en avant dans un empirisme exacerbé. Parce qu’un tel type de production théorique se confine à un niveau de généralité qui laisse totalement indéterminée la façon dont la société se divise en classes, et donc, l’appartenance de classe de tel ou tel groupe concret, elle n’a pas le choix d’abandonner ce niveau d’analyse pour se rabattre immédiatement sur la discussion des éléments les plus dérivés de la réalité des classes : la vie quotidienne de leurs membres. Dans la mesure précisément où elle s’est retiré tout moyen de trancher sur l’appartenance de classe des individus concrets, une production théorique de ce genre ne peut ramener les éléments entrant dans leur vie quotidienne à leur situation de classe et les expliquer par cette situation. Il lui faut au contraire se cantonner à l’analyse de la surface de la réalité et à la penser dans ses termes à elle, c’est-à-dire dans des termes superficiels, parce que coupés de ce qui lui donne un sens : la place qu’occupent les individus au sein des rapports de production et de subordination. Le matériau approprié à cette forme de connaissance est précisément un matériau qu’on reçoit sans poser de question, pris tel qu’il se donne. Donc si, d’un côté, on voit le prolétariat à l’œuvre dans n’importe quelle émeute, de l’autre, dès qu’il s’agit d’analyser un épisode de lutte des classes complexe, on parlera bien plutôt d’employé·es, de profs, de, chômeur·ses, d’étudiant·es, de déclassé·es, d’ouvrier·ères ou de paysan·es. Pourquoi? Parce qu’on a fait en sorte que le concept de classe perde sa capacité à rendre compte de la réalité de la lutte des classes, ce qui implique que l’analyse ne peut plus s’aider que des notions qu’utilisent les journalistes. C’est ainsi qu’on assiste à un va-et-vient constant et non médiatisé entre des catégories sociologiques purement descriptives, acritiques, et des notions aussi chargées que celles de prolétariat.
Pour s’en sortir, il faut prendre au sérieux le problème de la division en classes de la société et cesser de faire comme si ces dernières relevaient de l’évidence : les classes ne s’observent pas directement, elles doivent être théoriquement construites. Et c’est seulement en formulant des critères d’appartenance de classe tirés de ce qu’elles sont par définition, et de façon à pouvoir cibler leurs membres, qu’il devient possible de faire le pont entre ce que chacune d’entre elles est d’après son concept et ce qu’elles sont effectivement. L’abîme entre le prolétariat – cette classe prise dans un rapport d’implication réciproque avec le capital et formant l’élément négatif de la totalité sociale – et les prolétaires empiriques – les livreur·ses, les machinistes, les ouvrier·ères agricoles, etc. – peut alors être résorbé. Cette résorption non seulement peut, mais doit avoir lieu, car il en va du droit à l’existence d’une théorie des classes spécifiquement communiste. Nous espérons pouvoir continuer à travailler collectivement en ce sens.
Montréal, janvier 2026
1. Ce qui n’a pas empêché TC de nous accuser de… dogmatisme, cf. « Les classes en général, le prolétariat en particulier et quelques autres choses. (Commentaires critiques du no 2 de la revue Temps libre: « Contribution à la théorie des classes »), Théorie Communiste, no 27, p. 327.
2. « Vie quotidienne et luttes des classes. Éloge des “apparences” et de la confusion », TC, no 27, p. 29.
3. Le recours au couple production-reproduction a quelque chose d’équivoque, car il recouvre des distinctions qui ramènent à des niveaux d’abstraction différents. Dans le cadre du deuxième livre du Capital par exemple, la production et la reproduction ont toujours strictement lieu dans le « champ » de l’économie : la production est procès de production de capital et la reproduction, circulation du capital-marchandise, et ce, telle qu’elle permet la reprise de la production elle-même. Or, le sens dans lequel TC entend « instances de la reproduction » est beaucoup plus concret et s’apparente à la façon dont les pense Althusser, à savoir comme ce qui assure la reproduction des rapports de production. Du point de vue de la reproduction de rapports sociaux historiquement déterminés, la reproduction mobilise des éléments qui n’appartiennent pas d’abord au champ de l’économie, sinon à la théorie de la société capitaliste au sens large. La famille, l’école, la politique, les syndicats, les partis, en tant qu’appareils grâce auxquels le pouvoir du capital se maintient, voilà ce qui se situe au cœur de la reproduction des rapports de production. Cf. Louis Althusser, Sur la reproduction, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Actuel Marx Confrontation », 1995, p. 156.
4. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27,p. 34.
5. « Avant-propos », TC, no 27, p. 10.
6. Sur la notion de surdétermination, cf. infra.
7. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 41-42.
8. « Avant-propos », TC, no 27, p. 9.
9. Ibid., p. 9.
10. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 37.
11. « Avant-propos », TC, no 27, p. 13.
12. Ibid., p. 13.
13. Au Québec, comme c’est par exemple le cas de la FTQ, certains syndicats ont été jusqu’à s’intégrer consciemment aux circuits financiers du capital. Ainsi, dans un discours à la Chambre de commerce de Montréal où il avait été invité à présenter son projet, Louis Laberge, principal promoteur du Fonds de solidarité de la FTQ, rassure les patrons montréalais en rappelant que « Le Fonds ne veut pas prendre la place des entrepreneurs, mais il veut que les travailleurs prennent la place qu’ils doivent avoir dans l’entreprise »… en finançant, à même leurs salaires, les investissements productifs des entreprises. L’esprit d’un projet comme celui du Fonds de solidarité d’investissement ne saurait être mieux traduit que par ces lignes : « Pour nous à la FTQ, [le profit] n’est pas un mot sale, un mot tabou. Les gens qui investissent leur argent et font des efforts ont le droit d’espérer un profit, pourvu qu’ils n’exploitent personne [!]. D’ailleurs, nous n’avons jamais été contre le profit, mais contre le profit maximum, contre les employeurs qui ne cherchent qu’à maximiser leurs profits sur le dos des employés. C’est évident qu’on aime bien mieux négocier avec un employeur qui fait des profits qu’avec une entreprise qui branle dans le manche. Car les problèmes des patrons deviennent rapidement les problèmes des employés. » (Louis Laberge, cité dans SOLIDARITÉ INC. Un nouveau syndicalisme créateur d’emploi, Louis Fournier, Montréal, Les Éditions Québec/Amérique, 1991, coll. « Succès d’Amérique », [version électronique des Classiques des sociales sociales de l’UQAC], p. 96).
14. C’est précisément le rôle du projet de loi 89, officiellement entrée en vigueur le 30 novembre 2025, sous le nom de Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (loi 14). Avec cette loi inspirée de celle sur les services essentiels – qui retire plus ou moins aux travailleur·ses des services publics dit « essentiels » (services publics et secteur de la santé) le droit de débrayer –, le gouvernement provincial se donne le pouvoir de mettre fin à un conflit de travail du secteur privé ou parapublic dès qu’il juge que ce conflit affecte « de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité ». Exprimée sans détour, cette loi fait en sorte qu’une grève devient illégale dès qu’elle remplit correctement sa fonction de perturbation économique.
15. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 29-30.
16. Ibid., p. 35.
17. Sur cette question, on peut renvoyer à cet extrait de « Tel quel », texte paru dans le vingt-quatrième numéro de TC (2012) : « Si la valorisation du capital est unifiée au travers de ce zonage [du mode de production capitaliste en trois zones], il n’en est pas de même de la reproduction de la force de travail. Chacune de ces zones a des modalités de reproduction spécifiques. Dans le premier monde : des franges à hauts salaires avec privatisation des risques sociaux imbriquées dans des fractions de la force de travail où sont préservés certains aspects du “fordisme” et d’autres, de plus en plus nombreuses, soumises à un “nouveau compromis” dont le contenu est l’achat global de la force de travail. Dans le deuxième monde : régulation par des salaires bas, imposés par une forte pression des migrations internes et la grande précarité de l’emploi, îlots de sous-traitance internationale plus ou moins stables, peu ou aucune garantie des risques sociaux, migrations de travail. Dans le troisième monde : aides humanitaires, trafics divers, survie agricole, régulation par toutes sortes de mafia et de guerres, mais aussi par la revivification des solidarités locales et ethniques. Ce zonage se doit [?] d’être une mise en abyme : chaque niveau d’échelle, du monde au quartier, reproduit cette tripartition. La disjonction est totale entre la valorisation mondiale unifiée du capital et la reproduction de la force de travail adéquate à cette valorisation. Entre les deux, la relation réciproque de stricte équivalence entre production de masse et modalités de la reproduction de la force de travail, qui définissait le fordisme, a disparu.
Ce zonage était une détermination fonctionnelle du capital : maintenir, malgré la rupture entre les deux, des marchés mondiaux en expansion et une extension planétaire de la main-d’œuvre disponible, cela en dehors de toute relation nécessaire sur une même aire de reproduction prédéterminée. La rupture d’une relation nécessaire entre valorisation du capital et reproduction de la force de travail a brisé les aires de reproduction cohérentes dans leur délimitation régionale ou même nationale. » (Le document consulté ne fournit pas les numéros de page).
18. Samir Amin, La déconnexion. Pour sortir du système mondial, Paris, Maspero, coll. « Cahiers libres », 1986.
19. Christian Palloix, L’internationalisation du capital. Éléments critiques, Paris, Maspero, coll. « Économie et socialisme », 1974.
20. Cf. Ulysse Lojkine, Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l’exploitation. Paris, La Découverte, coll. « Économie politique », 2025, p. 128 et suiv.
21. « Vie quotidienne et luttes des classes », p. 27.
22. Ibid., p. 28.
23. « Too much monkey business », Théorie Communiste, no 22, 2009, p. 119. « Si cette crise nous oblige à ce retour théorique, c’est que nous sommes confrontés à une double évidence contradictoire : d’un côté la seule théorie marxiste cohérente des crises est celle développée par Paul Mattick, c’est-à-dire celle fondée sur la baisse tendancielle du taux de profit ; de l’autre cette crise est une crise de sous-consommation (elle est et non « apparaît comme »). Notre principale confrontation théorique en tant que confrontation productive ne peut s’engager qu’avec les thèses de la suraccumulation de capital par rapport à ses capacités de valorisation, c’est-à-dire avec Mattick et ses deux principaux ouvrages sur la question : Marx et Keynes (Ed. Gallimard, 1972) et Crises et théories des crises (Ed. Champ libre, 1976). »
24. Paul Mattick, Marx et Keynes. Les limites de l’économie mixte, trad. Serge Bricianer, Paris : Gallimard, coll. « Tel », 1972, p. 118.
25. La crise de 1973-1974 et le rôle qu’y a joué le choc pétrolier atteste du fait qu’une hausse de la composition organique (pour un taux d’exploitation constant) et donc, une baisse du taux de profit, peut survenir indépendamment du progrès technologique ou de la hausse de la composition technique du capital. En effet, la hausse du prix des matières premières fait croître la composition organique sans se traduire par un développement des forces productives, ce qui, naturellement, diminue la rentabilité du capital.
26. « Too much monkey business », TC, no 22, 2009, p. 124.
27. Ces éléments concernent à la fois le capital constant (prix des matières premières, auxiliaires, des machines, des bâtiments, etc.) et le capital variable, c’est-à-dire le niveau des salaires pour une intensité du travail donnée. En effet, ces deux facteurs peuvent subir une diminution de leur valeur qui se traduit, toute chose étant égale par ailleurs, par une augmentation du taux de profit.
28. Rien ne permet de dire, a priori, que le développement des forces productives et la hausse de la composition technique du capital se traduiront par une augmentation correspondante de la composition-valeur du capital. Il est tout à fait possible que le progrès de la productivité à l’échelle de la société, en rendant meilleur marché les éléments du capital constant, laisse inchangé le rapport moyen entre capital constant et variable, voire qu’il fasse reculer le premier terme au profit du second. Sur la baisse de la valeur du capital constant, cf. Karl Marx, Le Capital, Livre I, trad. Jean-Pierre Lefebvre (d’après la 4e édition allemande), 2014 [1867], Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », p. 677-678.
29.Karl Marx, Le Capital, Livre 3, tome I, trad. de C. Cohen-Solal et de Gilbert Badia, Paris, Éditions Sociales, 1960 [1894], p. 227. « À mesure que diminue progressivement le capital variable relativement au capital constant, s’élève de plus en plus la composition organique de l’ensemble du capital, et la conséquence immédiate de cette tendance [nos italiques, ndr] c’est que le taux de plus-value se traduit par un taux de profit général en baisse continuelle, le degré d’exploitation du travail restant sans changement ou même en augmentant. »
30. Cela dit, les proportions économiques nécessaires à la reproduction élargie ne s’obtiennent jamais que par de douloureuses tentatives qui, dans la réalité, se soldent par de la surproduction d’un côté et de la sous-production de l’autre. Les convulsions qui résultent de disproportions entre les branches I et II, typiques des périodes d’industrialisation accélérée, ne doivent cependant pas être confondues avec des crises de suraccumulation dont nous avons parlé, qui sont des crises de valorisation. La croissance beaucoup trop rapide de l’industrie soviétique du début des années 1930, les pénuries corollaires de moyens de consommation et la stagnation des salaires qui ont ébranlé jusqu’aux fondements du régime soviétique n’ont rien à voir avec les causes de la crise de 1929 dans le reste du monde capitaliste. Si l’on peut parler de « surproduction de moyens de production » dans les deux cas (en URSS, c’est un fait que trop de moyens ont été consacrés à la construction d’usines, de barrages, de bâtiments, etc.), c’est seulement avec la crise de suraccumulation comme crise de valorisation que l’exploitabilité du prolétariat joue un rôle déterminant. Sur le cas de l’URSS, cf. Alec Nove, An Economic History of the USSR. 1917-1991, Londres, Pinguin Books, 1969 (en particulier les chapitres 7 et 8).
31. C’est ce fait, selon Duménil, qui prouve que les manuscrits utilisés par Engels pour l’édition du Livre III n’étaient précisément pas destinés à l’impression, cf. Gérard Duménil, Marx et Keynes face à la crise, 2e éd., Paris, Economica, 1981, p. 241.
32. Cela ne signifie pas que l’augmentation de la composition organique ne peut pas faire diminuer le taux de profit et ainsi provoquer un problème de valorisation. Au contraire, dès que le taux d’exploitation est donné, n’importe quel renchérissement des éléments du capital constant (traduit par une hausse de la composition valeur, donc par une hausse de la composition organique) fait augmenter la masse de capital à valoriser, ce qui diminue le taux de profit. Autrement dit, alors que la masse de plus-value que l’argent dépensé en salaires permet de s’approprier stagne, les dépenses en capital constant augmentent – d’où une chute du taux de profit. Toujours est-il qu’une suraccumulation et une baisse du taux de profit peuvent survenir sans que la composition organique ne soit modifiée.
33. Sur la question du rapport entre suraccumulation, loi de la baisse tendancielle du taux de profit et mévente, il est particulièrement aidant de se référer au chapitre VIII, celui portant sur la suraccumulation du capital, du livre de Duménil déjà cité, cf. Duménil, Marx et Keynes face à la crise, p. 233-266.
34. Mattick, Marx et Keynes, p. 133.
35. Marx, Le Capital, L.3, t. I, p. 267.
36. Rappelons que, pour TC, c’est le fait que des prolétaires ont été incapables de payer leurs crédits qui explique la crise de 2008. Cf. « Vie quotidienne et lutte des classes », TC, no 27, p. 27.
37. Ibid., p. 15.
38. C’est cette relation contradictoire qui fait dire à TC, et avec raison, que le prolétariat est, du point de vue du capital, à la fois nécessaire et de trop. Le capital sent que le prolétariat est nécessaire parce qu’il sait que sa valorisation accrue passe par un recours accru à de la « matière à exploiter » (des prolétaires). La masse de plus-value que peut s’approprier le capital est, toute chose égale d’ailleurs, directement proportionnelle à la quantité de producteur·rices qu’il peut mettre en mouvement : pour créer et s’approprier davantage de plus-value, il faut étendre l’échelle de la production, c’est-à-dire qu’il faut davantage de bras. À l’inverse, dans la mesure où les salaires payés entrent dans la rubrique des coûts de production (de concert avec les dépenses liées au capital constant), ils s’opposent au profit. Or, comme les capitalistes cherchent constamment à accroître la rentabilité de leur affaire en réduisant ces mêmes coûts, ils et elles se représentent leurs propres employé·es comme une dépense qu’il s’agit de réduire au minimum. Les prolétaires, parce que leurs salaires semblent plomber l’accumulation (et parce qu’ils et elles refusent parfois d’obéir comme il se doit aux propriétaires de leur force de travail), apparaissent alors de trop. S’il ne peut s’attaquer directement à leurs conditions de travail ou à la hauteur de leur salaire, le capital saisira alors la première occasion venue pour investir en machinerie ou pour rationaliser le procès de travail de façon à pouvoir expulser la composante vivante du travail au profit de sa composante morte, objectivée. Cet investissement, bien que susceptible d’entraîner des coûts importants, est souvent jugé plus avantageux que de continuer à dépendre d’une force de travail exigeant une forte rémunération ou des conditions de travail rigidement fixées. Ce rapport contradictoire – pour se valoriser, le capital a besoin d’exploiter plus de prolétaires, mais il en exploite toujours trop – est source d’instabilités constantes et de crises, et implique que ses modalités sont nécessairement amenées à évoluer.
39. Quant au premier type de contraintes, pensons à la menace de fermetures d’entreprises ou de leur délocalisation, au ralentissement de la production, au chômage et à l’inflation galopantes, aux coupes dans les salaires directs et indirects, et quant au second type, nommons les retours forcés au travail, l’institutionnalisation des lois spéciales et des lois votées sous bâillon, la dispersion violentes des manifestations, la répression individualisées des débrayages, etc.
40. Marx, Le Capital, L. 3, t. III, p. 254. « On pourrait alléguer, il est vrai, que le capital (y compris la propriété foncière, son contraire) suppose déjà une répartition : il suppose que les ouvriers sont expropriés des moyens de travail, que ceux-ci sont concentrés entre les mains d’une minorité d’individus, que d’autres ont la propriété exclusive de la terre ; bref, ce sont là les rapports étudiés déjà dans la Section sur l’accumulation primitive (Livre I, chap. XXIV). » Autrement dit, on pourrait penser que l’analyse des rapports de distribution permet de rendre compte de la structure sociale de façon tout aussi satisfaisante que celle des rapports de production qui y dominent. Or, Marx ajoute tout de suite après : « Mais cette répartition diffère entièrement de ce que l’on entend par rapports de distribution, du moins quand on leur concède, par opposition aux rapports de production, un caractère historique. »
41. Ibid., p. 253.
42. Marx, Le Capital, L. 1, p. 693 et suiv.
43. Marx, Le Capital, L. 3, t. III, p. 253.
44. Ibid., p. 258.
45. « Avant-propos », TC, no 27, p. 10.
46. L’extrême ironie de la chose, c’est que ce que nous reprochons à TC ici, TC le reproche elle-même à l’opéraïsme dans le texte sur les Gilets jaunes : « Dire, comme l’opéraïsme finissant, que “la société elle-même est devenue le lieu productif d’ensemble” est une jolie formule, mais une formule creuse. Que le capital, en subsomption réelle, se soit emparé de l’ensemble de la société et, mieux dit, qu’il ait produit tous les organes de sa propre reproduction (de ce point de vue, la subsomption réelle est toujours inachevée), ne signifie pas que tous les actes, toutes les activités accomplies dans cette société soient de la production. » (« Gilets jaunes », TC, no 27, p. 199).
47. Ici, nous parlons du salaire en tant que catégorie économique déterminée – le montant d’argent que reçoit un salarié et correspondant au travail nécessaire –, pas du salaire en tant que forme de rémunération générale. Cette distinction est nécessaire pour être habilité à parler de sursalaire.
48. Marx, Le Capital, L. 3, t. I, p. 61. Dans ce passage précis, il est plutôt question d’un côté, du taux de profit (le phénomène de surface) et, de l’autre, la plus-value et le taux de plus-value (l’élément invisible, mais essentiel), sans lesquels le taux de profit ne peut précisément pas être expliqué.
49. Le passage sur lequel s’ouvre le troisième livre du Capital résume très bien ces deux grandes étapes : 1) celle qui écarte l’accidentel pour remonter à l’essentiel et 2) celle qui cherche précisément à rendre compte des formes concrètes par l’intermédiaire desquelles l’essentiel (le mouvement réel) se donne :
« Dans le livre 1er, nous avons étudié les divers aspects que présente le procès de production capitaliste, en soi, en tant que procès de production immédiat, et, dans cette étude, nous avons fait abstraction de tous les effets secondaires résultant de facteurs étrangers à ce procès. Mais la vie du capital déborde ce procès de production immédiat. Dans le monde réel, le procès de circulation, qui a fait l’objet du livre II, vient le compléter. Dans la troisième section du livre II surtout, en étudiant le procès de circulation en tant qu’intermédiaire du procès social de reproduction, nous avons vu que le procès de production capitaliste, pris en bloc, est l’unité du procès de production et du procès de circulation. Dans ce livre III, il ne saurait être question de se répandre en généralités sur cette unité. Il s’agit au contraire de découvrir et de décrire les formes concrètes auxquelles donne naissance le mouvement du capital considéré comme un tout. C’est sous ces formes concrètes que s’affrontent les capitaux dans leur mouvement réel, et les formes que revêt le capital dans le procès de production immédiat comme dans le procès de production n’en sont que des phases particulières. Les formes du capital que nous allons exposer dans ce livre le rapprochent progressivement de la forme sous laquelle il se manifeste dans la société, à sa surface, pourrait-on dire, dans l’action réciproque des divers capitaux, dans la concurrence et dans la conscience ordinaire des agents de la production eux-mêmes. » (Marx, Le Capital, L. 3, t. I, p. 47.)
50. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 66.
51. Ibid., p. 70.
52. Marx, Le Capital, L. 3, t. III, p. 208.
53. Ibid.
54. TC semble consciente que sa proposition « le mouvement réel n’est qu’un concept » est une contradiction dans les termes : « D’un côté nous parlons de “formes d’apparition” ou “de manifestation” (Erscheinungform [sic]), ce qui suppose l’existence d’un “mouvement réel” dont elles sont les “formes”, de l’autre, nous écrivons que le mouvement réel n’est ni un “au-dessus”, ni un “au-delà”, ni ailleurs que dans ces dites “formes d’apparition”, que ce “mouvement réel” n’est qu’un concept. (…) Comment alors continuer à parler de “formes d’apparition”? De quoi sont-elles “formes d’apparition”? De quel droit les qualifier comme telles? » (« Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 66) TC croit cependant s’en sortir en disant qu’il faut penser le mouvement réel comme « la relation que les formes d’apparition construisent entre elles » (ibid.). Mais ici comme avant, ce qu’il faut à tout prix clarifier, c’est le caractère objectif ou non du mouvement réel : ou bien il est réel en ceci qu’il vaut comme la vérité de l’objet, ou bien il n’a rien à voir avec le monde, n’existe que dans la tête des théoricien·nes et ne vaut donc absolument rien. Parler de « relation » afin de trancher cette question est un simple faux-fuyant.
55. Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Science de la logique. Livre deuxième. L’essence, trad. Bernard Bourgeois, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 2016 [1813], p. 21. Soulignons que Marx utilise une formule d’une similarité frappante à celle qu’utilise Hegel dans cette critique. Pour Marx, « L’économie vulgaire se borne, en fait, à transposer sur le plan doctrinal, à systématiser les représentations des agents de la production, [nos italiques, ndr] prisonniers des rapports de production bourgeois, et à faire l’apologie de ces idées ». (Le Capital, L. 3, t. III, p. 196.) Autrement dit, l’économie vulgaire travaille avec des catégories apparemment réfléchies, qui prétendent atteindre l’essence des phénomènes économiques, alors qu’elles sont la pure reproduction de représentations irréfléchies (immédiates) de la réalité économique.
56. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 68.
57. Ibid., p. 73. Le même passage se trouve aussi à la page 282.
58. Marx, Le Capital, L. 3, t. I, p. 322.
59. En l’occurrence, l’illusion que cherche à dissiper Marx est celle selon laquelle c’est le temps de rotation des capitaux actifs dans le commerce qui détermine le profit qu’ils s’approprient et, par conséquent, l’illusion selon laquelle ce profit tire sa source de la sphère de la circulation, plutôt que de la création de plus-value.
60. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 68. « Le mouvement réel est un “concret de pensée” qui en tant que tel n’exclut pas les multiples déterminations et la diversité [quelle trouvaille!], il n’exclut pas les formes d’apparition, car il n’existe lui-même que par la totalité de ses formes, de ses attributs. »
61. Ibid. p. 74.
62. Ibid.
63. Ibid.
64. Ibid.
65. Ibid., p. 53
66. Dans une note, TC fait même l’observation suivante : « Cela soulève beaucoup d’interrogations théoriques générales de constater qu’un ouvrier se retrouve plus à l’aise aux côtés de son petit patron qui, de toute façon, tire un profit de son travail, qu’avec un instituteur ou un prof débutant dont le revenu peut être inférieur au sien. » (« Gilets jaunes », TC, no 27, p. 168). Qu’est-ce que ce fait révèle? Que le patron n’est pas un patron parce que son employé est plus à l’aise avec lui qu’avec un prof? Au contraire – et c’est la conséquence que TC semble incapable de tirer – cela nous fait clairement voir que la « vie quotidienne » ne joue aucun rôle au niveau l’appartenance de classe des agents. Ce qui compte, de ce point de vue, c’est uniquement la place occupée dans les rapports de production et de subordination, parce que cette place définit une fonction spécifique, donc un rapport spécifique à la reproduction de la totalité.
67. « Vie quotidienne et luttes des classes », TC, no 27, p. 88.
68. « Les classes en général », TC, no 27, p. 294.
69. Si nos camarades jugent qu’il est « bon et nécessaire » de s’attarder au travail de théorisation du prolétariat, il n’en va pas de même pour les autres classes et à plus forte raison en ce qui a trait à la classe capitaliste, car « nous ne savons que trop ce qu’est la classe capitaliste qui se connaît et sait se construire elle-même en bloc hégémonique [?] » (« Les classes en général », TC, no 27, p. 249). Que la classe capitaliste puisse représenter un objet particulièrement difficile à circonscrire, notamment en raison de la grande diversité d’activités par lesquelles il est possible de fonctionner en tant que capitaliste, cela ne semble pas trop inquiéter nos camarades. TC a manifestement une haute estime de sa capacité à voir clair au sein des rapports de classe sans procéder à de recherches d’aucune sorte.
70. Cf. ibid., p. 295.
71. Ibid., p. 294.
72. Ibid.
73. Ibid., p. 288.
74. TC se défend explicitement d’une telle interprétation : « Mais le prolétariat n’est pas une forme historiquement ultime dont on doit espérer et attendre l’apparition, il est une fonction présente dans la lutte des classes de la classe ouvrière. » (Ibid., p. 287). Mais comment l’interpréter autrement, si l’on dit aussi que le prolétariat est la « classe ouvrière se retournant contre elle-même comme catégorie économique » (Ibid., p. 294) et que, visiblement, la classe ouvrière n’est pas constamment en train d’opérer ce retournement?
75. Ibid., p. 295.
76. Ibid., p. 295. On trouve un autre passage particulièrement savoureux à la page suivante : « Contrairement aux ouvriers productifs qui assurèrent la victoire de la majorité du SPD en 1919, les émeutiers de 2005, pour la plupart n’en étaient pas. » (Ibid., p. 296) Il s’agit d’un raisonnement aussi subtil qu’implacable : il y a des ouvriers productifs qui ont fait élire un gouvernement social-démocrate dans un climat politique extrêmement complexe et tumultueux, tout juste après qu’une insurrection prolétarienne ait été noyée dans le sang, donc les ouvriers productifs n’ont pas été révolutionnaires. Ils ne sont donc pas des prolétaires. Par opposition, les émeutiers de 2005 ont fait brûler beaucoup de choses et se sont violemment battus avec la police, tout en n’étant pas des travailleurs productifs. Ils étaient radicaux – donc révolutionnaires. Ce sont donc des prolétaires. Conclusion : le prolétariat n’a peu, voire rien à voir avec les travailleur·ses productif·ves. Permettez-nous de douter que les émeutiers de 2005 aient été plus loin dans le procès d’abolition de la société capitaliste que les ouvrier·ères allemand·es qui permirent certes la victoire du SPD, mais qui, l’année précédente, entre autres choses, firent s’écrouler l’empire en s’alliant aux soldats mutinés et en faisant massivement grève, pillèrent les magasins, occupèrent les usines, élevèrent des barricades dans la plupart des grandes villes du pays, prirent les armes par milliers, affrontèrent les Freikorps, désertèrent l’USPD pour fonder le KPD (puis le KAPD, puis l’AAUD-E), mirent sur pied d’authentiques organes de luttes prolétariennes, etc. – sans parler de la formation de l’Armée rouge de la Ruhr et de l’insurrection, dans la même région, déclenchée en réaction au putsch de Kapp en 1920. Ce n’était pas la révolution achevée, mais ce n’était pas mal non plus.
77. TC se donne elle-même les moyens d’établir le ridicule de l’opposition établie entre classe ouvrière (catégorie économique souhaitant rester telle) et prolétariat (classe parfaitement révolutionnaire) : « Quand les ouvriers s’unissent contre leur nature de salariés, s’emparent des moyens de production et des services, intègrent les sans-réserves, déglinguent les mécanismes marchands, imposent conflictuellement des mesures communistes à la classe moyenne qui elle-même est en lutte et à toutes les classes et couches que l’échange paupérise, les dissolvant et les intégrant dans le processus pour le prolétariat de sa propre abolition, ce changement est une rupture. » (Ibid., p. 287). Renvoyons aussi au premier texte où TC offre, comme le « meilleur exemple » de débordements récents des luttes prolétariennes, « l’énorme insurrection ouvrière [tiens tiens!] en Birmanie / au Myanmar » : « Dans un immense mouvement de “désobéissance civile” (les services et les banques sont bloqués, l’armée doit investir les hôpitaux pour briser la résistance des personnels et empêcher les soins aux blessés), les ouvriers, principalement du secteur textile tenu par des entreprises chinoises et les conglomérats économiques de l’armée, se mettent massivement en grève. Des dizaines d’usines sont incendiées : “à chaque mort une usine brûle”, tel est le mot d’ordre des ouvriers (à 80 % des ouvrières). » (« Vie quotidienne et luttes des classes », p. 36.)
78. « Les classes en général », TC, no 27, p. 294.
79. Ibid., p. 295.
80.Si l’on cherche à se donner une idée de ce à quoi peut ressembler une telle étude, nous invitons les lecteur·rices à se référer à notre dernier numéro et, en particulier, à la section 2.3. (Le prolétariat au Québec) du second texte, « Les classes sociales au Québec ».
81. La monographie d’Ignacio Diaz portant sur l’insurrection asturienne de 1934 est, sur cette question, particulièrement riche d’enseignements. Y est notamment soulignée l’importance, du point de vue du succès de l’insurrection, non seulement de s’emparer rapidement des armes et munitions existantes, mais aussi des lieux de production où celles-ci sont elles-mêmes produites afin d’assurer l’armement et le ravitaillement des insurgé·es dans la durée. Cf. Ignacio Diaz, Asturies 1934. Une révolution sans chefs, trad. Pierre-Jean Bourgeat, Toulouse, Smolny, 2021 [2012],p. 117-118.
82. Nous ne disons pas que les prolétaires ne risquent rien en s’insurgeant de la sorte – bien au contraire, ils et elles risquent jusqu’à leur peau –, mais bien qu’en luttant dans un sens révolutionnaire, les prolétaires reproduisent leur existence d’une façon « immédiatement sociale », d’une façon donc qui retire au capital, au moins pour un temps, les moyens de les contraindre à produire pour son propre compte.
83. On peut dire que la position des producteur·rices et commerçant·es indépendant·es est non seulement spécifique, mais également « privilégiée », si l’on se place du point de vue de l’autonomie et de la liberté de décision dont ils et elles jouissent en tant qu’indépendant·es. En revanche, au Québec – et on peut faire l’hypothèse que cela vaut de façon générale et à plus forte raison dans les économies de la périphérie –, les membres du prolétariat et de la classe moyenne subordonnée (cms) n’ont rien à envier à la classe moyenne indépendante au niveau du degré de rémunération. Si l’on prend les données de 2020, on constate qu’avec un revenu d’emploi annuel médian de 29 235 $, les membres de la CMI gagnent à peine 260 $ de plus que ceux de la cms (28 975 $), là où le salaire médian annuel du prolétariat est de 32 980 $ (cf. Temps Libre, no 3, p. 199). Ce n’est donc certainement pas là que les membres de la CMI ont quelque chose à perdre.
84. Pensons, par exemple, au cas du « salariat déguisé » et à ses conséquences sur la façon de concevoir non seulement le rapport salarial, mais aussi le travail productif. On peut également exemplifier cette idée en référant au cas des travailleuses du secteur public hautement formées, mais extrêmement mal payées, en ce qu’il soulève le problème de la validation sociale du caractère intellectuel d’un travail. La délicate tâche de discriminer les agents de la classe capitaliste par rapport à ceux faisant partie de la classe moyenne subordonnante nous a également contraints à repenser ce que cela signifie, dans une société capitaliste hautement financiarisée, que de fonctionner comme capitaliste.
L’évolution des conflits de classe
Cinquante ans après la dernière analyse systématique des classes sociales de la société québécoise, le troisième numéro de Temps Libre, paru cet automne, propose un portrait des classes sociales du Québec qui tente de rendre compte des transformations structurelles subies par le capitalisme lors des dernières décennies. L’extrait qui suit représente le quatrième et dernier texte de ce numéro et tente de mesurer l’effet du passage au cycle néolibéral sur la manière dont se jouent les conflits entre les classes.

***
On peut interpréter le cycle néolibéral comme une réponse à la crise structurelle des années 1970. Dans la mesure où cette réponse a sérieusement transformé la structure de classes de la société québécoise, il était en quelque sorte inévitable que le portrait brossé s’éloigne des derniers grands travaux marxistes entrepris sur les classes sociales au Québec. Or, le cycle d’accumulation introduit par la restructuration néolibérale a aussi pour corollaire le passage à un nouveau cycle de luttes. Au cours de cette restructuration, non seulement la division en classes de la société en sort bouleversée, mais il en va de même de la conflictualité entre les classes. Parler de la lutte des classes comme étant structurée par des cycles de luttes, c’est prendre acte du fait qu’elle s’inscrit nécessairement dans une configuration historiquement déterminée du mode de production capitaliste, laquelle définit ses possibilités et ses limites. Les outils pratiques permettant de résister à l’exploitation, les identités politiques mobilisées pour mener les luttes et, inversement, les moyens utilisés pour encadrer et réprimer celles-ci sont largement tributaires de ces configurations changeantes.
En ce qui concerne les pratiques de luttes, un véritable fossé sépare les modalités actuelles des conflits de classe et la situation précédant la restructuration néolibérale. Au tournant des années 1970, ce sont non seulement les comités populaires, les groupes révolutionnaires et féministes, mais également les organisations syndicales qui apparaissent comme les acteurs d’une dynamique de lutte en rupture avec le cadre revendicatif dans lequel la plupart des conflits étaient menés. Les revues ouvertement anticapitalistes, marxistes, anti-impérialistes et féministes révolutionnaires telles que Parti pris (1963-1968), Révolution Québécoise (1964-1965), Socialisme (1964-1974), Québécoises Debouttes ! (1971-1975), Les Têtes de pioche (1976-1979), Mobilisation (1972-1975), En Lutte ! (1972-1982) et Les Cahiers du socialisme (1978-1985) pullulent et marquent profondément le paysage politique québécois. Les thèses et analyses qui y sont défendues sont largement discutées, tandis que les appels à fonder un parti ouvrier révolutionnaire vont sans cesse croissant. Certains groupes influencés par les luttes de libération nationale sont alors convaincus que la lutte révolutionnaire armée est une tâche immédiate. C’est le cas du Front de libération du Québec (1963-1972) qui, après plusieurs années de sabotage et de cambriolage, enlève l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross et le ministre provincial du Travail Pierre Laporte, conduisant ainsi à la crise d’Octobre 1970. Deux ans plus tard, la mobilisation du Front commun de 1972 se transforme, à l’initiative de la base, en grève générale et s’étend à l’ensemble de la province. Aujourd’hui apparaissent bien loin les jours d’octobre 1970 où Michel Chartrand, président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CSN), pouvait discourir devant une foule de plusieurs milliers de personnes scandant leur appui au FLQ au moment même où le ministre du Travail était détenu en otage[1]. Comment cette conflictualité a-t-elle pu fléchir au point de faire paraître pour un révolutionnaire exalté quiconque formulerait aujourd’hui un lieu commun du syndicalisme de combat des années 1970 ?
Pour répondre à cette question, nous ne comptons pas présenter une histoire compréhensive des luttes passées, histoire à travers laquelle nous chercherions à identifier les bons coups, les erreurs et les trahisons des un·es et des autres. On pourrait par ailleurs s’étonner que notre focale ne soit pas toujours orientée vers les groupes et les courants ayant formulé les critiques les plus profondes ou ayant déployé les pratiques les plus radicales. Notre objectif n’est pas de trouver des modèles au sein des luttes passées ou encore de se découvrir une proximité idéologique avec des groupes dont on pourrait aujourd’hui calquer les activités. Il s’agit au contraire d’illustrer comment la base sur laquelle les luttes étaient menées a profondément changé, nous contraignant à repenser l’efficacité, la portée et l’actualité de certains moyens de lutte. C’est uniquement à partir de là qu’il sera possible d’envisager de façon lucide les développements potentiels des futurs conflits de classe. Pour ce faire, il est utile de commencer par l’étude de l’évolution des effectifs syndicaux, lesquels constituent un bon indicateur de la variation des formes de la conflictualité entre les classes.
1. L’évolution des effectifs syndicaux
On ne peut s’intéresser à cette question sans soulever le fait que le taux de syndicalisation est demeuré, au Québec, significativement plus élevé que dans le reste du Canada et qu’aux États-Unis[2]. On trouve ici un élément supplémentaire qui atteste de la singularité de la formation sociale québécoise et de ses dynamiques particulières. De 1935 à 1992, les effectifs syndicaux augmentent avec une impressionnante constance, de sorte qu’ils passent de 65 100 à 970 900. Si, en termes absolus, ces effectifs connaissent une forte croissance, le taux de syndicalisation oscille légèrement entre 27 et 30 % de 1946 à 1964. Les effectifs syndicaux suivent alors grosso modo les tendances démographiques de la population québécoise. À partir de 1964, le taux de syndicalisation repart à la hausse, jusqu’à atteindre 42,8 % en 1992[3]. Malgré quelques fluctuations depuis, le taux de présence syndicale se situait toujours à 38,9 % en 2023[4]. Si la persistance d’un taux de syndicalisation élevé est déjà un indice de la puissance des organisations syndicales, celui-ci ne nous indique pas pour autant qui est représenté par celles-ci. Or, la forte syndicalisation qui s’amorce à partir de la moitié des années 1960 – le taux de syndicalisation augmente de 7 points de pourcentage en 6 ans – est notamment déterminée par l’adoption du Code du travail du Québec en 1964 qui étend le droit de grève aux syndicats accrédités du secteur public[5]. Au début des années 1960, les réformes du gouvernement Lesage en santé et en éducation font exploser le nombre de salarié·es de l’État à qui on ne reconnaît pas encore le droit de grève et qui, par le fait même, doivent se soumettre à un arbitrage obligatoire. Le droit de grève dans le secteur public se place alors au cœur des revendications syndicales et des travailleur·ses recourent à la grève illégale pour mettre de l’avant leurs intérêts. C’est notamment le cas des infirmières de Sainte-Justine qui, au terme d’un débrayage illégal d’un mois à l’automne 1963, arrachent des augmentations salariales, un droit de regard sur la planification et la qualité des soins ainsi que la reconnaissance de leur ancienneté[6]. La pression pousse alors le gouvernement du Québec à étendre le droit de grève à ses employé·es, ce qui entraîne une forte syndicalisation et participe à une tendance significative dans la composition des effectifs syndicaux du Québec, à savoir une augmentation constante de la part des syndiqué·es issu·es du secteur public.
En 2023, le taux de présence syndicale s’élevait à 84,7 % dans le secteur public alors qu’il n’était que de 23 % dans le secteur privé. Pour la même année, il n’était que de 19,8 % pour les industries primaires, de 16,5 % pour le commerce et de 8,7 % pour l’hébergement et les services de restauration[7]. Notons également qu’au sein du secteur privé, ce sont les activités traditionnelles de la classe ouvrière qui connaissent les plus hauts taux de présence syndicale, à savoir 31,3 % pour la fabrication, 43,9 % pour le transport et l’entreposage et 56,9 % pour la construction[8]. À cela s’ajoute une professionnalisation des effectifs syndicaux qui s’observe par un plus haut taux de présence syndicale pour les employé·es ayant un diplôme d’études postsecondaires (41,9 %) que pour les employé·es qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires (26,3 %) ou qui possèdent uniquement celui-ci (34,3 %)[9]. Ces données nous conduisent au constat du caractère de plus en plus interclassiste des organisations syndicales, en ce qu’elles représentent de plus en plus indistinctement les membres du prolétariat, de la classe moyenne subordonnée et de la classe moyenne subordonnante.
Si les syndicats ne peuvent plus être assimilés à des organisations de luttes proprement prolétariennes, alors la question se pose de savoir quel est le rapport qu’ils entretiennent aux différentes classes sociales. À ce titre, force est de constater que l’importance prise par la négociation centralisée des conventions collectives entre l’État et ses employé·es a déplacé le centre de gravité du discours et de l’action des grandes centrales syndicales. En effet, ces négociations ne portent pas sur la résistance à l’exploitation spécifiquement capitaliste, dont l’enjeu central demeure les modalités de l’appropriation de la plus-value. Il s’agit plutôt de déterminer dans quelle mesure l’État et, par le fait même, les « contribuables » du Québec devraient débourser pour s’offrir des services publics de qualité et pour assurer des conditions de travail décentes à ceux et celles qui les fournissent. Cette situation n’est pas tout à fait nouvelle : l’histoire des luttes sociales des cinquante dernières années au Québec est notamment marquée par la formation de grands fronts communs intersyndicaux mobilisant des centaines de milliers de travailleur·ses des secteurs public et parapublic. En ce sens, l’interclassisme et la combativité syndicale du secteur public ne sont pas spécifiques au nouveau cycle de lutte. Ce qui est véritablement nouveau, c’est l’incapacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme actrices d’une potentielle transformation sociale radicale conforme aux intérêts des classes subordonnées. Pour mieux illustrer ce basculement, nous contrasterons les Fronts communs de 1972 et de 1982-1983. Nous verrons que ce n’est pas tant par l’ampleur des effectifs mobilisés qu’ils se distinguent, mais plutôt par le degré de combativité et de confiance qu’avaient ses participant·es de le voir déboucher sur une transformation sociale profonde.
2. De la fonction publique à la grève sociale : le Front commun de 1972
La décennie 1970 est marquée par des grèves et des lock-out qui atteignent une intensité inégalée dans l’histoire du Québec[10]. Dans ce contexte, le Front commun intersyndical de 1972 représente en quelque sorte le paroxysme du cycle de luttes précédent, le point où la conflictualité institutionnalisée propre au « compromis fordiste » atteint ses limites. Ce premier Front commun constitué par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ) réunit plus de 200 000 employé·es des secteurs public et parapublic. Les premières négociations avec le gouvernement du Québec commencent au printemps 1971 alors qu’est toujours en vigueur la Loi sur les mesures temporaires d’ordre public qui prolonge certaines dispositions de la Loi sur les mesures de guerre mises en place lors de la crise d’Octobre[11]. En ce sens, les souvenirs des dizaines de milliers de perquisitions arbitraires et des centaines d’emprisonnements sans mandat sont encore très vifs lorsque débutent les négociations. Dans ce contexte, le discours ambiant se radicalise. Chacune des trois grandes centrales publie un manifeste qui n’hésite pas à dépeindre le capital en ennemi. Dans Ne comptons que sur nos propres moyens (1971), la CSN critique l’impérialisme américain et met de l’avant la nécessité d’une planification socialiste. La FTQ publie L’État, rouage de notre exploitation (1971) qui affirme sans détour que
la cause véritable des problèmes aigus qui écrasent chaque jour davantage les travailleurs, c’est le système capitaliste monopoliste organisé en fonction du profit de ceux qui contrôlent l’économie, jamais en fonction de la satisfaction des besoins de la classe ouvrière qui regroupe l’immense majorité de la population[12].
Quant à elle, la CEQ dénonce l’utilisation de l’école comme outil de reproduction des classes sociales dans L’école au service de la classe dominante (1972). Malgré les différences idéologiques qui distinguent les trois manifestes, ils expriment tous la volonté d’inscrire le mouvement syndical dans un projet de transformation sociale radical qui passe par la montée en puissance des organisations des travailleurs et des travailleuses[13].
Les trois grandes centrales syndicales se rendent alors à la table de négociation avec les revendications suivantes : une hausse du salaire minimum hebdomadaire à 100 $, un salaire égal pour un travail égal indépendamment du sexe et de la région, des augmentations salariales d’au moins 8 %, une sécurité d’emploi complète et une égalisation, par la hausse, des avantages sociaux[14]. La stratégie du Front commun consiste notamment à faire valoir que ses objectifs sont légitimes pour l’ensemble de la force de travail, qu’elle soit employée par un État au service du capital ou par la classe capitaliste elle-même. Les gains obtenus par les employé·es du secteur public pourraient donc servir de levier pour les revendications des travailleur·ses du secteur privé. C’est toutefois avec l’hésitation et la retenue qui caractériseront la direction du Front commun durant tout le conflit que le lien entre l’État québécois et la classe capitaliste est critiqué[15]. Cela n’empêche pas le Conseil du Patronat du Québec, dans un rapport publié après les négociations, d’établir lui-même le lien entre ses intérêts et celui du Gouvernement provincial :
La rémunération offerte par le Gouvernement, en plus des effets d’entraînement qu’elle aura sur toute la structure des salaires et que l’on a eu tort de mésestimer à moyen et à long terme, rendra plus attrayant encore l’emploi dans le secteur public, créant ainsi à toutes fins pratiques une concurrence déloyale à l’endroit du secteur privé. Un deuxième effet sera l’obligation pour le secteur privé d’accroître ses salaires[16].
Les négociations entre les centrales syndicales traduisent déjà la dynamique interclassiste du Front commun. La revendication phare du salaire minimum de 100 $ par semaine met de l’avant les intérêts de ses membres les plus mal payés et vise ainsi à créer une base suffisamment large pour coaliser les couches les plus pauvres des classes subordonnées. Dans le même sens, la proposition initiale de la CSN inclut une modification des échelles salariales visant à réduire les écarts entre les hauts et les bas salaires. Notons que cette proposition aurait précisément eu pour effet de réduire les avantages socio-économiques d’une classe moyenne subordonnante alors en plein développement au Québec. Or, dans les négociations entre les centrales, cette proposition est refusée par la CEQ, dont une bonne partie des membres – notamment les enseignant·es du secondaire – tirent avantage des écarts salariaux importants. La valorisation des diplômes est priorisée par la CEQ, et ce, contre une politique salariale s’attaquant de façon somme toute timide aux écarts de rémunération[17].
Disons maintenant quelques mots sur le déroulement de la lutte elle-même. Après une première journée de grève le 28 mars, la grève générale illimitée est déclenchée le 11 avril 1972. Face à celle-ci, le gouvernement Bourassa recourt alors à une série d’injonctions contraignant les employé·es d’Hydro-Québec et des hôpitaux à maintenir le travail. Ces injonctions ne sont pas respectées, ce qui conduit à l’arrestation de plus de 70 personnes parmi la direction syndicale. Les sanctions se veulent alors exemplaires et plusieurs peines d’emprisonnement sont prononcées. La stratégie gouvernementale est de contraindre les employé·es du secteur public à rentrer au travail en ayant recours aux tribunaux et à des dispositions législatives coercitives. Cette tentative culmine avec le dépôt du projet de loi 19 qui suspend le droit de grève pour les employé·es du secteur public. La loi prévoit également que le gouvernement fixera par décret les conditions de travail si les parties ne parviennent pas à s’entendre avant le 1er juin. Face à cette menace, la direction du Front commun consulte ses membres en urgence. La participation à la consultation est assez faible, mais plus de 60 % des participant·es votent en faveur de la désobéissance civile[18]. Contre ce vote et après hésitation, les dirigeants du Front commun appellent au retour au travail. Cette décision est vécue comme une trahison et la rancœur est exprimée dès le lendemain au sein du Conseil central de Montréal de la CSN[19]. Nonobstant quelques initiatives éparses, le retour au travail est généralisé.
Bien qu’ils aient appelé à respecter la suspension du droit de grève prononcée par la loi 19, les chefs syndicaux Marcel Pépin (CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon Charbonneau (CEQ) sont arrêtés pour le non-respect des injonctions dans les hôpitaux et condamnés, le 8 mai, à la peine maximale d’un an d’emprisonnement. Ces condamnations marquent un tournant dans le Front commun qui déborde alors le cadre de la négociation syndicale pour devenir une véritable grève sociale. À partir de ce point, le prolétariat entre lui aussi dans la danse. Les ouvriers des ports et du Conseil des Métiers de la Construction de la FTQ initient un mouvement de grèves spontanées et illégales qui se propagent dans l’ensemble de la province. La grève dépasse maintenant largement les frontières du secteur public et la province est paralysée par plus de 300 000 grévistes qui exigent la libération des dirigeants syndicaux et l’abrogation de la loi 19. Dans des villes comme Montréal, Joliette, Thetford Mines et Saint-Jérôme, des usines sont occupées et dans plusieurs régions de la province, les radios passent momentanément sous le contrôle des grévistes. À Sept-Îles, de violents affrontements éclatent avec les forces policières, les commerces non essentiels sont fermés, la radio locale est occupée et la ville est proclamée sous le contrôle des travailleur·ses[20]. Néanmoins, l’occupation est de courte durée et sa fin est précipitée par une attaque à la voiture-bélier commise par un organisateur local du Parti libéral. Celle-ci fait des dizaines de blessé·es et tue le jeune travailleur Herman Saint-Gelais.
Face au développement incontrôlé de ce mouvement de grève, Robert Bourassa congédie le ministre de la Fonction publique Jean-Paul L’Allier et le remplace par Jean Cournoyer, quant à lui mandaté de reprendre les négociations avec le Front commun. Le 17 mai, les trois dirigeants syndicaux acceptent son offre et appellent – encore une fois – à reprendre le travail. Ils sont libérés provisoirement une semaine plus tard dans la foulée de l’appel de leur jugement, ce qui relance les négociations[21]. Le rapport de force instauré par la grève se manifeste à la table de négociation où le gouvernement accorde l’augmentation, étalée sur quatre ans, du salaire minimum à 100 $. Le Front commun parvient également à obtenir des augmentations salariales de 5 à 6 % ainsi que l’indexation partielle des salaires et des retraites sur l’inflation[22].
Au-delà des gains économiques, la grève générale de mai 1972 représente le point culminant d’une confrontation qui déborde du cadre syndical pour poser pratiquement, quoique très brièvement, la question du pouvoir ouvrier. Le fait que les dirigeants syndicaux aient dû appeler eux-mêmes deux fois à la reprise du travail montre bien que les limites d’une confrontation institutionnalisée ont effectivement été dépassées. Nous pouvons aussi parler de point culminant puisque la répression du Front commun et les divisions qu’il a fait naître ont empêché que cette dynamique conduise à une intensification de la lutte. Le lendemain de grève est particulièrement douloureux à la CSN, dont les syndicats d’hôpitaux cumulent des amendes d’environ 500 000 $[23]. Plus encore, la CSN subit une scission menée par Paul-Émile Dalpé, Jacques Dion et Amédée Daigle, trois membres du comité exécutif jugeant la ligne politique de Marcel Pépin trop radicale. Ils fondent alors la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) qui rassemble à ses débuts environ 30 000 membres, dont ceux des fédérations du textile et du vêtement qui passent en bloc de la CSN à la CSD[24]. La CSN perd alors une part importante de ses effectifs prolétariens issus du mouvement ouvrier traditionnel et se transforme graduellement en une centrale dominée par les salarié·es des secteurs public et parapublic. Dix ans plus tard, le mouvement syndical tentera de résister à une nouvelle confrontation entourant la négociation des conventions collectives. Mais ce n’est plus un gouvernement ouvertement et franchement bourgeois qui, cette fois, conduira les négociations du côté patronal : c’est face au gouvernement du Parti québécois de René Lévesque – parti ayant jusque-là entretenu le mythe d’un « préjugé favorable aux travailleurs » – que se trouveront les directions syndicales.
3. De la loi matraque au repli défensif : le Front commun de 1982-1983
Le Front commun de 1982-1983 survient dans un contexte radicalement différent. La crise économique et le chômage de masse créent des conditions de négociation largement défavorables aux employé·es de l’État. Au gouvernement, le Parti québécois en est à son deuxième mandat, lequel suit l’échec référendaire de 1980. Si ce mandat dissipera les doutes qui pouvaient subsister sur la nature de classe du PQ, celle-ci demeure l’objet de vifs débats durant la décennie 1970. L’exemple le plus frappant est probablement les trajectoires opposées suivies par Charles Gagnon et Pierre Vallières, deux anciens membres du FLQ. Alors que le premier rompt avec le nationalisme pour fonder En Lutte ! en 1972, le second publie L’Urgence de choisir où il récuse la violence révolutionnaire et la lutte immédiate pour le socialisme, tout en appelant à rejoindre les rangs du PQ. Les débats concernant le rapport à entretenir avec le PQ touchent également les centrales syndicales. Alors que la CSN apportera un appui « critique » au camp du « oui » pour le référendum de 1980, la FTQ, traditionnellement plus centriste, ira jusqu’à appeler à voter pour le PQ lors des élections de 1976 et de 1981[25]. Avant son deuxième mandat, le PQ pouvait encore se targuer d’avoir adopté certaines législations comme la loi 45 (adoption de la formule Rand) et la loi 17, qui répondent directement à certaines revendications syndicales, telles que l’interdiction d’embaucher des scabs ou encore l’adoption de mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail[26].
C’est donc face à un gouvernement réputé favorable aux revendications syndicales que s’amorcent, en 1982, les négociations avec un Front commun réunissant plus de 300 000 membres. Tel que mentionné, l’un des éléments centraux de la stratégie du Front commun de 1972 était d’arracher des gains pour les employé·es de l’État afin que ceux-ci puissent ensuite servir de levier pour les luttes du secteur privé[27]. Cette stratégie ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Pire, la partie patronale réussit le tour de force de se servir de l’écart salarial qui se creuse entre le secteur public et le secteur privé comme d’un prétexte pour justifier l’assainissement des finances publiques par des baisses salariales des employé·es de l’État. Cet argument devient central dans les décrets de 1982-1983 qui surviennent au moment où la récession économique du début des années 1980 fait bondir le taux de chômage, entraîne des pertes d’emplois massives dans le secteur manufacturier et aggrave l’endettement de l’État. Ce contexte rend difficile l’adoption d’une stratégie offensive pour un mouvement syndical déjà éreinté par les affrontements des années 1970.
Le gouvernement de René Lévesque décide alors de récupérer une part des augmentations salariales octroyées par la convention de 1979 en imposant aux employé·es de l’État une baisse salariale allant jusqu’à 20 % pour les trois premiers mois de 1983. Ces baisses salariales, confirmées par l’adoption sous bâillon de la loi 70, freinent la négociation et le Front commun tient une journée de grève illégale le 10 novembre 1982 afin d’obtenir son abrogation. Le gouvernement Lévesque décide alors d’enjamber la négociation en fixant par décret les conditions de travail de tous les employé·es de l’État et en révoquant au passage le droit de grève pour les trois années de la nouvelle convention collective[28]. Face à cette escalade, le Front commun voit la grève générale illimitée comme sa dernière arme et adopte une stratégie de grève « en cascade » qui intégrera progressivement différentes franges des secteurs public et parapublic à partir du 26 janvier 1983[29]. Devant une mobilisation timide, le gouvernement décide d’aller encore plus loin : le 17 février, le projet de loi 111 est adopté à l’Assemblée nationale. Cette « loi matraque » prévoit des mesures répressives sans précédent, dont l’augmentation des amendes quotidiennes, la perte de trois années d’ancienneté pour chaque jour de grève et la possibilité d’effectuer des congédiements sommaires. Le lundi 21 février, le retour au travail est généralisé et les négociations subséquentes n’apportent que des modifications mineures aux décrets gouvernementaux[30].
La répression du Front commun de 1982-1983 et plus particulièrement les dispositifs de la loi 111 représentent un tournant dans la conflictualité entre les classes sociales au Québec. En plus de pénaliser les élu·es des syndicats et les associations syndicales elles-mêmes, cette loi s’attaque aux syndiqué·es pris·es individuellement afin de les amener à se désolidariser de leurs organisations. Cette stratégie est énoncée explicitement par le ministre du Revenu Alain Marcoux qui défend « des sanctions touchant les individus plutôt que les syndicats, qui n’attendent que le contraire pour pouvoir se porter à la défense du syndicalisme » tout en affirmant que « la seule façon d’obtenir le retour au travail sera de mettre chaque individu devant une décision personnelle[31] ». L’arrestation « exemplaire » des dirigeants syndicaux en 1972 avait provoqué une intensification du conflit qu’on tente désormais d’empêcher par une logique de répression individuelle. Le gouvernement ouvre ici la voie pour une classe capitaliste qui tend à sortir d’une logique de confrontation institutionnalisée avec les organisations syndicales pour privilégier une négociation des conditions de travail de plus en plus individualisée.
Si le Front commun de 1972 représente le paroxysme du cycle de lutte précédent, on peut considérer que celui de 1982-1983 le clôture définitivement. Ce qui s’évanouit à ce moment, ce n’est pas tant la capacité des syndicats à organiser des salarié·es et à les mobiliser. Comme l’illustre l’exemple du Front commun de 2023, les mobilisations syndicales parviennent encore à arracher des gains au niveau des conditions de travail. Ce qui s’est radicalement transformé depuis, c’est avant tout la capacité des organisations syndicales à se présenter et à se faire reconnaître comme porteuses d’un projet de rupture. La création du Fonds de solidarité FTQ en 1983 en est peut-être la meilleure illustration. Au plus loin de s’inscrire dans une perspective subversive, la FTQ décide alors, avec l’appui du gouvernement provincial de René Lévesque et, ensuite, du gouvernement fédéral de Brian Mulroney, de créer un fonds d’investissement qui permettra de financer des entreprises afin de préserver ou de créer des emplois[32]. La dynamique qui s’ouvre à partir des années 1980 est ainsi axée sur un « partenariat », une « concertation » non contraignante où les organisations syndicales tentent de préserver les emplois des secteurs menacés par la restructuration et de minimiser la dégradation des conditions de travail[33]. Ce repli défensif est formulé explicitement par le comité exécutif de la CSN qui affirme, lors de son congrès de 1990, que « la résistance aux attaques et le maintien de nos acquis doivent être considérés comme des victoires[34] ».
Ce changement de paradigme s’exprime aussi statistiquement lorsqu’on s’intéresse à la moyenne annuelle des jours-personnes non travaillés. Alors qu’elle s’élève à 2 719 000 pour la décennie 1970, elle baisse à 1 878 000 pour la décennie 1980 et à 561 000 pour la décennie 1990. Durant la décennie suivante, elle remonte légèrement à 610 000[35]. Durant cette période, les conflits de travail tendent également à toucher de moins en moins de travailleur·ses par conflit et ils durent en moyenne plus longtemps, ce qui exprime une tendance à l’isolement et une difficulté à arracher des gains rapides[36].
Ce n’est pas qu’au niveau syndical qu’on peut mesurer le changement du rapport de force. Comme nous l’avons mentionné, les années 1960-1970 voient apparaître une véritable base favorisant l’activité subversive avec les comités d’action politique, les journaux et les groupes révolutionnaires, les librairies socialistes et les organisations féministes radicales. À partir de la seconde moitié des années 1970, ce sont principalement les groupes marxistes-léninistes qui parviennent à concentrer et à faire croître ce qu’on peut appeler les « forces révolutionnaires ». Le groupe marxiste-léniniste En Lutte ! s’exporte alors dans le reste du Canada, ses membres triplent et son journal hebdomadaire atteint un tirage moyen de 7 000 exemplaires[37]. En 1979, le groupe se constitue en organisation « préparti », considère que le moment est venu de rallier la classe ouvrière et d’unifier les marxistes-léninistes du monde entier. Seulement trois ans plus tard, l’organisation se dissout[38]. Le Parti communiste ouvrier (PCO, ex-Ligue communiste) connaît le même sort au début de l’année 1983. En seulement quelques années, des organisations qui diagnostiquaient l’imminence de la révolution et qui aspiraient à diriger celle-ci en sont venues à la conclusion qu’il était temps de mettre la clé sous la porte.
4. Quant à la suite…
Mesurer l’ampleur des changements structurels qui ont eu cours lors des dernières décennies nous pousse maintenant à tirer un certain nombre de conclusions sur les formes que risquent de prendre d’éventuels conflits de classe au Québec. Au nombre de ces conclusions, on peut confirmer que le prolétariat a en grande partie perdu le principal levier dont il disposait afin d’améliorer ses conditions d’existence et, plus particulièrement, afin d’améliorer ses conditions de travail. Bien qu’elles soient interclassistes depuis très longtemps, les centrales syndicales se distinguent désormais par la prépondérance des professionnel·les du secteur public, c’est-à-dire par celle des membres de la classe moyenne subordonnante. Dans ce contexte, la défense des avantages associés à certains emplois de la CMS tend à occuper une place de plus en plus centrale dans le discours et l’activité des centrales syndicales. On tente alors de faire reconnaître la valeur particulière de certaines professions, leur importance décisive pour les services publics québécois ou encore le décalage entre la rémunération de certaines professions traditionnellement féminines du secteur public et des professions analogues traditionnellement masculines du secteur privé. S’ils font voir, à juste titre, les effets des rapports sociaux de sexe sur la distribution des avantages sociaux, ces lignes d’argumentation reconduisent néanmoins l’idée qu’il est normal, bon et acceptable qu’il existe des écarts salariaux importants, des rapports hiérarchiques dans l’organisation du travail ou encore des privilèges réservés à certaines fonctions. On pourra encore lancer des appels sincères à la solidarité et à l’organisation de mobilisations interclassistes, mais il apparaît toujours naturel, au final, que certain·es s’en tirent mieux que d’autres.
Le Front commun de 2023 est un exemple illustratif de cette tendance, dans la mesure où ce sont d’abord les enseignant·es des niveaux préscolaire, primaire et secondaire qui ont réussi à capter l’attention médiatique et à se présenter comme un rempart contre « la détérioration du système public d’éducation québécois[39] ». La combativité dont ont fait preuve les membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), en grève générale illimitée pendant plus d’un mois au courant de l’automne 2023 (et ce, sans fonds de grève), explique en grande partie l’importance qu’a prise la situation particulière de ces enseignant·es dans la négociation des conventions collectives. Ce qui est néanmoins digne de mention, c’est l’aisance avec laquelle leur propre discours, dans lequel la qualité du système d’éducation est directement identifié à l’obtention de bonnes conditions de travail pour eux et elles-mêmes, est parvenu à s’imposer. Ce lien n’est évidemment pas dépourvu de fondement. Toutefois, ce qui peut surprendre, c’est à quel point les enjeux liés à la préservation et aux fins du système d’éducation public ont été aussi rapidement écartés et réduits à une question de salaire : les revendications relatives à la composition des classes et à la lourdeur de la tâche ont été négligées et une bonification de l’échelle salariale s’ajoutant aux augmentations octroyées à l’ensemble des membres du Front commun a finalement été suffisante pour amener les enseignant·es à cesser ce qu’on a présenté comme une lutte pour la « survie du système public »[40]. Certes, à travers l’appui que les grévistes ont reçu de la population, il est clair que cette dernière sent que la qualité du système d’éducation public est plus ou moins étroitement liée aux conditions de travail des enseignant·es. Néanmoins, si ces conflits continuent de se régler presque exclusivement par des augmentations salariales, on peut présumer qu’un tel appui s’amenuisera et que les membres de la CMS des secteurs publics et parapublics auront de plus en plus de difficulté à se présenter comme les champions du « bien commun ».
En réalité, le fait que les effectifs syndicaux appartiennent à des classes diverses réduit la base commune sur laquelle de puissantes luttes syndicales peuvent être menées. Plutôt que de former un bloc relativement homogène capable de faire front contre un ennemi commun, les centrales syndicales sont, une fois les conflits parvenus à un certain degré de développement, placées devant la nécessité de favoriser l’un ou l’autre des groupes relativement antagonistes qu’elles représentent. Cela ne se manifeste pas nécessairement lorsque les revendications restent sur des positions défensives ou lorsqu’elles réclament des gains modestes. Toutefois, dès que les revendications de syndiqué·es issu·es des classes subordonnées en viendront à remettre en question la grandeur des écarts de salaire, la hiérarchie du travail ou encore les privilèges associés au travail intellectuel, elles ne manqueront pas d’entrer en conflit avec les intérêts d’une part importante des effectifs syndicaux. Si pour compenser la désaffection des membres des classes subordonnées, les centrales syndicales n’ont pas le choix de représenter les membres de la CMS – dont les privilèges sont le corollaire de la subordination des classes subordonnées –, elles doivent aussi se résoudre à mener une existence double et conflictuelle. À l’occasion des fronts communs, c’est précisément sur cela que peut jouer l’État afin de les faire plier.
Il faut par ailleurs voir que le poids grandissant que prennent les emplois précaires et atomisés au sein du prolétariat ne peut manquer d’affecter les formes que prennent ses luttes. Cette atomisation et cette précarité se traduisent notamment par un taux de syndicalisation plus faible, comme c’est le cas du secteur des services marchands. Les emplois qui appartiennent à ce secteur sont en effet considérés comme difficiles, voire impossibles à syndiquer[41]. Le taux de roulement élevé qui y prévaut renforce leur précarité qui, elle, affaiblit en retour la possibilité qu’ils ont d’être syndiqués, ce qui augmente encore leur taux de roulement et ainsi de suite. Mais il existe d’autres facteurs qui viennent affaiblir la capacité des prolétaires à se défendre à travers leur syndicat. Le cas des travailleur·ses temporaires étranger·ères est à cet égard particulièrement significatif. Dans certaines entreprises, ces travailleur·ses représentaient, jusqu’à la récente révision des seuils d’immigration, le cinquième des salarié·es[42]. Abstraction faite de la difficulté qui existe à s’organiser avec des collègues allophones, rappelons que les conditions dans lesquelles s’effectue le travail étranger temporaire sont tellement précaires qu’il est virtuellement impossible que ces travailleur·ses entrent dans un rapport confrontationnel avec leur employeur·e[43]. En effet, les contraintes sociales et matérielles qui accompagnent ce statut sont si fortes qu’elles affectent nécessairement de manière négative la capacité du reste des prolétaires de ces entreprises à lutter sur leur milieu de travail. Ce phénomène est notamment renforcé par le recours aux agences de placement de main-d’œuvre, pratique particulièrement répandue dans le secteur du transport et de l’entreposage. Non seulement cette main-d’œuvre est le plus souvent issue de l’immigration récente, voire de l’immigration informelle, mais sa gestion externalisée a pour effet de segmenter encore davantage les travailleur·ses au sein des milieux de travail : plutôt que de faire face, en masse, aux mêmes employeur·es, ces prolétaires d’origines diverses sont lié·es, par l’entremise de leur contrat de travail, à des employeur·es différent·es pour des taux de salaire différents[44]. La collectivisation des conflits de travail, « le passage au collectif » comme dirait Kergoat[45], est alors pratiquement bloqué.
À l’autre extrémité, la partie patronale fait manifestement preuve d’une virulence de plus en plus grande pour freiner les luttes. D’un côté, la Loi sur les services essentiels empêche, au Québec, toute forme de débrayage significatif des travailleur·ses du secteur public, même si pour l’heure, aucune mesure aussi systématique et « efficace » n’existe dans le secteur privé (bien que les associations patronales en fassent périodiquement la demande[46]). À toutes fins pratiques, les salarié·es concerné·es par cette loi n’ont pas le droit de grève. Du côté du secteur privé toutefois, les gouvernements sont de plus en plus enclins à voter des lois spéciales qui forcent le retour au travail en imposant une convention collective aux deux parties en litige. Dans le secteur de la construction, ces lois spéciales sont devenues rituelles et tendent à faire de même dans celui du transport et de la logistique. Ce qui se joue là est particulièrement significatif, en ce sens que l’outil de la grève apparaît avoir perdu son sens. À quoi bon perdre plusieurs jours de salaire à débrayer si l’on sait qu’à terme, une loi spéciale forcera le retour au travail et fixera ses conditions ? Lorsque le cadre légal au sein duquel les luttes peuvent être menées est aussi restreint, on peut douter de l’efficacité des organisations qui renoncent à outrepasser ce cadre.
Si les changements qui affectent les modalités de la lutte des classes depuis cinq décennies ne doivent pas être assimilés à son évanouissement pur et simple, il faut reconnaître qu’ils s’inscrivent dans une modification du rapport de force qui a lieu au profit du capital. D’une part, la difficulté à s’organiser à l’intérieur d’un cadre institutionnalisé réduit la probabilité pour le prolétariat et la classe moyenne subordonnée de voir leurs luttes déboucher sur des gains substantiels. Aussi critiquables soient les syndicats, la syndicalisation d’un milieu de travail permet le recours à certaines formes de lutte revendicative dont l’efficacité n’est plus à prouver. Or, ce sont ces formes qui sont de moins en moins accessibles aux membres des classes subordonnées. D’autre part, nous avons vu que même lorsque leurs luttes sont effectivement menées dans un cadre légal, elles sont renvoyées dans l’illégalité dès l’instant où elles semblent menacer la bonne marche de l’accumulation. Autrement dit, la modification des modalités de la lutte des classes coïncide, de façon plus ou moins étroite, avec l’incapacité grandissante des classes subordonnées à faire valoir leurs intérêts.
Pour toutes ces raisons, on peut d’autant moins s’attendre à ce que les centrales syndicales fonctionnent comme le catalyseur d’un projet de transformation sociale radicale qui prendrait en charge les intérêts spécifiques des classes subordonnées et, à plus forte raison, du prolétariat. Une telle affirmation peut avoir l’air d’une banalité. Néanmoins, il faut insister sur le fait que cette situation n’est pas imputable à un simple problème de discours, à un esprit de défaite endémique depuis les années 1980 ou encore à une perpétuelle trahison de la part d’une direction syndicale qui refoulerait sans cesse les désirs révolutionnaires de la base. Au contraire, les configurations sociales et matérielles nécessaires à la constitution d’organisations prolétariennes fortes (concentration de la force de travail prolétarienne dans de grandes unités de production et dans des quartiers socialement homogènes, prédominance de l’emploi à temps plein, existence d’une culture « ouvrière » nationale, etc.) ont été balayées avec la restructuration néolibérale. Le capital n’accepte tout simplement plus de voir en face de lui un prolétariat organisé, discipliné et prévisible. On ne se le soumet plus en l’encadrant et en adoucissant ses conditions d’existence, mais en lui cassant les reins : on ne permet plus que ses luttes débouchent sur sa confirmation en tant que classe et encore moins en tant que classe aspirant à gérer la société sur sa propre base. Le statut de classe, c’est précisément ce qu’on lui refuse. On peut certainement le déplorer, mais encore faut-il le reconnaître.
Cette situation de blocage nous force à porter une attention plus soutenue aux formes modifiées que prennent les luttes des classes subordonnées afin de résister à l’exploitation. En dépit de la résurgence relative des conflits de travail durant la dernière décennie[47], on peut s’attendre à ce que leurs luttes s’expriment de moins en moins directement sur les lieux de travail. Comme on l’a vu, non seulement les syndicats représentent très imparfaitement les classes subordonnées, mais la rigidité des contraintes à l’exercice du droit de grève et le recours aux lois spéciales ne peuvent que décourager de telles pratiques de lutte. Or, lorsqu’elles rompent avec la légalité, les confrontations directes sur les lieux de travail sont sujettes à une répression telle qu’en l’absence de mouvement social important, elles ne peuvent manquer de se limiter à des formes de résistance individuelles (vol, sabotage, absentéisme, etc.) qui sont, par le fait même, beaucoup moins efficaces.
Si les formes traditionnelles de résistance à l’exploitation semblent avoir peu d’avenir du point de vue de leur capacité à mobiliser de larges fractions du prolétariat et de la classe moyenne subordonnée, il semble tout à fait envisageable que la question des conditions de travail et de sa rémunération laisse de plus en plus la place à celle des conditions de vie[48]. Le problème du coût et de la qualité des logements, du prix des produits alimentaires, des frais associés au transport ou encore du profilage et des violences policières représentent tous des terrains où les conflits de classes peuvent s’exprimer intensément, quoiqu’indirectement. L’intensité de ces luttes peut croître rapidement puisqu’elles tendent, en recourant au pillage des magasins, au sabotage de moyens de transport et de communication ou à la prise d’assaut des lieux de pouvoir, à s’attaquer à ce que l’État d’une société capitaliste doit à tout prix protéger, à savoir : la propriété privée[49]. Et contrairement aux luttes qui naissent autour de conflits de travail, celles qui tournent autour des conditions de vie sont beaucoup moins faciles à organiser et à inscrire dans une stratégie à long terme. Elles éclatent, tout simplement.
Si la faiblesse ou la quasi-absence de structures organisationnelles déjà établies mine la capacité des protagonistes de ces luttes à se coordonner et à persévérer malgré la répression et les revers momentanés, elles sont aussi, par le fait même, beaucoup moins faciles à encadrer. Autrement dit, puisqu’il est plus difficile pour des « chefs » – pour ceux et celles qui sont à la tête d’organisations ou qui cherchent à en prendre la direction – de les canaliser dans un sens ou dans l’autre, elles apparaissent en retour plus difficile à saboter par le haut. En fait, il n’existe plus d’organisations disposant de l’autorité nécessaire pour freiner un mouvement de lutte sérieux. Ce serait idéaliser le cycle de luttes précédent que de fermer les yeux sur les dégâts que causait la mise sous tutelle du prolétariat par des « révolutionnaires professionnels » ou proclamés tels. Le principe de la représentation, celui de délégation de l’autonomie, l’idée selon laquelle un mouvement ne peut être efficace si les décisions importantes ne sont pas prises par un petit nombre de leaders, le respect de la discipline du parti, l’étapisme ou encore l’idée qu’il faille fonder un État ouvrier fort, sont tous des éléments définitoires du cycle de lutte précédent qui affectaient négativement la capacité des prolétaires à s’auto-transformer et à prendre les mesures qu’imposaient certaines situations critiques. Entendons-nous, nous ne soutenons pas que les prolétaires d’aujourd’hui sont à un poil de parvenir à une conscience communiste ou de lutter en ce sens de façon conséquente. Ce dont il s’agit, c’est de faire voir que les obstacles que nous avons énumérés ne sont plus immanents aux luttes du prolétariat. Par opposition au cycle de lutte précédent, la condition ouvrière n’est plus quelque chose qu’on cherche à éterniser, il n’y a plus de comité central auquel obéir aveuglément, plus de pseudo « patrie socialiste » au nom de laquelle les intérêts des mouvements de luttes locaux peuvent être sacrifiés. Ce qui est impliqué par là, c’est que l’idéologie du programme prolétarien ne s’interpose plus entre la conscience des prolétaires et ce qu’ils et elles doivent accomplir pour faire progresser la lutte dans un sens communiste.
Par rapport au cycle de luttes précédent, on peut donc s’attendre à ce que les luttes soient moins dépendantes de la puissance d’organisations révolutionnaires formelles. Il est évident qu’il s’agit encore ici d’une question de degré : le succès des luttes précédentes n’était pas suspendu à l’habileté de quelques chefs et, inversement, les luttes actuelles continueront d’être affectées par l’action de minorités agissantes et nécessiteront des formes d’organisation efficaces pour conduire à des transformations durables. Mais le cours des luttes présentes et à venir tendra vraisemblablement à être davantage déterminé par des facteurs structurels et conjoncturels « objectifs ». L’exemple des émeutes des Gilets jaunes en 2018-2019, des evasiones masivas dans le métro de Santiago au Chili en 2019 ou encore de la situation insurrectionnelle au Kazakhstan en 2022 illustrent bien cette tendance. Ni leur éclatement ni leur fin n’ont été dépendants de la volonté d’organisations quelconque[50]. Certes, au Québec, il n’existe pas encore de précédent nous permettant d’affirmer que cette tendance à l’éclatement soudain et violent de conflits de classes soit déjà à l’œuvre, bien que les conditions pour que de telles éruptions se produisent semblent être de plus en plus réunies.
Ces luttes qui, dans les dernières années, sont sorties d’un cadre strictement revendicatif et qui ont mobilisé des moyens d’action plus musclés ont bel et bien traduit des antagonismes de classes, mais de façon détournée. Si cette traduction est indirecte, c’est parce que les intérêts opposés qui s’affrontent le font dans un cadre extérieur au rapport qui les fait naître (le travail exploité et/ou subordonné). Dans ces luttes, prolétaires et capitalistes ne s’affrontent pas en tant que tel·les, même si c’est bien, en dernière instance, de leur rapport dont il est fondamentalement question. C’est parce que l’exploitation empêche les prolétaires et membres de la classe moyenne subordonnée de vivre convenablement qu’il y a lutte sur le terrain des conditions de vie. C’est parce que la classe capitaliste veut continuer à tirer de la plus-value du prolétariat qu’elle a intérêt à ce qu’on trouve une solution qui lui soit favorable, qu’elle a intérêt à ce que les conflits s’expriment « pacifiquement » et que les « violents casseurs infiltrés » soient traduits en justice. Or, dans une grève concernant les conditions de travail ou les salaires, on peut aisément identifier les agents qui s’affrontent et on comprend facilement que ce qui est perdu d’un côté est gagné de l’autre. Cela demeure vrai même lorsqu’il se crée un mouvement de grève massif qui s’étend et débouche sur des situations émeutières, voire insurrectionnelles : l’exploitation, le rapport de classe à classe, continue de représenter l’enjeu central. Mais dans une lutte contre la vie chère, il faut faire un effort supplémentaire pour identifier les antagonismes qui la sous-tendent et qui conditionnent son développement. Dans de pareilles luttes, c’est l’État qui est désigné comme l’interlocuteur privilégié, puisque c’est à lui qu’on impute la responsabilité de la situation à laquelle on s’attaque, ce qui, encore une fois, a pour résultat de voiler ce qui rend structurellement incompatible les intérêts des un·es et des autres.
Dans ces situations, on verra typiquement émerger des identités politiques générales comme le « 99 % », les « classes populaires », les « gens ordinaires » ou encore le bon vieux « peuple ». Ce qui est certain, c’est qu’on n’assistera pas au grand retour de la « classe ouvrière » ou du « prolétariat » en tant qu’identité politique portée massivement par des prolétaires. Certes, on trouvera toujours ici ou là des prolétaires capables de se reconnaître dans ces catégories, mais il faut admettre que le mot « prolétariat » se retrouve bien davantage dans la bouche des membres (ou aspirants membres) de la CMS friands de théorie marxiste que dans celles des travailleur·ses productif·ves subordonné·es. Cet état de fait n’est pas entièrement à déplorer. Il ne faut pas oublier que la reproduction d’une identité ouvrière à laquelle s’identifiait fièrement une partie du prolétariat était aussi un obstacle, dans le cours des luttes, à la reconnaissance du caractère imposé et contraignant de l’appartenance de classe, de même qu’à la nécessité de s’y attaquer en s’en prenant à la racine de l’exploitation capitaliste plutôt qu’à la stricte propriété des moyens de production. L’identité ouvrière, c’était aussi l’illusion selon laquelle la condition ouvrière est en elle-même porteuse d’un devenir communiste.
Après tout ce chemin parcouru, on pourrait ici poser la question suivante : ces constats ne sont-ils pas justement l’indice du fait que l’analyse en termes de classes est devenue caduque, en ce qu’elle serait en porte-à-faux avec la manière dont sont menées les luttes ? Ne devrait-on pas prendre celles-ci comme elles se donnent, avec le discours et les identités politiques qu’elles produisent ? Nous pensons que tous ces éléments conduisent précisément à la conclusion inverse. Les formes de lutte envisageables rassembleront nécessairement des membres de différentes classes, et ce, sous des étiquettes communes qui ont pour effet de rendre invisibles les rapports de force qui se jouent nécessairement au sein même des luttes. La confusion est donc inévitable. Lorsqu’on nous dit que « tout le monde est dans le même bateau », que « l’unité est nécessaire pour atteindre nos objectifs », il faut être en mesure de déterminer qui se trouve dans le bateau, qui est à ses commandes et à qui bénéficie le maintien de la lutte dans ses limites actuelles. Autrement dit, pour saisir ses potentialités, sa dynamique et ses obstacles inévitables, il faut nécessairement être en mesure de déterminer la composition de classe d’une lutte donnée. C’est ce à quoi cherche à contribuer un travail comme le nôtre. S’il est vrai que tout le monde n’a pas également intérêt à rompre avec l’organisation actuelle de la société, ceux et celles qui y ont effectivement intérêt ne peuvent que gagner à y voir plus clair.
[1]. Michel Chartrand, Charles Gagnon, Robert Lemieux, Jacques Larue-Langlois et Pierre Vallières, Le procès des Cinq, préface de Louis Hamelin, Montréal, Lux Éditeur, coll. « Mémoires des Amériques », 2010, p. 9.
[2]. Direction des études et de l’information sur le travail, La présence syndicale au Québec et au Canada en 2022, Ministère du Travail, 2023, p. 6. En 2022, le taux était de 39,1 % au Québec, de 26,5 % en Ontario, de 29,4 % dans le reste du Canada et de 11,3 % aux États-Unis.
[3]. Rouillard, Le Syndicalisme québécois, p. 286-289.
[4]. Institut de la statistique du Québec, Taux de présence syndicale, résultats selon le sexe pour diverses caractéristiques de la main-d’œuvre et de l’emploi, 2006-2023 Québec, Ontario et Canada. Le taux de présence syndicale indique le pourcentage d’employé·es ayant une convention collective.
[5]. Martin Petitclerc et Martin Robert, Grève et paix : une histoire des lois spéciales au Québec, Montréal, Lux Éditeur, 2018, p. 17.
[6]. Ibid., p. 31.
[7]. Institut de la statistique du Québec, Taux de présence syndicale, résultats selon le sexe pour diverses caractéristiques de la main-d’œuvre et de l’emploi, 2006-2023 Québec, Ontario et Canada.
[8]. Ibid.
[9]. Ibid.
[10]. En plus des deux grands fronts communs intersyndicaux de 1972 et de 1975-1976, soulignons le lock-out de La Presse en 1971, marqué par la suspension du droit de manifester par la ville de Montréal et par la répression brutale de la manifestation du 29 octobre qui conduit à l’arrestation de centaines de personnes, à quelque 300 blessé·es et à la mort de la militante Michèle Gauthier. Notons également la grève de l’usine de caoutchouc Firestone à Joliette en 1973, appuyée par le Comité de solidarité avec les luttes ouvrières (CLSO, comité constitué notamment de groupes révolutionnaires comme En Lutte !) et celle de l’usine d’aéronautique United Aircraft de Longueuil en 1974-1975. Un autre événement qui mérite mention est l’occupation de l’usine Tricofil de Saint-Jérôme en 1972 et sa réouverture sous autogestion ouvrière de 1974 à 1982. À ce sujet, cf. Archives Révolutionnaires, C’est notre lutte ! Groupes ouvriers et populaires au Québec (1970-1975), Montréal, Archives Révolutionnaires, 2023.
[11]. Petitclerc et Robert, Grève et paix, p. 64. Rappelons que la loi fédérale sur les mesures de guerre qui suspend les libertés civiles a été appliquée uniquement trois fois entre son adoption en 1914 et son abrogation en 1988, à savoir : lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la crise d’Octobre 1970.
[12]. Fédération des travailleurs du Québec, L’État rouage de notre exploitation, Montréal, M Éditeur, coll. « Mouvements », 2012 [1971], p. 26.
[13]. Ajoutons à cela la publication de la brochure Pour l’organisation politique des travailleurs québécois (1971) diffusée massivement par le comité d’action politique de Saint-Jacques qui appelle à l’organisation des travailleur·ses en « force politique révolutionnaire ». Ce comité d’action politique et tous ceux qui émergent au tournant des années 1970 s’inscrivent notamment dans la stratégie du « deuxième front » portée par des militant·es de la CSN qui souhaitent élargir le champ de la lutte afin de créer les conditions d’un pouvoir politique et économique populaire.
[14]. Diane Éthier, Jean-Marc Piotte et Jean Reynolds, Les travailleurs contre l’État bourgeois, Montréal, Les Éditions de l’Aurore, 1975, p. 60
[15]. Ibid., p. 69-71.
[16]. Conseil du Patronat du Québec, « Dossier sur la rémunération des travailleurs de l’État », cité dans Éthier, Piotte et Reynolds, Les travailleurs contre l’État bourgeois, p. 68.
[17]. Éthier, Piotte et Reynolds, Les travailleurs contre l’État bourgeois, p. 56.
[18]. Petitclerc et Robert, Grève et paix, p. 64-67.
[19]. Éthier, Piotte et Reynolds, Les travailleurs contre l’État bourgeois, p. 101.
[20]. Archives révolutionnaires, C’est notre lutte !, partie II.
[21]. Petitclerc et Robert, Grève et paix, p. 68-69.
[22]. Ibid., p. 70.
[23]. Ibid.
[24]. Éthier, Piotte et Reynolds, Les travailleurs contre l’État bourgeois, p. 109-111.
[25]. Rouillard, Le Syndicalisme québécois, p. 196.
[26]. Ibid., p. 195-196.
[27]. Ibid., p. 184.
[28]. Petitclerc et Robert, Grève et paix, p. 99-101.
[29]. Ibid., p. 107.
[30]. Ibid., p. 114-118.
[31]. Ibid., p. 114.
[32]. Jacques Boucher, « Les syndicats : de la lutte pour la reconnaissance à la concertation conflictuelle », dans Le Québec en jeu, Gérard Daigle (dir.), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1992, p. 121.
[33]. La grève des employé·es du câblodistributeur Vidéotron de 2002-2003 est une bonne illustration d’une lutte menée essentiellement pour minimiser les dégâts. Cette grève survient au moment où Vidéotron demande à ses 2 200 employé·es d’augmenter leur semaine de travail de 35 à 37,5 heures sans augmentation salariale, de geler les échelles salariales pour trois ans, de réduire le nombre de congés, et ce, tout en planifiant de se départir de 660 technicien·nes. Les travailleurs et les travailleuses rejettent ces demandes à plus de 99 % et déclenchent une grève qui est suivie, 15 minutes plus tard, d’un lock-out de l’employeur. Le conflit de travail est ensuite marqué par l’embauche de scabs, par le sabotage de câbles de diffusion et par des poursuites judiciaires. Le conflit se conclut finalement par un accord négocié sous la médiation de l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, accord qui officialise la plupart des reculs concernant les conditions de travail à l’exception du transfert des technicien·nes. Cf. Rouillard, Le Syndicalisme québécois, p. 275-277.
[34]. Ibid., p. 215.
[35]. Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail. Portrait historique des conditions et de la dynamique du travail, vol. 1, no 2, 2005, p. 217-218 et vol. 6, no 2, p. 221. Un jour-personne non travaillé correspond à une journée de travail d’une personne qui n’est pas effectuée en raison d’un conflit de travail.
[36]. Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail. Portrait historique des conditions et de la dynamique du travail, vol. 1, no 2, 2005, p. 223-224.
[37]. Charles Gagnon, En Lutte !, écrits politiques, vol. 2, 1972-1982, Montréal, Lux Éditeur, 2008, p. 371-373.
[38]. En vue du quatrième et dernier congrès d’En Lutte !, Charles Gagnon publie Sur la crise du mouvement marxiste-léniniste (1981), texte dans lequel il tente de diagnostiquer les raisons de la perte de vitesse de l’organisation. Gagnon identifie des causes internes comme le rôle trop important des intellectuels, la révolte des femmes face à ce qu’il nomme pudiquement le « chauvinisme » masculin ou encore l’erreur tactique concernant la question référendaire. Toutefois, il insiste sur l’importance de la crise internationale du mouvement marxiste-léniniste et sur le changement profond de la conjoncture économique et politique. Autrement dit, il aperçoit la profondeur des transformations qu’entraînera la restructuration et, corollairement, la caducité de la stratégie qui était celle d’En Lutte !. Cf. Ibid., p. 317-368.
[39]. L’expression est de la Présidente de la FAE. Bien que la FAE ne faisait pas à proprement parler partie du Front commun, sa grève illimitée de novembre-décembre a accompagné les journées de grève du Front commun. Au moment où ces lignes sont écrites, l’article en deux parties de Martin Gallié et d’Elsa Gallerand demeure le compte rendu le plus détaillé de la lutte de 2023 entre les enseigntant·es et l’État provincial. Cf. Martin Gallié et Elsa Galerand, « La grève illimitée de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) de novembre-décembre 2023 », Chronique des conflits de travail, no 3, Montréal, GIREPS, 2024.
[40]. FSE-CSQ, Négociation des enseignants – La FSE-CSQ et l’APEQ confirment l’obtention d’un règlement sectoriel, 14 février 2024. On doit néanmoins reconnaître que l’entente sectorielle a été considérée comme insatisfaisante au niveau des conditions de travail, particulièrement sur la question de la composition des classes. Il faut aussi noter que le résultat des votes sur l’entente de principe à la FAE illustre la division au sein même des enseignante·es : cinq des neuf syndicats adoptent l’entente, mais la somme des voix contre celle-ci s’élève à 54 %. L’entente est alors considérée comme adoptée. Cf. Gallié et Gallerand, « La grève illimitée de la FAE », partie 2, p. 28.
[41]. Et ces difficultés ne sont pas propres à ce secteur, comme en atteste le cas très médiatisé des entrepôts d’Amazon. Le 10 mai 2024, les quelque 300 employé·es de l’entrepôt DXT4 de Laval se syndiquaient et s’affiliaient à la CSN, une première au Canada. C’était le second entrepôt de la compagnie à se syndiquer en Amérique du Nord, après celui de Staten Island, NY en avril 2022 (5 000 travailleur·ses). Or, le 22 janvier 2025, Amazon annonçait la fermeture de la totalité de ses installations au Québec (totalisant 2 000 salarié·es), entraînant par le fait même le licenciement de 2 700 livreur·ses employé·es par des entreprises de livraison sous-traitantes (Olivier Larose-Desnoyer, « Fermeture d’Amazon au Québec : près de 4700 emplois perdus », Le Journal de Montréal, 31 janvier 2025). La syndicalisation d’un entrepôt représentant tout au plus 15 % de la main-d’œuvre québécoise d’Amazon (et 6 % en incluant les entreprises sous-traitantes) aura duré sept à huit mois et n’aura jamais abouti à l’établissement d’une convention collective… Cet exemple ne saurait mieux illustrer la teneur des difficultés auxquelles font face les prolétaires précarisé·es lorsqu’ils et elles cherchent à s’associer pour résister à leur exploitation dans un cadre néolibéral.
[42]. Sarah R. Champagne et Jean-Louis Bordeleau, « Le moratoire sur l’embauche de travailleurs étrangers temporaires critiqué de toutes parts », Le Devoir, 20 août 2024.
[43]. En effet, outre la menace diffuse de perdre leur permis de travail et donc d’être expulsé·es vers leur pays d’origine (il s’agit, rappelons-le, de permis de travail fermé, qui lie la personne migrante à un·e employeur·e), ces travailleur·ses doivent assumer eux et elles-mêmes les coûts liés à l’obtention d’un nouveau permis, en plus de devoir survivre dans l’intermède. Cf. Sarah R. Champagne, « Le Canada, “terreau fertile” pour l’esclavage moderne: le rapporteur de l’ONU persiste et signe », Le Devoir, 13 août 2024. Voir aussi le rapport d’Amnistie Internationale : « Le Canada m’a détruite ». Exploitation des travailleuses et travailleurs migrants au Canada, janvier 2025.
[44]. On peut se référer au rapport cité plus haut du GIREPS, du CTTI et de l’ATTAP (Mobiliser pour la santé et la sécurité du travail dans les entrepôts : des travailleurs et travailleuses d’agences au taylorisme numérique) afin d’en apprendre davantage sur le modèle de gestion de la main-d’œuvre tout à fait dystopique d’entreprises comme Amazon et Dollarama.
[45]. Cf. Kergoat, « Individu, groupe, collectif : quelques éléments de réflexion », dans Se battre, disent-elles…, p. 241 et suiv.
[46]. Voir la récente lettre ouverte des Manufacturiers et Exportateurs du Québec : « Le ministre fédéral du Travail a usé de son pouvoir discrétionnaire et est intervenu une fois à titre exceptionnel, en recourant à l’article 107 du Code canadien du travail pour empêcher l’arrêt de travail sur les chemins de fer. Cette intervention était nécessaire, mais il faut trouver une meilleure solution, prévisible, fiable et à long terme, pour prévenir d’éventuelles ruptures des chaînes d’approvisionnement. La contribution des secteurs maritime, ferroviaire et aérien doit être reconnue et ils doivent être traités comme des services essentiels. » (MEQ, « Des chaînes d’approvisionnement vulnérables affaiblissent le Canada », 11 octobre 2024). [Ces lignes ont été écrites en novembre-décembre 2024. Le printemps suivant, le ministre provincial du Travail, Jean Boulet, déposait le projet de loi 89 qui venait précisément répondre aux revendications du patronat québécois, en donnant le droit au gouvernement d’imposer une convention collective, s’il « considère qu’une menace réelle ou appréhendée est susceptible de causer un préjudice grave ou irréparable à la population. » (Cf. Isabelle Porter, « Québec dépose un projet de loi pour limiter l’impact des grèves et des lockouts », Le Devoir, 19 février 2025).]
[47]. Statistique Canada, Arrêts de travail selon le secteur et l’année, 2025. Durant la décennie 2015-2024, la moyenne annuelle de jours-personnes non travaillés était de 928 738, contre 610 000 pour les années 2000. Notons que deux fronts communs du secteur public ont eu lieu durant cette période (2015 et 2023), ce qui a eu un effet important sur la moyenne. En effet, entre 2016 et 2022, lorsque 61 % des jours-personnes non travaillés relevaient du secteur privé, la moyenne annuelle était d’à peine la moitié (428 315 jours-personnes non travaillés).
[48]. Nos conclusions rejoignent notamment celles développées dans le 27e numéro de TC.
[49]. Pour une étude du lien entre le recours à l’émeute et les périodes historiques du mode de production capitaliste ainsi que sur le retour de l’émeute comme forme de lutte sur le prix des marchandises, cf. Joshua Clover, L’Émeute prime, trad. Julien Guazzini, Genève, Entremonde, coll. « Senonevero », 2018.
[50]. Au moins en ce qui a trait au déclenchement de mouvements révolutionnaires, on peut dire que cette affirmation vaut pour la quasi-totalité des expériences révolutionnaires. Il en est allé autrement de leur achèvement.
Temps Libre III disponible en librairie au Québec
Temps Libre III – Portrait d’une société de classes : le Québec, peut désormais être trouvé dans plusieurs librairies québécoises. D’autres points de distribution risquent de s’ajouter dans les semaines à venir, restez à l’affût.
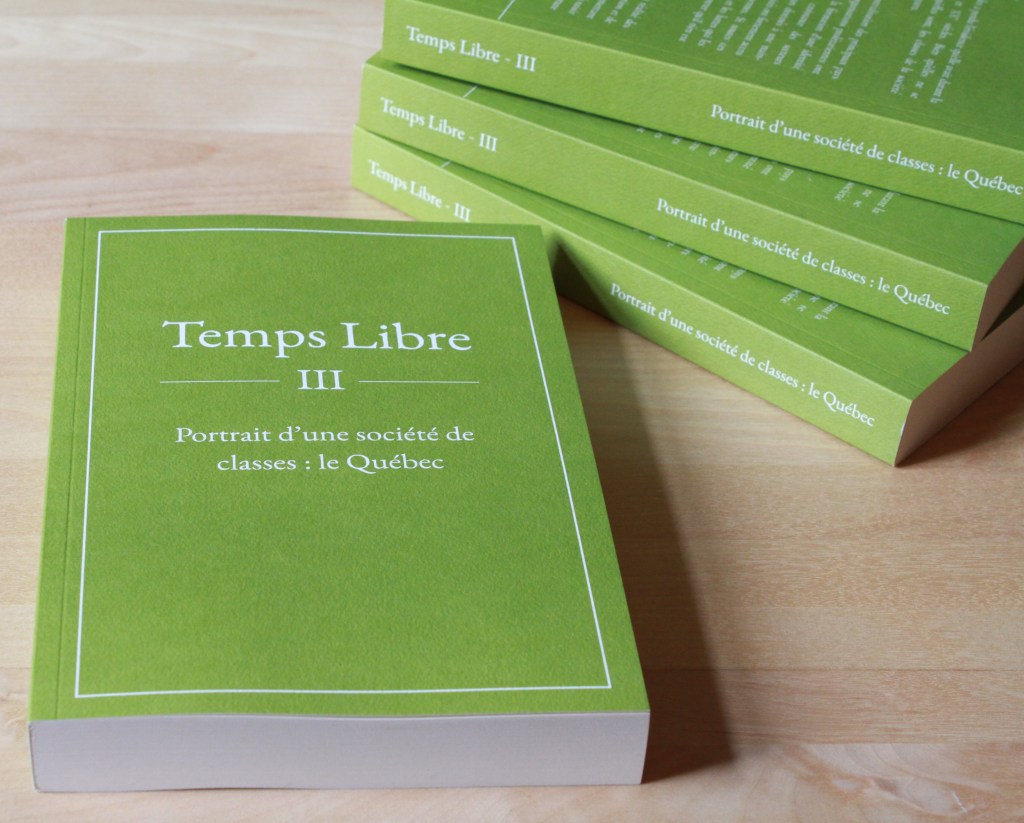
Montréal :
- Librairie Le Port de tête (Le Plateau Mont-Royal)
- Librairie un livre à soi (Le Plateau Mont-Royal)
- Librairie Zone Libre (Quartier Latin)
- L’insoumise (Quartier Latin)
- Librairie Médiaspaul – Masson (Vieux-Rosemont)
- Bâtiment 7 / Archives Révolutionnaires (Pointe Saint-Charles)
Québec
- Librairie Pantoute (Vieux-Québec)
Rimouski :
L’Isle-Verte
Le troisième numéro de la revue paraîtra en septembre prochain

Table des matières
Introduction 11
La restructuration néolibérale au Québec 27
Les classes sociales au Québec aujourd’hui 61
Rapports coloniaux et rapports de classes : le problème de leur articulation 225
L’évolution des conflits de classes 269
Dix thèses sur la théorie des classes 299
Annexe statistique 315
***
Restez à l’affût des informations concernant les événements de lancement et la parution du troisième numéro de Temps Libre, qui auront lieu à partir de septembre 2025.
Si vous souhaitez précommander plusieurs exemplaires, ou pour les expéditions outre-mer, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse courriel suivante : pouruntempslibre@hotmail.com
350 pages, 20$
Podcast – « Révolution et classes sociales » avec Sortir du capitalisme
Un entretien avec l’animateur du podcast Sortir du capitalisme, paru en décembre 2023, où l’un des membres de Temps Libre présente quelques-unes des thèses fortes du deuxième numéro de la revue.
On peut écouter l’émission à l’adresse suivante : Sortir du capitalisme – Révolution et classes sociales
Astarian, Ferro et critiques improductives : Sur quelques objections lancées à Temps Libre n. 2 (Deuxième partie)

2. Sur la classe moyenne
Classe moyenne salariée et classe moyenne
Astarian et Ferro sont insatisfaits de notre définition « négative » de la classe moyenne, ils aimeraient que nous fassions comme eux, c’est-à-dire que nous ne parlions ni de la production indépendante, ni du petit commerce, ni des professions libérales, ni de la police, ni de l’armée, ni du reste de la fonction publique qui n’est pas sursalariée pour qu’on puisse, tous et toutes ensemble, s’entendre sur un critère simple et facile, « positif », pour définir la « troisième classe » de leur ménage à trois, à savoir le fait de recevoir un sursalaire. Prolétaires, capitalistes et sursalarié·e·s – voilà les seuls agents qui, à les lire, peuplent ce bas monde.
Nos critiques jugent naturellement que la tentative de rendre compte de tous les agents du mode de production capitalisteen termes de classe est une « sophistication » difficilement compréhensible. On imagine que pour eux, ce n’est pas très élégant de vouloir classer tous ces agents en trois classes exhaustives, puisque cela implique que l’on devra cesser de considérer la classe moyenne de manière univoque (dans l’hypothèse où le prolétariat et la classe capitaliste reçoivent chacun·e une définition positive stricte). Astarian et Ferro n’apprécient pas davantage que nous disions que la classe moyenne « est une classe qui a son essence à l’extérieur d’elle-même », parce que cela leur rappelle que ce qui la définit d’abord, ce ne peut pas être quelque chose qui lui est propre ou un trait qui serait en elle, mais bien plutôt son extériorité au rapport de production fondamental du mode de production capitaliste. Mais la question qu’il faut se poser est la suivante : si l’on accepte de définir les classes par leur rôle relatif au rapport de production dominant d’un mode de production, peut-on commencer autrement qu’en offrant une définition négative de la classe moyenne? Définitivement pas, puisque le concept de classe moyenne est d’abord et avant tout le concept de la classe exclue du rapport de production dominant, c’est-à-dire de cette classe qui n’est ni le sujet, ni le bénéficiaire direct du travail productif – travail sur lequel s’appuie toute la structure sociale. Loin d’être un « manque de rigueur », cette manière de faire constitue le seul procédé réellement exhaustif, à même de ne laisser aucun agent d’un mode de production sans détermination de classe sous prétexte qu’il appartient à une fraction en déclin démographique[1]. Bien sûr, il reste toujours à spécifier ce qui fait de la classe moyenne actuelle une classe du mode de production capitaliste, par opposition aux classes moyennes appartenant à d’autres modes de production. Là-dessus, nous enjoignons les lectrices et lecteurs à se référer à la quatrième section du dernier numéro[2], où nous nous efforçons de déterminer précisément la nature des fonctions qui sont celles de la classe moyenne capitaliste et qui la caractérisent comme telle. Pour faire bref, il s’agit des fonctions : 1) de répression externe au procès de travail, 2) de contrôle et surveillance interne au procès de travail, 3) de production et de reproduction idéologique de la société capitaliste, 4) de diminution du temps de rotation du capital et enfin, 5) de reproduction directe de la force de travail.Résumons. Pour nous, la classe moyenne, parce qu’elle est en premier lieu définie par son exclusion du rapport de production sur lequel repose toute la structure sociale, excède nécessairement la seule couche des sursalarié·e·s, ce qui veut dire qu’elle inclut aussi : militaires, forces de police, salarié·e·s de la fonction publique (lorsqu’il ne s’agit pas d’une branche de la production capitaliste simplement nationalisée, par exemple : Hydro Québec), production marchande indépendante et professions libérales (dans la mesure où celles-ci sont pratiquées à titre indépendant). Pour Astarian et Ferro, toutes ces personnes n’existent pas. C’est pourquoi ils « réussissent » à définir positivement la troisième classe du mode de production capitaliste… comme la classe du sursalaire.
En outre, ceux-ci ne voient dans notre façon de définir la classe moyenne rien de moins qu’une « opération de sauvetage de la CMS » qui, selon eux, repose sur une sorte de libéralisme à la mode servant à réhabiliter politiquement ses membres. Rien n’est pourtant plus éloigné de notre démarche que des considérations de cet ordre. Présentez votre définition des classes qui composent le mode de production capitaliste et voyons si, à partir de la place qu’elles occupent au sein de la totalité sociale, ses membres possèdent la capacité réelle d’abolir le capital. Pour ce qui est de leur théorie des classes, il est évident que, une fois la classe moyenne définie par son sursalaire – c’est-à-dire par son intérêt objectif au maintien de l’exploitation du prolétariat –, celle-ci ne peut jouer qu’un rôle réactionnaire au sein d’un processus révolutionnaire. Mais comme cette définition de la classe moyenne est elle-même intenable, cette conclusion l’est aussi, ne serait-ce que parce qu’il n’existe rien de tel, pour la classe moyenne, que « des intérêts de classe » : il n’y a pour elle que des intérêts de fractions. C’est pourquoi la thèse du « sauvetage de la CMS » que nous imputent Astarian et Ferro est tout bonnement inopportune. Nous n’avons octroyé aucune nature « révolutionnaire » ou « réactionnaire » à la classe moyenne. La manière même de concevoir la classe moyenne comme un groupe unifié est pour nous un simple contresens. Il s’agit au contraire de prendre acte du fractionnement de la classe moyenne afin d’en rendre compte sur le plan des rôles qui seront joués au sein d’un processus révolutionnaire. Mais cela ne nous a jamais mené à affirmer que des fractions de la classe moyenne peuvent être révolutionnaires de la même manière que l’est le prolétariat, mais bien à montrer que certaines d’entres elles n’auront aucune raison de lutter contre le prolétariat insurgé et par conséquent, qu’elles ont le potentiel d’offrir un support stratégique significatif.
Enfin et pour s’amuser un peu avant d’enchaîner sur un autre sujet, notons qu’ils affirment dans leur réponse qu’il est « inexact de [leur] attribuer l’idée selon laquelle “la classe moyenne est toujours, au moins en puissance, fossoyeuse de la révolution communiste’’[3]». Contentons-nous ici de présenter ce qu’ils disent sur le sujet dans Le ménage à trois de la lutte des classes :
il nous suffit de déduire de la place de la CMS dans le rapport d’exploitation qu’une rupture de celui-ci lui est forcément dommageable, puisque la production de plus-value est à l’arrêt dans toutes les zones où le prolétariat est insurgé. Dans toutes ces zones, aucune alliance n’est possible entre la CMS et le prolétariat révolutionnaire. Dans l’affrontement du prolétariat insurgé contre le capital, la CMS prendra le parti du capital en participant (activement ou passivement) à la répression.[4]
Lisons aussi :
Dans une phase de crise profonde et d’éclatement de la présupposition réciproque des classes, aucune alliance n’est donc envisageable entre la CMS et le prolétariat révolutionnaire.[5]
ou encore :
seul le stade insurrectionnel de la lutte des classes crée la possibilité du passage au communisme. Il s’agit d’une situation sociale qui est une exception historique, où d’une part la présupposition réciproque des classes est suspendue entre prolétariat et capital, et où d’autre part le prolétariat et la CMS (même inférieure) sont séparés et antagoniques.[6] (Tous les italiques sont de nous)
Cela se passe évidemment de commentaires. Si nos auteurs avaient voulu défendre une opinion contraire ou simplement plus nuancée sur le caractère contre-révolutionnaire de la classe moyenne salariée dans l’insurrection, il aurait sans doute été plus sage de ne pas multiplier ce genre d’assertions.
Encadrement et travail de subordination
Un aspect important de notre critique de la théorie de la classe moyenne salariée d’Astarian et de Ferro concerne la notion d’encadrement. Dans le Ménage à trois, c’est l’encadrement et lui seul qui justifie le sursalaire de la classe moyenne salariée. Or, puisque l’encadrement est chez eux synonyme de travail de direction et de surveillance, ils ne sont pas parvenus à rendre compte de la manière spécifique dont se réalisent, au sein de la production, une grande partie des rapports de domination, à savoir : grâce au monopole du savoir dont bénéficient les travailleurs et travailleuses intellectuel·le·s. En effet, selon eux, l’ingénieur·e reçoit un sursalaire parce qu’il ou elle « encadre », c’est-à-dire agit en despote sur les lieux de production. Mais comme nous l’avons montré, l’autorité qu’ont le technicien et l’ingénieur sur le manœuvre ne provient pas des punitions qu’ils peuvent lui infliger ou des réprimandes qu’ils peuvent lui faire. Bien plutôt, leur autorité est directement fonction du monopole des savoirs dont ils disposent – monopole octroyé par la classe capitaliste pour qu’elle n’ait pas à s’occuper elle-même de ce travail compliqué, bien que nécessaire à la marche quotidienne de la production et à l’augmentation constante de la productivité du travail. Si l’on se fie à la réponse qu’Astarian et Ferro nous ont adressée, il semblerait qu’ils acceptent cette critique de bonne foi. On croit comprendre qu’ils reconnaissent que les rapports de domination politique ne sont pas les seuls à être effectifs et donc, qu’il faille prendre en compte le rôle que jouent les rapports de domination idéologique au sein du travail de subordination : « On doit reconnaître à TL le mérite d’avoir approfondi l’analyse des différentes activités qu’exerce la classe moyenne salariés pour justifier son sursalaire. La notion qu’ils proposent de travail de subordination est une façon d’élargir la notion d’encadrement.[7] » Si nous lisons bien, cela signifie que nous aurions, en remplaçant la notion d’encadrement par celle de travail de subordination, montré que non seulement le sursalaire se justifie par des travaux de direction et de surveillance, mais aussi par l’exécution d’un travail intellectuel. Cela, dans la mesure où ce dernier reconduit des rapports de domination idéologique au sein du procès de travail. Par conséquent, nous aurions élargi la gamme de raisons justifiant un sursalaire. Pourtant, Astarian et Ferro font suivre ces deux phrases de cette critique éloquente : « Mais il faudrait de plus préciser en quoi le travail de subordination justifie le sursalaire[8] ». Ainsi, après nous avoir félicités d’identifier de manière plus précise ce qui justifie un sursalaire, ils nous reprochent d’avoir oublié d’identifier ce qui justifie un sursalaire. Il ne faudrait surtout pas reconnaître quelque chose à Temps Libre.
La crise et le patrimoine de la classe moyenne
En revenant sur le rôle de la classe moyenne salariée dans la crise, Astarian et Ferro réitèrent l’idée selon laquelle ce qui la distingue fondamentalement du prolétariat, c’est la possession de réserves. Quand « le capital cesse massivement d’acheter la force de travail », la classe moyenne salariée n’est pas contrainte de « prendre possession d’éléments du capital[9] » puisqu’elle peut se reproduire en épuisant progressivement ses réserves; au contraire des sans-réserves, elle n’est pas un « pur sujet », elle n’est pas « entièrement séparée des conditions objectives de son existence[10] ». Ils ont raison d’indiquer que la classe moyenne salariée possède en moyenne un patrimoine supérieur à celui du prolétariat et que la défense de celui-ci est un élément à considérer dans l’analyse de son rôle dans la lutte des classes. Toutefois, pointer la présence d’un patrimoine net n’est pas suffisant pour conclure, comme ils le font, que l’endettement de la classe moyenne ne pose pas problème pour sa reproductibilité en situation de crise[11]. On ne peut pas mettre de côté la question de l’endettement uniquement en insinuant que la classe moyenne pourrait, en situation de crise, rembourser ses dettes et continuer à se reproduire sous prétexte que ses actifs dépassent généralement ses passifs. Effectivement, lorsqu’on s’intéresse à la composition du patrimoine des ménages français des déciles 4 à 9, on remarque que le patrimoine immobilier occupe une part plus importante que pour les déciles inférieurs et supérieur en s’élevant au-delà de 70 % du patrimoine brut[12].
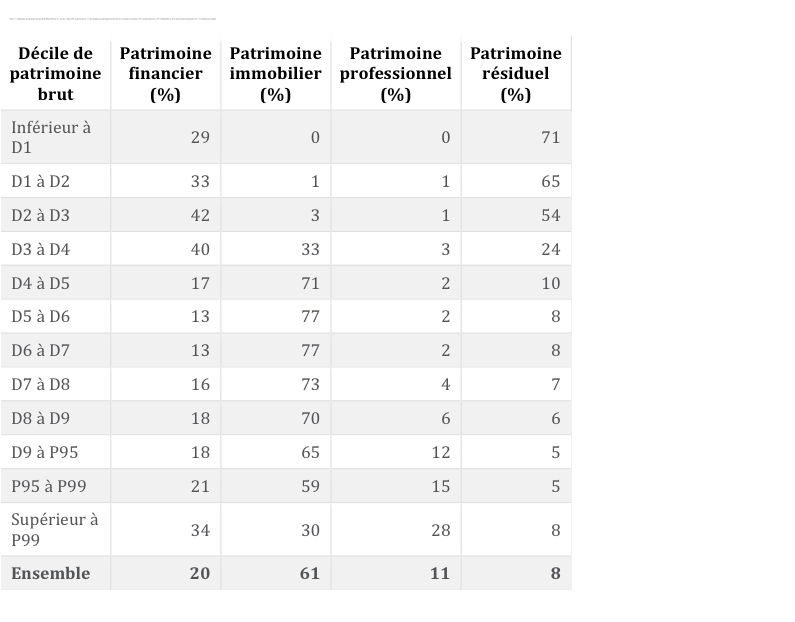
L’importance de l’immobilier dans le patrimoine de la classe moyenne (selon la définition d’Astarian et Ferro) doit nuancer l’idée voulant que celle-ci puisse passer la crise en vivant de ses réserves justement parce que dans cette situation, son patrimoine ne sera pas immédiatement convertible en liquidités. Non seulement la classe moyenne voudra conserver un toit au-dessus de sa tête même en situation de crise, mais au moment où le capital cesse d’acheter la force de travail parce qu’il y a « un point de blocage dans le rapport d’exploitation du travail par le capital »[13], le marché immobilier, noyé par l’offre, sera nécessairement en chute, voire complètement bloqué si l’on accepte l’hypothèse voulant que les membres de la classe moyenne liquideront leur patrimoine pour se reproduire. Nous ne contestons pas le fait que le sursalaire permette d’amasser un patrimoine et que celui-ci ait des effets pertinents sur la lutte des classes, nous refusons simplement la réduction du rôle révolutionnaire ou contre-révolutionnaire des différentes classes à la question de la possession de réserves.
Plus généralement, la méthode avec laquelle Astarian et Ferro traitent ce problème montre encore une fois l’ambiguïté qui traverse leur théorie des classes. Lorsqu’ils commentent des statistiques présentant le patrimoine net des ménages étatsuniens, on voit que la classe moyenne salariée – définie jusqu’ici par son sursalaire – devient maintenant la classe regroupant tous les agents possédant un minimum de réserves. Le prolétariat est assimilé au quintile de revenu le plus bas, ce qui correspond, lorsqu’on isole cet élément, à une partie de la population possédant un patrimoine presque inexistant[14]. Cela concorde avec la définition qu’ils offrent du prolétariat (les sans-réserves) et semble indiquer, d’une part, qu’il est impossible d’appartenir au prolétariat et de posséder un patrimoine et, d’autre part, que tous les agents de la classe moyenne possèdent un patrimoine leur permettant de résister aux crises profondes.
Ce qui cloche dans ce traitement des statistiques, c’est notamment l’absence de considération pour l’âge des personnes de référence des ménages. En s’intéressant au patrimoine net des ménages étatsuniens, mais cette fois-ci en faisant intervenir l’âge, on remarque que le patrimoine net médian des ménages dont la personne de référence a moins de 35 ans est de seulement 13 900$ pour grimper progressivement à 266 400$ pour ceux dont la personne de référence a de 65-74 ans[15]. On pourrait nous rétorquer que le patrimoine médian augmente effectivement suivant l’âge des personnes de référence, mais que cette augmentation ne concerne pas le prolétariat qui, en tant que sans-réserves, ne peut jamais posséder un patrimoine minimalement substantiel. Or lorsqu’on croise ces deux facteurs – à savoir le niveau de revenu et l’âge – on remarque qu’au Canada, non seulement le quintile de revenu inférieur des personnes âgées de 55-64 ans possède en moyenne des réserves sous forme de patrimoine, mais également que ce patrimoine dépasse largement celui du quatrième quintile de revenu des personnes de référence ayant 35 ans et moins. Dit autrement, les 20 % des personnes âgées de 55-64 ayant le plus bas revenu de leur catégorie d’âge ont un patrimoine moyen qui excède celui du quatrième quintile de revenu des personnes de 35 ans et moins[16].
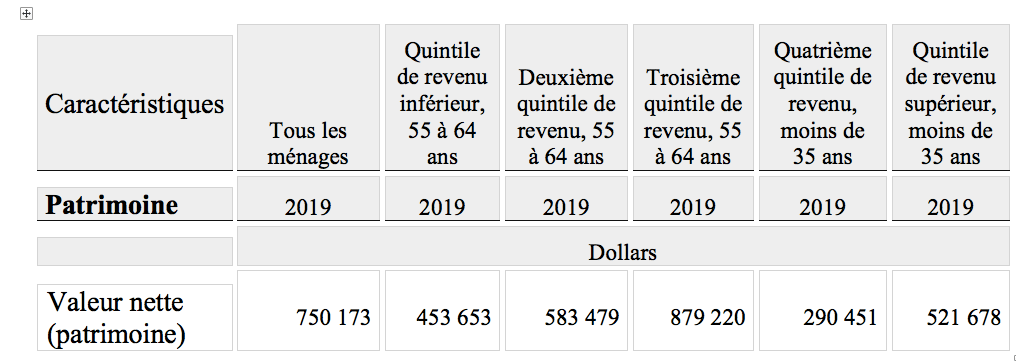
Est-ce qu’on doit en conclure qu’au Canada, il n’y a pas de prolétaires de plus de 55 ans et que les personnes de 35 ans et moins ayant un haut salaire, mais un faible patrimoine sont des prolétaires parce que leur absence de réserves les forcera à s’approprier des éléments du capital dans un scénario de crise profonde? Évidemment, ce n’est pas le cas. Le médecin et la cadre supérieure qui viennent tout juste d’intégrer le marché du travail n’ont pas encore de patrimoine et possèdent généralement, en Amérique du Nord, des dettes étudiantes considérables. Néanmoins, l’autorité que leur confère leur place actuelle au sein du mode de production et l’assurance de voir leurs conditions matérielles s’améliorer sans cesse sont des éléments qui nous conduisent à affirmer qu’en cas de crise profonde, ces agents seront généralement portés à lutter pour la reprise de l’exploitation capitaliste plutôt que pour la réalisation de mesures communistes, et ce, malgré leur absence de réserves.
Répétons-le, la défense du patrimoine est un élément dont il faut tenir compte pour analyser la dynamique des luttes interclassistes au sein des crises profondes, mais il serait faux de penser la classe révolutionnaire uniquement comme celle qui épuise ses réserves en premier, précisément parce qu’il n’y a pas d’identité stricte entre le fait d’être sans-réserves et d’appartenir au prolétariat. Le traitement des statistiques offert par Astarian et Ferro pose en ce sens un autre problème pour leur définition du prolétariat qui, comme nous l’avons vu dans la première partie, n’avait déjà pas besoin d’une difficulté supplémentaire pour justifier son abandon. Leur analyse indique que le prolétariat correspond ou bien au quintile de revenu inférieur, ou bien aux deux quintiles de revenu les plus bas[17]. Dit autrement, ils assimilent le prolétariat aux personnes ayant les plus bas revenus en laissant au lectorat le choix de décider s’il s’agit des 20 % ou des 40 % les plus pauvres. Si on fait fi de ce manque de précision flagrant, le raisonnement semble tenir : comme le prolétariat est payé au prix de la reproduction de sa force de travail, il correspond aux personnes ayant les plus bas salaires et, corollairement, il ne peut accumuler aucun patrimoine. Toutefois, « salaire » et « revenu » ne sont pas des termes équivalents et si on prend le quintile de revenu inférieur, il faut admettre qu’une part importante de celui-ci est composé, d’un côté, de personnes vivant des divers programmes de l’aide sociale et, de l’autre, des personnes travaillant de manière intermittente ou à temps partiel.
Comme Astarian et Ferro ne s’embarrassent jamais des rapports de production pour définir le prolétariat, nul besoin d’interroger le rapport de ces agents à la production de plus-value, mais la question suivante se pose tout de même pour leur propre théorie : est-il possible qu’un agent du mode de production capitaliste soit employé par du capital, qu’il produise de la plus-value, qu’il n’effectue aucune fonction de subordination et qu’il possède néanmoins des réserves? Si oui, appartient-il au prolétariat malgré ses réserves ou en est-il exclu en vertu de celles-ci? Au Québec par exemple, on peut voir que plusieurs ouvriers et ouvrières professionnel·le·s (plâtrier·e·s, briqueteur·euse·s, machinistes, mécanicien·ne·s, etc.) reçoivent des salaires qui correspondent, voire qui dépassent le salaire médian des particuliers[18] et qui permettent une certaine accumulation de réserves – que celles-ci prennent la forme d’un fonds de pension ou d’une modeste propriété immobilière. Dans des conditions historiques données, le prix de la reproduction de la force de travail peut permettre l’accumulation de certaines réserves sans que cela interdise la possibilité de l’exploitation capitaliste, puisque pour être exploité, il n’est pas nécessaire d’être absolument démuni de toute possession matérielle, mais seulement d’être payé en deçà de la valeur produite[19]. Selon Astarian et Ferro, il semble que les agents effectuant les métiers énumérés ci-dessus ne font pas partie du prolétariat puisque toute leur théorie de la classe révolutionnaire repose sur le fait que celle-ci, contrairement aux autres classes du mode production capitaliste, est absolument dépourvue de réserves. Au final, on voit encore une fois que la théorie des classes d’Astarian et Ferro conduit à des aberrations dès qu’on tente de la faire correspondre aux rapports de production spécifiquement capitalistes. Pour eux, appartenir au prolétariat n’a plus rien à voir avec le fait d’être exploité et de produire de la plus-value, ni même avec celui de travailler ou d’être salarié. Être pauvre, voilà le seul et unique critère qu’utilisent Astarian et Ferro pour classer un agent dans le prolétariat.
Exploitation et classe moyenne
La manière dont Astarian et Ferro traitent de la question de l’exploitation illustre bien la légèreté avec laquelle ils répondent à des critiques sérieuses. D’un côté, ils nous accusent de laisser en suspens des questions auxquelles nous avons bel et bien répondues. De l’autre, ils nous renvoient, en guise d’argument, à la « théorie de l’exploitation » d’Astarian qui n’est rien d’autre qu’une série d’affirmations gratuites.
Que nous reprochent-ils au juste? Ils affirment que nous n’expliquons pas comment l’exploitation du travail improductif est possible tout en contestant, du même coup, cette possibilité. En effet, pour eux, seul peut être exploité un travail productif. Cependant, Astarian ne se gêne pas de parler de « l’exploitation du prolétariat[20] » alors que le prolétariat se compose, précisément selon lui, pour une bonne part de prolétaires improductif·ve·s. Si c’est tout le prolétariat qui est effectivement exploité, cela ne signifie-t-il donc pas qu’il est possible d’exploiter un travail improductif[21]? Astarian l’affirme qu’il le veuille ou non. Nous avons aussi droit à des perles du genre :
- « L’exploitation du travail, quant à elle, n’a pas besoin d’être expliquée ici. Considérons-la comme la variable explicative fondamentale, celle qui sert d’axiome. Il n’y a pas de travail non exploité.[22] »;
- « L’exploitation du travail, enfin, ne requiert pas d’explication, elle est la forme normale et nécessaire du travail.[23] »;
- « Toute l’histoire du travail a une telle dynamique, parce que le travail est exploité et que l’exploitation du travail est une contradiction.[24] » (Nous soulignons)
On se souvient qu’ils nous reprochent d’affirmer que le travail improductif peut lui aussi être exploité… Mais revenons à la question qui nous intéresse. Pourquoi seul le travail productif peut-il être exploité? Pour répondre, acceptons l’invitation d’Astarian et Ferro et plongeons dans le texte qu’ils appellent à l’appui de leur propre position. Nous y lisons :
De façon générale, l’exploitation du travail consiste en l’extraction d’un surproduit par la classe de la propriété. Dans le cas du mode de production capitaliste, elle consiste en l’extraction de plus-value. Celle-ci vient forcément du travail productif, qui est donc (!) le seul à être exploité au sens propre.[25]
Voilà le couronnement de toute une riche tradition de recherche marxiste autour du problème de l’exploitation. Les curieux et curieuses sont invité·e·s à constater de leurs propres yeux que c’est là l’unique passage où Astarian aborde la question de l’exploitation pour elle-même. Tout tient en cette magnifique phrase : « De façon générale (il arrive que ça ne soit pas le cas?), l’exploitation du travail consiste en l’extraction d’un surproduit par la classe de la propriété. » Tout d’abord, pour nier comme ils le font la possibilité de toute forme d’exploitation du travail improductif, il faudrait d’abord dire « dans tous les cas » ou « par définition ». Autrement, on dit seulement que c’est généralement le travail productif qui est exploité – ce qui, par voie de conséquence, signifie qu’il peut arriver que d’autres types de travail soient exploités. Ensuite, pourquoi seule « la classe de la propriété » dispose-t-elle du pouvoir d’exploiter un travail? On ne sait pas, c’est comme ça et c’est tout[26]. Ainsi, pour toute démonstration du fait que seul peut être exploité un travail productif, Astarian et Ferro nous renvoient à cette affirmation gratuite et mal construite qui plus est. « Un peu de rigueur est ici de mise », MM. Astarian et Ferro.
Voilà pour leur « argument ». Maintenant, est-il vrai que nous ayons omis d’expliquer comment un travail improductif peut être exploité? Voici comment s’ouvre la p. 80 de notre dernier numéro, où nous reprenons à notre compte l’explication de Marx :
S’illes ne sont pas exploité·e·s au sens spécifiquement capitaliste – à savoir par extorsion de plus-value – il est possible d’expliquer comment leur travail permet au capital commercial de toucher une part de la plus-value : « (…) La masse de son profit dépend, pour le commerçant individuel, de la masse de capital qu’il lui est possible d’utiliser dans ce procès; il pourra en employer d’autant plus dans l’achat et la vente que le travail non payé de ses commis sera important. Le capitaliste commercial fait accomplir en grande partie par ses employés la fonction même grâce à laquelle son argent est du capital. Bien que le travail non payé de ses commis ne crée pas de plus-value, il lui procure cependant l’appropriation de plus-value, ce qui, pour ce capital, aboutit au même résultat; ce travail non payé est source de profit. Sinon, l’entreprise commerciale ne pourrait jamais être pratiquée à grande échelle, ni de façon capitaliste (…) » En ce sens, ces employé·e·s improductif·ve·s effectuent également un travail non payé.[27]
Nous estimons que ce passage constitue une explication claire du fait qu’un travail improductif peut très bien être exploité. Si Astarian et Ferro avaient lu plus attentivement celui-ci, il est certain qu’ils auraient pu comprendre cette explication par eux-mêmes. Et ce n’est pas très compliqué : si le travail improductif peut être exploité, c’est parce qu’il peut se diviser lui aussi en travail payé et travail non payé, c’est-à-dire en travail nécessaire et surtravail. Mais approfondissons un peu plus. Comment un agent qui, du fait de son travail non valorisant, ne reproduit pas la valeur des frais de reproduction de sa force de travail peut-il voir sa journée de travail se décomposer en travail nécessaire et en surtravail[28]? La réponse à cette question a déjà été donnée par Marx dans le chapitre XVII « Le profit commercial » du troisième livre du Capital. Dans ce chapitre, Marx montre que le profit commercial est directement proportionnel à la masse du capital-marchandise qu’il permet de réaliser : plus cette masse est grande, plus sa vente lui rapporte gros. On se souvient de même que le capital productif vend son capital-marchandise au capital commercial en dessous de sa valeur pour que ce dernier l’écoule et pour qu’il diminue ainsi le temps de rotation global de son capital. La différence entre ce que lui a rapporté la vente d’une masse de marchandises et ce qu’elle lui a d’abord coûté, le capital commercial l’empoche. Et cette différence ne représente ni plus ni moins que la rémunération des services qu’il rend au capital productif. Souhaitant s’enrichir davantage, celui-ci doit donc accroître la masse de marchandises qu’il achète et vend. Or, plus la masse de marchandises achetée est grande, plus la revendre prend du temps, c’est pourquoi le capitaliste commercial est, dans un cas pareil, amené à employer des salarié·e·s. Si celui-ci multiplie par 10 la masse de marchandises qu’il écoule et qu’il engage, pour l’épauler, 9 autres personnes, rien ne l’oblige à rémunérer ces dernières proportionnellement au service qu’elles lui rendent à lui. Au contraire, si ce qu’il souhaite faire, c’est s’enrichir, il a tout intérêt à abaisser leur salaire au strict minimum, c’est-à-dire à le fixer de la même manière que celui des travailleur·euse·s du secteur productif, à savoir au prix de la reproduction de leur force de travail. Par conséquent, là où ces individus auraient été en droit de recevoir le 1/10 de la rémunération du service qu’ils ont contribué à rendre au capital productif – parce que le capital social doit, dans tous les cas, réserver une part de la plus-value globale à la rémunération des agents dédiés à la circulation – ils reçoivent un salaire qui ne correspond qu’au prix de la reproduction de leur force de travail. Comme l’indique Marx,
l’exercice [de la force de travail d’un travailleur commercial] comme effort, dépense d’énergie et usure, tout comme pour n’importe quel autre salarié, n’est nullement limité par la valeur de sa force de travail. Son salaire n’est donc pas nécessairement en rapport avec la masse de profit qu’il aide le capitaliste à réaliser. Ce qu’il coûte et ce qu’il rapporte au capitaliste sont des grandeurs différentes. Il lui rapporte non pas parce qu’il crée directement de la plus-value, mais parce qu’il contribue à diminuer les frais de réalisation de la plus-value, en accomplissant du travail en partie non payé.[29]
On ne saurait être plus explicite. Corollairement, on peine à voir comment Astarian et Ferro pourraient continuer de restreindre le concept d’exploitation au travail productif. Surtout que, comme nous l’avons vu, ils ne se sont jamais embarrassés d’une telle restriction lorsqu’il est question de « l’exploitation du prolétariat » ou de « l’exploitation du travail ».
Néanmoins, pour eux, cette restriction n’a aucun effet sur la définition du prolétariat, puisqu’ils ne considèrent pas l’exploitation comme une condition nécessaire pour appartenir à cette classe. Ce n’est que dans leur réponse à notre critique qu’on peut entrevoir comment une telle restriction leur est utile. Et on a beau essayer, on ne peut s’empêcher de voir dans cette restriction autre chose qu’un relent de chauvinisme mâle pour lequel il n’y a pas d’exploitation spécifiquement féminine. Pour Astarian et Ferro, si une femme peut être exploitée dans la société capitaliste, ça ne peut être qu’en tant que prolétaire (et il faut ajouter : employée par le secteur productif). On sait quelles ont été les conséquences politiques d’une telle conception du « problème des femmes ». Bien qu’il nous apparaisse ridicule de devoir expliquer ce qui a été expliqué mille fois avant nous, nous sommes contraint·e·s d’aller de l’avant et de montrer comment le travail domestique peut êtreexploité. Ainsi, à son niveau le plus abstrait, l’exploitation consiste en un rapport au sein duquel s’échangent, de manière continue et répétée, des prestations de travail non équivalentes (en temps, mais aussi en qualité)[30]. Comme la valeur est du temps de travail matérialisé, l’échange de service contre rémunération revient à échanger du temps de travail contre du temps de travail. Ce qui signifie que lorsque le ou la capitaliste paie ses prolétaires non pas à la hauteur de la valeur effectivement ajoutée à son capital initial, mais uniquement à la hauteur des frais nécessaires à la reproduction de leur force de travail, il s’agit ici aussi d’un échange de prestations de travail non équivalentes; du temps de travail a été échangé contre moins de temps de travail. Or la même chose peut se dérouler à la maison. Delphy a déjà très clairement expliqué comment l’économie domestique peut représenter une forme d’exploitation du travail des femmes par les hommes du ménage[31]. De même, et contre l’idée selon laquelle, dans le couple, le temps de travail total des femmes équivaut à celui des hommes (parce que le travail non rémunéré des femmes serait entièrement compensé par celui, rémunéré, des hommes), on peut observer que le temps « contraint » total des femmes est en moyenne beaucoup plus important que celui des hommes : 66 heures/semaines pour les femmes actives contre 57 pour les hommes actifs et 43 heures/semaines pour les inactives contre 18 pour les inactifs[32]. Les recherches des anthropologues (féministes ou non) parviennent à des résultats remarquablement similaires en étudiant les sociétés dites « primitives »[33]. Il n’est donc pas question de soutenir que les femmes qui effectuent davantage de travail domestique sont nécessairement exploitées par leur conjoint, mais bel et bien que cette éventualité existe et qu’elle correspond, par ailleurs, à la réalité d’innombrables ménages.
Groupe « femme » et appartenance de classe
Dans leur critique, Astarian et Ferro ne s’embarrassent pas toujours de ce que nous disons réellement, ce qui leur facilite naturellement la tâche. C’est effectivement un procédé commode que de déformer une thèse pour la réduire ensuite facilement en pièces. Mais tout ce qu’a de risqué une telle « tactique » doit apparaître dès lors que ceux et celles dont les propos sont déformés ont l’opportunité de répondre. C’est ici particulièrement le cas en ce qui a trait à la question de l’appartenance de classe du groupe « femme ».
Ainsi, Temps Libre rangerait « toute la main-d’œuvre féminine considérée sous-payée dans la même classe sociale, d’une part, par la présomption qu’elle serait forcément improductive (donc ipso facto membre de la classe moyenne), d’autre part par la mobilisation d’une conceptualisation ad hoc (les »travaux participant à la reproduction directe de la force de travail » …)[34]» Quand « TL » féminise des notions telles que travailleuse productive et accorde au féminin des adjectifs qui accompagnent la notion de prolétaire, il ne faut pas y voir des pratiques imposées par l’empire du politiquement correct, mais bien plutôt la prise au sérieux du fait que les prolétaires ne sont pas seulement des hommes et corollairement, que le travail productif n’est pas uniquement effectué par des hommes. Ce fait, il est assez difficile d’en avoir conscience lorsqu’on lit par exemple un texte d’Astarian qui, semble-t-il, juge non théoriquement pertinent de rappeler grammaticalement que les hommes ne sont pas les seuls représentants de l’espèce humaine, ni les seuls membres du prolétariat. Si nos critiques avaient réfléchi au sens d’une telle pratique d’écriture, peut-être cela leur aurait-il évité une méprise inutile. Pour rappeler ce qui est déjà clair dans notre dernier numéro, bien que les femmes soient surreprésentées dans le travail improductif subordonné, toutes les femmes ne sont pas sous-payées et toutes les femmes sous-payées ne sont pas membres de la classe moyenne.
Pour Astarian et Ferro, il serait faux de dire que les femmes sous-payées (qui ne reçoivent pas du sursalaire) de la classe moyenne sont pour cela « exclues du sursalaire » ou dit autrement, il serait faux de dire qu’elles ne sont pas sursalariées[35]. En effet, notre point de vue serait biaisé parce que, pour déterminer l’appartenance d’un agent, nous prenons pour point de départ le « porteur individuel de la force de travail », alors que, selon eux, « la cellule de base de la reproduction des différentes forces de travail », c’est le ménage[36]. Par conséquent, il faudrait partir du revenu du ménage pour déterminer si ceux et celles qui en font partie sont, oui ou non, sursalarié·e·s. C’est curieux, mais jamais le revenu du conjoint ou de la conjointe, ni même du ménage, n’était auparavant intervenu chez eux pour déterminer l’appartenance de classe de qui que ce soit. Pour Astarian et Ferro, l’ouvrier qui est payé au prix de la reproduction de sa force de travail est exploité et appartient au prolétariat en tant que sans-réserves, et ce, que son épouse soit cadre ou non. Par contre, pour ce qui est de la caissière, de la préposée aux bénéficiaires, de la vendeuse de parfum, elles… il faut voir, parce que même si elles ne sont pas payées davantage, leur mari gagne « généralement » plus qu’elles, elles restent donc « objectivement associées » au sursalaire. Ce qui, pour eux, implique qu’elles ne sont pas exploitées et ne peuvent pas l’être. Or, à ce qu’on sache, jusqu’ici, « recevoir un sursalaire » signifiait « recevoir un salaire qui excède le prix de la reproduction de la force de travail ». Mais maintenant, « recevoir un sursalaire » signifie (lorsqu’il s’agit d’une femme) « faire partie d’un ménage au sein duquel un de ses membres reçoit un sursalaire ». En parlant d’explication ad hoc…
Prenons un pas de recul. Astarian et Ferro, de même que les auteurs de La petite-bourgeoisie en France, ont-ils raison d’accorder de l’importance au patrimoine global dont dispose un ménage, à sa mixité sociale? Bien sûr que oui. Et cela, parce que la prise en compte de ces facteurs nous permet d’aiguiser nos analyses et de comprendre pourquoi tel ou tel agent agit ou n’agit pas conformément à son appartenance de classe. Mais du moment qu’on s’intéresse aux pratiques des agents pour déterminer leur appartenance de classe (travail productif, travail de subordination, extraction de surtravail, etc.) plutôt que par leur degré de rémunération, voire par le patrimoine dont ils disposent[37], il devient absurde de nier le sens de telles pratiques, ce qu’elles impliquent pour la reproduction de la totalité capitaliste, sur la base… du revenu du ménage. Un flic a beau marier une prolétaire, il n’en est pas moins un flic et sa femme, une prolétaire. C’est que tout simplement, un·e exploité·e n’est pas moins exploité·e par son boss si l’un·e ou l’autre des conjoint·e perçoit un sursalaire. L’exploitation a lieu et ce qui arrive après ne regarde en rien le rapport qui lie les deux agents. Astarian et Ferro nous servent justement une théorie des classes digne des Guizot et Cie lorsqu’ils considèrent le ménage comme l’unité de base de la classe : les ménages pauvres (qui ne peuvent accumuler de patrimoine), les ménages intermédiaires et les ménages très riches qui ont de gros patrimoines.
Par ailleurs, nous soutenons que le fait de reproduire directement la force de travail constitue l’une des cinq grandes fonctions qu’effectue la classe moyenne et nous affirmons de plus que les femmes sont surreprésentées dans les travaux qui y sont associés. Contre cette idée, voilà ce qu’en disent Astarian et Ferro :
À notre avis, il y a plusieurs incohérences dans cette tentative de circonscrire un ensemble d’activités ou de branches (forcément improductives d’après TL) constituant la reproduction « directe » de la force de travail. TL inclut dans cet ensemble mal défini certaines activités et pas d’autres. Sur la base de quel critère? On ne sait pas.[38]
Tout d’abord, il est faux d’affirmer que pour nous, il existe des activités qui sont forcément, nécessairement improductives; nous nous bornons à constater le fait que certaines d’entre elles ont été historiquement exclues de la production de plus-value, et ce, parce que le capital n’a jamais jugé profitable de s’en emparer sur une large échelle[39]. Y a-t-il des écoles privées, des cliniques privées, des résidences pour personnes âgées privées, c’est-à-dire des entreprises offrant des services « de reproduction directe » dont l’objectif est de faire du profit? Bien évidemment. Mais au Québec, par exemple, l’essentiel des services d’éducation et de soins est fourni plus ou moins « gratuitement »[40] par l’État et – ce qui est autrement fondamental – selon une tout autre logique que celle présidant à l’entreprise capitaliste. C’est un fait d’une immense importance, parce qu’il place ceux et celles qui fournissent ces services dans un rapport totalement différent au capital et par là, à la totalité sociale. Ensuite, il est remarquablement malhonnête de soutenir que nous ne fournissons pas de critères à même de discriminer quelles activités doivent être comprises comme « reproduisant directement la force de travail ». Voici ce qui est dit, aux pages 194 et 195 :
Ce que nous entendons par « reproduction directe », ce sont tous les travaux absolument nécessaires pour que la force de travail puisse se rendre quotidiennement au travail et y être apte. Par là, nous excluons toute activité propre, exclusive à la reproduction de la classe capitaliste et des couches non subordonnées de la classe moyenne. (…) La reproduction directe de la force de travail désigne donc les activités consistant à former et à soigner la force de travail, ainsi que celles lui permettant d’aller travailler – notamment la charge des enfants, des personnes âgées et des personnes non autonomes.[41] (Nous soulignons)
Astarian et Ferro se demandent franchement si le transport public répond à ces critères. Nous les aiderons : consiste-t-il à former ou à soigner la force de travail? Non. Dans ce cas, décharge-t-il quiconque du fardeau de prendre en charge les enfants, les personnes âgées ou les personnes non autonomes? Non. Est-il alors, au minimum, par quelque côté que ce soit, comparable aux tâches tout juste mentionnées? Non plus. Conclusion : les chauffeur·euse·s d’autobus, de taxi, les pilotes d’avion, les conducteur·rice·s de trains, de bateaux, d’hélicoptères ne reproduisent donc pas directement la force de travail. Vaut-il même la peine de répondre à l’objection selon laquelle il n’y aurait aucune raison de ne pas ranger là les flics? Non seulement les flics sont très, très loin d’effectuer des tâches de la nature dont nous venons de parler, mais en plus, ils ont droit à une fonction bien à eux, à savoir celle dont « l’objectif est de museler, de contenir et d’écraser tout ce par quoi le refus du monde actuel se manifeste.[42] » Ne va-t-il pas de soi que les différences existant entre l’activité concrète des infirmières et celle de flics justifient, du point de vue d’une théorie des classes, qu’on les traite différemment?
Division sexuelle du travail et histoire du patriarcat
À partir de leur critique concernant notre analyse de la surreprésentation des femmes au sein des couches faiblement rémunérées de la classe moyenne, Astarian et Ferro s’aventurent sur le terrain de l’histoire. Ce faisant, ils aboutissent à des conclusions révolutionnaires du type « les théories contemporaines du genre ne sont que le produit de 300 000 ans d’humanisation du rapport à la nature » ou encore « les luttes féministes n’ont aucun réel potentiel subversif ». Tenez-vous bien, le chemin est tumultueux. La première thèse à laquelle nos auteurs s’attaquent est la suivante : dans l’intégration des femmes au travail salarié, il y a continuité et renforcement de la division sexuelle du travail qui relègue les femmes au travail reproductif. Dit autrement, l’intégration des femmes dans le travail salarié se fait sur la base d’une division sexuelle au sein du travail salarié et, plus encore, ce travail s’ajoute aux tâches domestiques qui leur sont encore majoritairement déléguées (d’où la pertinence du concept de double journée de travail). Astarian et Ferro affirment ne pas vouloir « nier la continuité évoquée par TL, entre les tâches effectuées à la maison et dans le salariat ». Mais, espérant nous opposer une objection destructrice, ils remarquent avec perspicacité qu’« elle n’est pas systématique[43] », c’est-à-dire que cette continuité ne concerne pas 100 % des individus associés au groupe femme. Une telle objection doit-il laisser penser que nos auteurs considèrent que la division sexuelle du travail relève de la pure contingence – étant donné sa non-systématicité – et qu’en ce sens, ce phénomène ne mérite pas vraiment d’analyse? C’est en tout cas ce qui semble confirmé par leur absence marquée d’intérêt par la question. Or, suivant ce type de raisonnement, nos auteurs devraient également conclure que, puisqu’il arrive que des enfants de prolétaires deviennent des capitalistes, la reproduction sociale des classes « n’est pas systématique » et ne mérite donc pas qu’on en parle. De manière connexe, Astarian et Ferro soutiennent qu’on ne peut pas vraiment parler d’exclusion des femmes de la production de plus-value, parce « que les choses ne sont pas si simples » : il y a en effet des femmes qui effectuent un travail productif. Convenons que l’expression aurait pu être plus rigoureuse (toutes les femmes n’ont pas été historiquement exclues, mais elles l’ont été massivement). Ceci étant dit, cela ne supprime en rien la nécessité d’expliquer un phénomène qui persiste, malgré d’innombrables reconfigurations, depuis l’avènement du mode de production capitaliste. Et par ailleurs, cela ne rend pas moins banale l’objection qu’on nous oppose. La question qui se pose reste la même : y a-t-il oui ou non, une constance quelconque dans ce phénomène d’exclusion? Si oui – et ils le reconnaissent eux-mêmes –, alors il faut l’expliquer. Et dans ce cas, comment faire?
Première option. S’armer des Manuscrits de 44 de Marx – comme le font Astarian et Ferro – pour espérer trouver un point d’appui nettement plus solide et exhaustif pour penser le genre que ce que la théorie féministe a pu produire au cours des 75 dernières années et ainsi corriger « les théories contemporaines du genre ». À travers la réponse de nos auteurs, on apprend que les « rapports sociaux de sexe » font partie des rapports de l’homme (!) à son corps organique, eux-mêmes déterminés par la transformation du rapport de l’homme (!) à son corps inorganique[44]. Qu’est-ce qu’on retrouve derrière cette terminologie fumeuse? Rien d’autre que la bonne vieille thèse selon laquelle le rapport de genre n’est qu’un problème superstructurel, qu’il est de nature quasi immatérielle parce que non médiatisé par la nature, qu’il est entièrement déterminé par les rapports de classes et que celui-ci sera automatiquement solutionné par la révolution communiste, sans qu’il soit nécessaire de lutter spécifiquement sur le terrain du patriarcat. Astarian et Ferro nous disent donc avec précision comment ils conçoivent la subversion du genre :
une nouvelle phase [du rapport de genre] interviendra soit dans la prochaine restructuration du capital, soit dans un soulèvement victorieux du prolétariat. Dans le premier cas, elle se fera comme évolution fonctionnelle des rapports capitalistes, comme cela a été le cas lors des restructurations fordiste et post-fordiste. Dans le deuxième cas, elle se fera comme individualisation des prolétaires (hommes et femmes) dans l’insurrection.[45]
Sur ce sujet, l’ensemble de l’argument d’Astarian et Ferro repose sur le fait qu’ils rangent les « rapports sociaux de sexe » dans les seules transformations du « rapport au corps organique » (de l’homme). Ces rapports de sexe n’auraient donc rien à voir avec celles du rapport au corps inorganique (de l’homme), c’est-à-dire avec « la nature au sens fort du terme »[46]. Il faudrait nous dire ce que signifie ici un « rapport à la nature au sens fort du terme », puisque celui-ci semble exclure le fait d’enfanter, de transformer des aliments pour nourrir sa famille, de rendre habitable l’espace de vie, bref de réaliser toutes les tâches qui relèvent du travail domestique. Pour des gens qui tiennent à ramener le genre à sa « présupposition naturelle », il est surprenant de voir à quel point Astarian et Ferro ignorent les conditions naturelles minimales de reproduction de l’espèce humaine. Et si nos auteurs tiennent à se limiter au cadre étroit des manuscrits laissés non publiés par le jeune Marx, peut-être serait-il pertinent de relire plutôt ceux où celui-ci parle de la famille comme première forme de la division du travail où l’exploitation existe déjà comme « libre disposition de la force de travail d’autrui[47] ». Si dans notre second numéro nous dédions une section aux effets de la division sexuelle du travail sur les divisions en classes et en fractions de classe du mode de production capitaliste, c’est précisément parce que le genre ne peut être réduit à un rapport immatériel, culturel, qui serait entièrement déterminé par le rapport de classes. Ou pour parler comme nos philosophes attitrés du genre : les rapports de genre font eux aussi partie « des rapports de l’homme à son corps inorganique ».
Seconde option, plus osée celle-là. Devant l’inanité de la première option, s’intéresser à ce que des féministes ont à dire là-dessus. À ce titre, Sylvia Federici est l’une des autrices dont les travaux sont les plus instructifs relativement à l’histoire du genre dans ses rapports à l’émergence du mode de production capitaliste. C’est pourquoi, pour traiter de la division sexuelle du travail d’un point de vue historique, il est indispensable de s’y référer – ne serait-ce que de manière critique. Saisissant l’occasion au vol, Astarian et Ferro ne peuvent quant à eux résister à la tentation de faire le procès de son ouvrage Caliban et la sorcière et de nous associer à des thèses et des concepts complètement étrangers aux nôtres. À suivre Astarian et Ferro, il semblerait que citer une autrice implique désormais d’appuyer l’entièreté de son corpus théorique. De l’intérêt que nous accordons à l’analyse qu’offre Federici de la transformation des rapports de genre lors de l’émergence du capitalisme, nos critiques extrapolent une communauté d’idées parfaite entre elle et nous : prolétariat médiéval, sphère de la reproduction comme source de valeur, théorie de la transition – tous ces éléments seraient endossés par Temps Libre, parce que… nous avons repris l’idée selon laquelle l’émergence du mode de production capitaliste n’a été possible que sur la base d’une division sexuelle du travail précise qui n’a pu être établie que par des procédés violents. Pareillement, bien que nous citions Astarian et Ferro en vertu de l’intérêt de la notion de sursalaire qu’ils ont contribué à développer, nous serions bien embêté·e·s de nous porter à la défense du concept de travail productif qu’ils utilisent.
Au final, la seule critique sérieuse porte sur le lien de causalité que nous établissons entre le phénomène de répression des femmes à l’époque de la chasse aux sorcières et celui de l’augmentation démographique de l’Europe ayant permis l’extension de l’exploitation de la force de travail. Comme première objection, Astarian et Ferro soutiennent qu’un tel lien ne peut être établi, parce que la reprise démographique s’effectue dès 1450, soit avant la période de la chasse aux sorcières. Malheureusement, cette critique tire complètement à côté de sa cible : lorsque Federici insiste sur le rôle de la répression des femmes et de la sexualité non reproductive dans la reprise démographique, elle fait explicitement référence à la reprise qui suit le déclin démographique qui s’amorce en Europe à partir de 1580 (pour atteindre son point culminant vers 1620-1630) et non à celui causé par la crise de la Grande peste de 1346-1351[48]. Ce n’est donc pas la reprise qui suit cette dernière que Federici explique par la chasse aux sorcières, mais celle du XVIIe siècle. Comme seconde objection, Astarian et Ferro affirment que l’augmentation démographique s’expliquerait d’abord par « l’amélioration des conditions hygiéniques et alimentaires portées par une relance de la productivité du travail [49]». Il est certes concevable qu’une telle poussée démographique n’aurait pu avoir lieu sans la réunion de certaines de ces conditions. La question est donc de savoir quel facteur joue ici le rôle décisif : l’amélioration des conditions hygiéniques et alimentaires ou un mouvement de répression nataliste. Mais comme Astarian et Ferro se trompent de siècle, il leur est difficile de défendre de manière convaincante l’idée selon laquelle la reprise démographique qui se déroule à partir de XVIIe s’explique d’abord par « l’amélioration des conditions hygiéniques et alimentaires » en s’appuyant sur des faits… qui relèvent du XVe siècle. Or ce qui est marquant, c’est précisément le fait que, durant la première moitié du XVIIe siècle, coïncident à la fois une crise démographique générale et le développement de toute une série de mesures et de pratiques natalistes (répression de la contraception, de l’avortement, de l’infanticide, etc.) grâce auxquelles finit par être surmontée cette « crise ». À moins de penser la reproduction comme un phénomène purement naturel et entièrement déterminé par les aléas de la sécurité matérielle, il faut prendre au sérieux les interventions sociales effectuées sur les capacités reproductives, justement parce qu’elles ont historiquement rendu possible l’émergence du mode de production capitaliste et transformé durablement les rapports de genre.
Nous convenons du fait que le genre ne peut être analysé indépendamment des rapports de classes, tout comme du fait que le patriarcat n’a pas de dynamique purement autonome; il est notoire que ce dernier est chaque fois bouleversé par le passage d’un mode de production à un autre. Mais il est tout aussi évident que le genre n’est pas lui-même sans effet sur ces transitions. Et c’est précisément dans le sens de ces thèses que nous avons abordé le problème du genre. Inversement, pour Astarian et Ferro, celles-ci semblent impliquer qu’il n’y a rien à dire sur le sujet. Ainsi, plutôt que de fournir une véritable théorie de l’articulation du patriarcat et du mode de production capitaliste, ils esquissent au contraire ce qui s’apparente à une anthropologie générale du genre, teintée à la fois d’un naturalisme vulgaire et d’un optimisme naïf :
Plus fondamentalement, la « subversion du genre » doit être comprise comme un aspect de l’humanisation du rapport à la nature parvenue à un certain stade de développement. [Suit un passage où ils expliquent que les rapports de genre sont déterminés par les rapports de classe] Il est impossible d’en rendre compte sans analyser les rapports de classes (alors que l’inverse est toujours possible). Les théories contemporaines du genre, qu’elles le veuillent ou non, sont un produit de quelque 300 000 ans d’humanisation du rapport à la nature. Contrairement à ce que ces théories prétendent, le sexe (la présupposition naturelle) précède bien le genre logiquement et historiquement. Le genre, c’est-à-dire la présupposition sociale du sexe, ne saurait être une réalité présente au même degré depuis les débuts de l’histoire humaine. C’est un résultat historique. Le « développement progressif du caractère problématique du genre » correspond au stade le plus récent d’approfondissement du rapport à la nature intérieure et extérieure. Mais la « subversion du genre », si l’on tient à appeler ainsi le passage à un degré supérieur d’humanisation du rapport à la nature sous l’angle du sexe (voilà qui est beaucoup plus clair! nda), n’est nullement à la portée des luttes de femmes que TL porte en exemple de leur caractère prétenduement anticapitaliste. Une nouvelle phase de ce rapport interviendra soit dans la prochaine restructuration du capital, soit dans un soulèvement victorieux du prolétariat.[50]
Il y a beaucoup de choses ici. Tout d’abord, le sexe est présenté comme la base explicative du genre, comme le « naturel » sur lequel se développe le « social » Bien que le genre soit caractérisé comme la « présupposition sociale » du sexe, on voit que pour eux le sexe reste logiquement et historiquement premier (« le sexe est la présupposition naturelle du genre ») c’est-à-dire que l’affirmation « le genre est la présupposition sociale du sexe » est vidée de son sens et n’est là que pour jeter de la poudre aux yeux. Bien sûr que le genre est un résultat historique, mais ce que ne voient pas Astarian et Ferro, c’est justement que le sexe aussi est un résultat historique, une catégorie sociale. Les catégories de sexe utilisées pour penser les processus de sexuation différenciés de l’espèce humaine n’en constituent pas le reflet neutre et impartial, elles ne font pas qu’enregistrer ce qui est là. La transformation de ces catégories au cours de l’histoire représente d’ailleurs le premier indice de cette non-identité. Contrairement à ce que prétendent les théories faisant du sexe le fondement naturel et inébranlable sur lequel s’ajoutent ensuite des déterminations sociales (le genre), les traits biologiques que l’on rassemble sous les catégories de « sexe » ne se répartissent pas en deux groupes rigides, mutuellement exclusifs et conjointement exhaustifs. Chez l’humain, le sexe est au contraire fondamentalement polymorphe, c’est-à-dire que coexistent, chez une grande part des individus, des traits associés tantôt à l’un, tantôt à l’autre sexe[51]. La bicatégorisation du sexe est beaucoup plus un présupposé de l’observation qu’un résultat de celle-ci. Les déterminations biologiques que l’on attribue au sexe sont certes naturelles, mais la division de celles-ci en deux catégories distinctes (mâle/femelle) n’est possible que sur la base du genre, qui, précisément, assigne des traits déterminés à ces catégories[52]. En réalité, l’unité des sexes mâle/femelle n’a de sens que par rapport à des préoccupations sociales, telles que celles consistant à vouloir identifier les corps capables de mener à terme une grossesse.
En quoi la position que soutiennent Astarian et Ferro se distingue-t-elle de la bonne vieille position des curés qui veulent fonder en nature les identités de genre? Fort étrangement, par sa similitude avec la conception kantienne du développement historique. Chez Kant, l’histoire humaine progresse suivant une courbe asymptotique qui tend vers la paix universelle; en résolvant les conflits que suscite la nature humaine par la création de nouvelles règles, l’espèce humaine moralise progressivement le monde jusqu’à instaurer un système cosmopolite d’équité parfaite. Remplacez la morale par le genre et vous obtenez approximativement l’anthropologie du genre d’Astarian et Ferro : d’êtres barbares, purement sexuels, qu’ils étaient, les êtres humains deviennent vraiment humains « en humanisant » leur rapport à la nature par l’intermédiaire du genre. Avant que ce dernier n’eût existé, l’homme et la femme se comportaient vis-à-vis de l’autre de manière bestiale et animale, mais cela change lorsque le genre apparaît, puisqu’il produit ses effets civilisateurs et nous fait passer d’un degré sans cesse supérieur « d’humanisation de la nature ». En établissant des règles et en produisant des identités genrées par lesquelles le mâle devient homme et la femelle, femme, les êtres humains façonnent la nature (le sexe) à leur image. Le genre occupe une fonction historique progressiste : le degré de sophistication qu’il atteint nous permet de mesurer la maîtrise qu’a l’homme sur sa propre nature, sur son sexe. Au contraire de ce que dit Temps Libre, il faut donc penser la véritable « subversion du genre » comme le « passage à un degré supérieur d’humanisation du rapport à la nature sous l’angle du sexe »; loin d’espérer la disparition du genre, Astarian et Ferro semblent souhaiter qu’il devienne encore plus réel, qu’il s’épanouisse davantage. C’est pourquoi lorsque ceux-ci parlent d’« individualisation des prolétaires (hommes et femmes) dans l’insurrection », il n’y a aucune raison d’y voir là, comme on pourrait s’y attendre, le souhait que cette individualisation se fasse contre l’assignation à un sexe et à un ensemble d’attributs genrés. Bien au contraire, tout porte à croire qu’une telle assignation leur apparaît naturelle et indépassable.
Comment le patriarcat se modifie-t-il au fil de l’histoire pour participer activement à la reproduction des différents modes de production? Pourquoi y a-t-il une permanence du rapport de genre à travers l’ensemble des sociétés de classes? Voilà des questions qui n’intéressent pas vraiment Astarian et Ferro. Pour eux, il semble suffisant d’affirmer que le sexe est anhistorique, que le genre est, lui, historique et que nous atteindrons un nouveau degré d’humanisation du rapport à la nature, que ce soit dans la restructuration ou suite à un soulèvement victorieux du prolétariat.
3. Insurrection et révolution
Théorie des classes, théorie de la révolution
Nous avons déclaré, dans notre dernier numéro, qu’une théorie communiste des classes doit nécessairement être, en même temps, une théorie de la révolution. Astarian et Ferro affirment pour leur part être restés « sur leur faim » quant à cette dernière, n’ayant pas trouvé ce qu’ils attendaient y trouver. Ce qui pour eux constitue le « noyau de la théorie communiste », l’insurrection, y est absent. C’est un fait que nous ne l’abordons pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous cherchons à mettre en évidence le lien intime qui unit le cours normal du développement du capital et la révolution en montrant que ce cours est contradictoire, c’est-à-dire qu’il porte en lui-même la possibilité de son dépassement. Mais une théorie communiste des classes doit précisément être en mesure de rendre compte d’un tel lien dans sa façon de définir les classes du mode de production capitaliste. En analysant l’activité spécifique du prolétariat au sein des rapports de production (le travail productif), l’identité de ce qui le définit comme classe et de ce qui en fait une classe révolutionnaire apparaît : son activité participe du caractère contradictoire du capital (en même temps qu’il le reproduit, il lui rend la vie plus difficile en lui résistant) tout en étant le seul groupe de la société en mesure d’assurer, lorsqu’éclate une crise profonde, la suppression du rapport d’exploitation capitaliste (au sens où il est le seul capable d’en garantir l’arrêt généralisé et de redémarrer la production sur une base post-capitaliste). Les crises, ces accoucheuses de révolutions, n’apparaissent quant à elles plus comme une fatalité qui s’impose au prolétariat, mais comme le produit de son activité à lui aussi : il reproduit les conditions de son exploitation en cherchant à l’atténuer, à tel point qu’elle finit par devenir impossible dans les conditions qui prévalaient.
Ainsi, relativement à la tâche que nous nous sommes donnée – définir les classes du mode de production capitaliste, leur fonction au sein de la totalité sociale et par là, leur (in)capacité à prendre des mesures suffisantes pour dépasser la société capitaliste –, parler de l’insurrection ne nous aurait pas beaucoup avancé. Il ne s’agissait pas de décrire la manière dont se déroule un processus pré-révolutionnaire à partir du cours quotidien de la lutte des classes, mais bien d’identifier les conditions à partir desquelles un groupe de la société peut non seulement bloquer la reproduction du rapport social d’exploitation capitaliste, mais instaurer des rapports sociaux entièrement nouveaux, et ce, de manière pérenne. À cet égard, le prolétariat est révolutionnaire à au moins deux niveaux. Tout d’abord, en tant que classe du travail productif, il participe, de par son activité quotidienne la plus banale, à provoquer la crise, tout comme le fait à sa façon – et malgré elle – la classe capitaliste. Leur lutte, ouverte ou latente, détermine dans ses grandes lignes le cours historique contradictoire du capital qui ne peut que déboucher sur des crises. Mais surtout, le prolétariat est la seule classe qui, dans celles-ci, peut assurer une reprise de la production non capitaliste, c’est-à-dire qui soit capable de supprimer la base matérielle de la production capitaliste et, sur ses ruines, d’en organiser une nouvelle. En ce sens, la théorie de l’insurrection se fonde sur la théorie plus générale de la révolution : elle en constitue une partie certes indispensable, mais elle ne peut rendre compte par elle-même de ces éléments fondamentaux. Cela, Astarian et Ferro ne le voient pas. Et c’est pourquoi ils nous reprochent d’escamoter le moyen terme que représente l’insurrection – ce qui nous priverait de la capacité à comprendre le passage entre les luttes quotidiennes et la révolution communiste comme rupture. En faisant jouer un rôle central à la contradiction entre travail nécessaire et surtravail au sein de la société capitaliste, nous aurions « refusé » de venir sur leur terrain, c’est-à-dire d’insister sur les différences qualitatives qui séparent les différents stades de la lutte du prolétariat et de même, d’accorder aux insurrections le statut de « noyau de la théorie » et celui de « périphérie » aux luttes quotidiennes et révolutionnaires.
Pourquoi et comment le prolétariat peut-il faire la révolution?
Ce qui rend peut-être difficilement assimilable, pour Astarian et Ferro, la divergence d’idées qui nous oppose à eux, c’est que nous posons le problème de la révolution dans des termes différents. Ces derniers raisonnent à partir d’une observation qui semble, à première vue, évidente : les insurrections ont historiquement été le fait du prolétariat et puisque la révolution n’est possible que sur la base de l’insurrection, c’est le prolétariat qui sera conduit à mener à son terme le dépassement du mode de production capitaliste. Mais plus précisément, pourquoi le prolétariat est-il, selon Astarian et Ferro, amené à faire la révolution et comment la fait-il? Pour eux, cela va de soi : le prolétariat est révolutionnaire, parce qu’il est la classe des sans-réserves, ce qui veut dire que lorsque la crise éclate, les prolétaires n’ont plus aucun autre moyen de survivre que de s’insurger et, s’ils et elles en ont la chance, de faire la révolution. Ainsi, dans un premier temps, l’éclatement d’une crise profonde forcera celui-ci – en tant qu’il se compose de sans-réserves et que, par hypothèse, le capital cesse d’employer la force de travail – à s’emparer d’éléments du capital pour ne pas crever de faim et pour se donner les moyens de lutter contre la répression[53]. C’est pourquoi la saisie de moyens de production et l’armement du prolétariat constituent, selon Astarian et Ferro, les deux critères permettant d’identifier une situation insurrectionnelle[54]. Du fait de cette crise, le prolétariat est amené à s’attaquer à ce qui représente pour eux le « cœur » du rapport social capitaliste : « le monopole de la propriété capitaliste sur les conditions de la reproduction matérielle des prolétaires. [55] » L’insurrection constitue donc ce moment où de larges masses prolétariennes se soulèvent dans une logique qui rompt avec celle caractérisant les luttes quotidiennes. En effet, si ces dernières se limitent généralement à une refonte plus « équitable » du rapport d’exploitation, les luttes insurrectionnelles se caractérisent par des pratiques dont l’objectif est de garantir la survie immédiate du prolétariat à l’extérieur du rapport d’exploitation capitaliste[56]. Cette situation spéciale fournit donc l’occasion de l’élaboration d’un rapport social nouveau, où les individus sont contraints d’apprendre à se reproduire sans passer par l’intermédiaire du capital. À ce titre, la confiscation d’éléments du capital en vue d’assurer la reproduction matérielle des insurgé·e·s et de bloquer celle des capitalistes est incontournable, autant que l’est celle des armes qui permettent de défendre cet acquis.
Mais pour assurer sa survie dans la durée, le prolétariat sera dans un deuxième temps contraint de reprendre en main ce qui constituait jusque-là le capital productif pour s’en servir à son compte, que ce soit en le transformant ou en le détruisant simplement. Dans ce contexte, la prise en charge de la production se fera néanmoins de manière non capitaliste, c’est-à-dire qu’elle sera amorcée suivant d’autres règles que celles présidant à l’organisation capitaliste du travail ; les prolétaires seront tout simplement forcé·e·s, compte tenu du caractère extraordinairement tumultueux de la lutte des classes, de produire de manière non productiviste et non normalisée, c’est-à-dire d’improviser, de «produire par bricolage»[57]. C’est de là seulement que se dégagera la possibilité de l’abolition effective des classes et des catégories du mode de production capitaliste. Ce deuxième moment correspond à la révolution proprement dite, à la communisation. L’aspect purement négatif de l’insurrection finit par laisser place à une réorganisation de la production qui rend positivement irreproductibles les anciens rapports sociaux.
Il faut faire ici deux remarques. Premièrement, ce qui découle de tout ce schéma, c’est que ce qui fait du prolétariat une classe amenée à faire la révolution — et effectivement capable de réaliser cette tâche — repose uniquement dans le fait que ses membres sont dépourvu·e·s de réserves, c’est-à-dire que tout repose dans sa précarité présumée. Dans ce cas, pourquoi prendre la peine de s’embarrasser du concept de prolétariat et ne pas dire bêtement et simplement : les pauvres feront la révolution parce que, pour survivre, ils et elles n’auront pas le choix de la faire? En cherchant à savoir comment et pourquoi, selon Astarian et Ferro, le prolétariat est la classe susceptible d’abolir le mode de production capitaliste, on finit par comprendre qu’il est accessoire que celui-ci soit partie prenante de la contradiction qui meut la société capitaliste.
Deuxièmement, il y a chez eux une incohérence flagrante. D’un côté, le passage de l’insurrection à la révolution est caractérisé (à juste titre) comme le moment où ce qui constituait jusqu’alors le capital productif est massivement repris en main et transformé de manière à répondre aux besoins matériels les plus variés des insurgé·e·s/révolutionnaires : la production reprend, mais sur les ruines du précédent mode de production. C’est donc à ce moment seulement que l’objectivité matérielle du capital – sa base matérielle – commence à être supprimée de manière définitive. La révolution communiste proprement dite, c’est cela. Mais de l’autre côté, Astarian et Ferro désignent explicitement les sans-réserves comme le sujet de ces transformations. Le problème, c’est que ce ne sont pas tous les sans-réserves qui peuvent opérer ce passage, c’est-à-dire réorganiser la production dans des conditions extraordinaires, anarchiques, chaque fois singulières et ainsi assurer la reproduction matérielle des insurgé·e·s/révolutionnaires. Voler des morceaux de tôles pour se construire des barricades, tout le monde peut le faire : le commis du dépanneur comme l’ouvrière de l’industrie automobile. Mais pour résoudre des problèmes liés à la production de tels ou de tels objets jugés nécessaires par les révolutionnaires, il faut s’y connaître un minimum : être familier.ère avec les procédés de fabrication, savoir utiliser telle ou telle machine, tel outil, connaître moindrement les matériaux entrant dans la composition de l’objet. Bref, il faut avoir travaillé dans le secteur, voire dans un site de production déterminé. L’initiative et l’imagination peuvent pallier l’expérience dans une certaine mesure, mais cette mesure doit diminuer radicalement suivant le degré de complexité de fabrication d’un objet. Or, il est évident que pour produire sur une base moindrement massive, la production ne peut manquer d’être moindrement complexe. Et c’est d’autant plus le cas en ce qui a trait à la fabrication de certains objets spécialisés qui resteront, au moins pour un temps, indispensables (matériel médical, technologie de pointe, approvisionnement énergétique, etc.). Aussi faut-il insister sur le fait que le travail manuel auquel est relégué le prolétariat lui apprend néanmoins à produire – aussi étriqué et aliénant cet apprentissage soit-il. Même la production capitaliste hautement développée – qui repose pour une grande part sur le travail intellectuel des spécialistes – est impensable sans l’inventivité et la débrouillardise quotidienne des travailleur·euse·s manuel·le·s. Ainsi, les véritables sujets de ces transformations au sein de la production et plus généralement, au niveau de la révolution communiste, ce sont les travailleuses et travailleurs productif·ve·s. Non pas les sans-réserves. Être sans-réserve, voilà la détermination en vertu de laquelle on est sujet de l’insurrection : c’est d’abord en tant que tel que les individus pillent et se battent contre la reprise du travail capitaliste. Nul besoin d’être prolétaire – travailleur ou travailleuse productif·ve – pour s’insurger de la manière décrite (correctement) par Astarian et Ferro. Mais dès que le centre de l’insurrection se déplace et qu’il devient à nouveau impératif de produire, c’est le prolétariat, comme classe du travail productif, qui reprend les devants de la scène. Les prolétaires peuvent très bien être le sujet central de ces deux moments, mais ils et elles ne le sont pas en vertu de la détermination.
C’est pourquoi nous sommes porté·e·s à croire que, lorsque Ferro et Astarian parlent du prolétariat comme « classe des sans-réserves employé·e·s par le capital », c’est parce qu’ils sentent que ce n’est pas suffisant d’être pauvre pour faire partie de la classe sans laquelle la révolution est impossible. Mais cette intuition, si elle existe vraiment chez eux, ne parvient jamais à s’imposer de manière à résoudre la tension qui traverse leur théorie du prolétariat. Ou bien le prolétariat, comme classe des sans-réserves, n’est qu’en partie révolutionnaire (seule une part des sans-réserves est réellement en mesure de prendre des mesures communisatrices) et il n’est donc pas vraiment une classe révolutionnaire, ou bien une telle définition du prolétariat est tout simplement trop extensive. Or, du moment que le prolétariat est défini par son activité plutôt que par un quelconque statut socio-économique, cette difficulté s’évanouit.
Par conséquent, malgré ce qu’en disent Astarian et Ferro, notre théorie est donc tout à fait capable de répondre aux questions du pourquoi et du comment relatives au rôle révolutionnaire du prolétariat. Comme nous l’avons vu, notre approche consiste, pour ce faire, à partir de la position fonctionnelle des agents dans la reproduction contradictoire de l’ensemble. Pourquoi le prolétariat peut-il provoquer la révolution? Parce que son activité spécifique – produire de la plus-value – le place dans une position telle que seul celui-ci peut effectivement faire cesser la reproduction du capital sur une échelle suffisamment large pour que le capital entre dans une crise profonde. Comment peut-il mener à terme la révolution? Il est le seul qui soit en mesure de rendre irreproductible le rapport d’exploitation capitaliste en assurant une reprise de la production telle qu’elle donne le coup de grâce au capital.
Luttes quotidiennes et contradiction prolétariat-capital
Remarquons en premier lieu que, dans leur réponse, nos contradicteurs nous attribuent une idée qui nous est étrangère. Ceux-ci nous réprouvent en effet une « contradiction toute formelle du travail productif à la fois nécessaire et de trop ». Pourtant, nulle part nous ne parlons de la « contradiction du travail productif ». Restituons les faits : en tant qu’activité du prolétariat, le travail productif correspond à l’un des pôles de la contradiction prolétariat-capital et non pas à la contradiction elle-même. S’il s’agit d’une nuance, la différence est de taille. Le prolétariat est engagé dans un rapport contradictoire au capital en tant qu’ilest la classe qui effectue le travail productif; en même temps qu’il est nécessité par le capital, ce dernier tend à l’éjecter du procès de production. D’ailleurs, contre cette idée, Astarian et Ferro soutiennent que le prolétariat occidental n’aurait pas vraiment décru quantitativement, mais qu’il aurait seulement été délocalisé et qu’en ce sens, on ne pourrait y voir l’expression d’un procès contradictoire, mais seulement celle d’une « tendance qui a ses contre-tendances[58] ». Admettons que ce que perdent les pays occidentaux est tout entier gagné par des pays dont la composition organique du capital est plus faible. Nous aimerions bien qu’ils nous expliquent comment il est possible, compte tenu du progrès constant de la productivité du travail, que la part de la population qui se consacre à la production matérielle (ce qui inclut le prolétariat) ne diminue pas relativement à long terme. Le prolétariat mondial peut évidemment croître du fait de la dissolution de modes de production précapitalistes, mais ce mouvement est limité historiquement et ses effets sont appelés à se faire toujours moins sentir. Si Astarian et Ferro sont d’avis que le prolétariat croît et doit croître indéfiniment (absolument et relativement), qu’ils l’affirment franchement.
Nous avons déjà vu que les critiques que nous adressent Astarian et Ferro peuvent enchaîner des raisonnements à développement logique variable. Après avoir concédé notre apport à leur théorie de l’encadrement – qui consiste à montrer que le sursalaire n’est pas uniquement justifié par un travail de direction/surveillance –, ils nient dans la phrase suivante ce qui fait de notre apport un apport. À travers ce qui suit, nous verrons que nos auteurs se prêtent au même genre d’exercice et rendent par là leur critique sur la nature de la contradiction du surtravail de plus en plus confuse. Dans un premier temps, Astarian et Ferro nous reprochent d’accorder, à l’instar de Théorie communiste, une aussi grande importance à la contradiction du surtravail, au fait que, « pour la première fois, la classe productive est à la fois toujours nécessaire, à la fois toujours de trop »[59]. Pourquoi? Parce qu’il s’agirait uniquement d’une « belle formule ». La contradiction qu’elle définit serait « toute formelle », trop « logique » – ce qui est d’ailleurs uniquement un problème pour qui réduit la logique à la logique formelle, c’est-à-dire pour qui sépare rigidement la logique de la réalité. Devrait-on en comprendre que cette contradiction (parce que trop « logique ») n’en serait une que dans l’esprit, comme les myriades d’antinomies métaphysiques dont les professeur·e·s d’université raffolent? Cherchent-ils à dire que la contradiction entre travail nécessaire et surtravail est du même ordre que les expériences de pensée qui spéculent sur l’inexistence du monde extérieur? Mais malgré ce reproche, ceux-ci tranchent, dans un deuxième temps, sur le fait que « la contradiction mise en avant par TL n’en est pas une[60] » et qu’il s’agit plutôt d’une « tendance ». Il faut pourtant savoir se décider : s’agit-il d’une contradiction ou d’une simple tendance?
Prenons toutefois pour acquis qu’ils optent pour la seconde option. Selon eux, il y aurait donc la « vraie contradiction », celle qui oppose les deux classes fondamentales et, comme résultat de celle-ci, une tendance (le prolétariat qui est toujours nécessaire mais toujours de trop). Chez eux, la vraie contradiction se traduit plus précisément par l’opposition entre prolétariat et classe capitaliste pour la fixation du curseur du surtravail :
Le rapport entre les deux classes de la société capitaliste se calque sur le rapport entre travail nécessaire et surtravail. Tandis que les prolétaires cherchent naturellement à augmenter le temps du travail nécessaire, c’est-à-dire la valeur de leur force de travail, les capitalistes n’achètent cette même force de travail que pour sa capacité à travailler au-delà de ce qui lui est nécessaire pour se reproduire, autrement dit à produire de la plus-value.[61]
Notons au passage qu’on ne sait pas très bien pourquoi, de leur point de vue, le fait de produire de la plus-value pourrait exprimer une opposition entre des classes, parce qu’il est selon eux contingent qu’un·e prolétaire produise de la plus-value. Autrement, inutile d’insister sur le fait que cette opposition est « contradictoire » dans un sens assez pauvre. Ce qui, seul, fait son caractère contradictoire, c’est que chaque fois qu’une classe parvient à déplacer le curseur du surtravail en sa faveur, elle le déplace en défaveur de l’autre; chaque sou gagné l’est au détriment de l’autre. Utilisé dans ce sens, le mot « contradiction » ne signifie pas autre chose qu’« antagonisme ». On pourrait tout aussi bien remplacer toutes les occurrences du premier par le second, cela ne changerait rien à ce qu’ils disent. On comprend bien pourquoi, avec une conception aussi étriquée du concept de contradiction, Astarian et Ferro ne voient pas en quoi le caractère contradictoire du cours quotidien du capital fait en sorte qu’il peut et doit déboucher sur autre chose. Lorsque nous parlons de la contradiction entre le prolétariat et le capital, c’est-à-dire de la contradiction entre le travail nécessaire et le surtravail au sein du mode de production capitaliste, nous ne référons pas uniquement au conflit pour la division de la journée de travail. Pour parler de contradiction au sens strict, il ne faut pas seulement démontrer qu’un conflit oppose deux termes, mais également que ceux-ci sont impliqués dans un rapport dont les conditions interdisent la pérennité du rapport lui-même. Ainsi, pour parler de la contradiction entre le travail nécessaire et le surtravail, il ne suffit pas d’énoncer l’existence de ces deux termes, mais plutôt d’analyser les lois tendancielles qui rendent l’exploitation du surtravail de plus en plus problématique. Du reste, le fait que le prolétariat « soit toujours nécessaire et toujours de trop » n’exprime en rien une tendance : au contraire, il définit positivement une contradiction qui, elle, s’exprime notamment par la tendance à la diminution du poids démographique du prolétariat au sein de la société capitaliste.
Par conséquent, quand Astarian et Ferro indiquent que la diminution relative du « travail productif […] sous l’effet de l’accumulation du capital » est la tendance de la contradiction fondamentale et non la contradiction elle-même, ils disent donc quelque chose de juste, mais ils semblent ignorer qu’une contradiction sans tendance, sans dynamique, n’est qu’une opposition statique seulement bonne pour les exercices d’introduction à la logique. Si nous pouvons parler d’une contradiction dans la réalité et non simplement d’un antagonisme ou d’une contradiction dans la pensée – c’est-à-dire une erreur de raisonnement –, c’est précisément parce que nous avons affaire à une contradiction en procès qui ne peut être séparée de sa tendance. Pour exemplifier tout cela, prenons quelques contradictions purement formelles, afin de voir ensuite ce qui les distingue d’une contradiction dialectique.
Contradictions formelles :
1. A: Il n’y a pas de travail non exploité.
-A: Le travail improductif n’est pas exploité.
2. A: L’insurrection n’est pas un « scénario imaginé » par Astarian, mais un phénomène historique observable dans l’histoire du mode de production capitaliste.
-A: Il n’y a pas de précédent historique au scénario insurrectionnel rendant possible la communisation.[62]
3. A: La notion de travail de subordination explique avec plus de précision ce qui justifie le sursalaire.
-A: La notion de travail de subordination n’explique pas ce qui justifie le sursalaire.
Ici, nous avons affaire à de simples fautes de raisonnement qui ne concernent pas la dynamique contradictoire de la réalité sociale, mais uniquement l’esprit d’auteurs pensant pouvoir faire coexister ces propositions. Inversement, lorsque nous reprenons la formule de Théorie communiste affirmant que le prolétariat est à la fois nécessaire et de trop, nous ne référons pas à une situation statique où ces deux déterminations contraires s’appliqueraient toujours invariablement au prolétariat. Le rapport social capitaliste existe et se reproduit uniquement par l’exploitation du prolétariat et c’est en cela que celui-ci est nécessaire, mais ce rapport tend à sa propre suppression parce que, pour augmenter la productivité du capital, il évince progressivement ce par quoi il existe, à savoir l’exploitation du travail humain. Ainsi, c’est parce que les conditions spécifiquement capitalistes d’exploitation du surtravail impliquent une certaine dynamique que l’on peut parler de contradiction dans un sens proprement dialectique. Sans l’étude des lois tendancielles du mode de production capitaliste – étude qui fait d’ailleurs la spécificité de la critique de l’économie politique marxiste –, on ne peut pas réellement parler de contradiction sans tomber dans la simple opposition d’intérêts.
Au risque de se répéter, il n’est pas suffisant qu’il y ait un rapport d’opposition, un rapport d’antagonisme entre des classes pour que ce rapport soit contradictoire. Le fait qu’une classe s’enrichisse sur le dos d’une autre ne fait pas du rapport qui les lie une contradiction. L’exploitation n’est pas en tout temps et en tout lieu une contradiction. Par voie de conséquence, toute la multiplicité des luttes dont l’objet est l’atténuation de l’exploitation et qui se déroulent au sein de la société capitaliste ne participe pas nécessairement du caractère contradictoire de celle-ci. Le fait brut que des employé·e·s revendiquent une diminution des cadences, une augmentation des congés payés ou l’élargissement de la couverture des soins dentaires ne dit rien sur la nature du rapport qui les lie au capital. Seules les luttes des travailleur·euse·s productif·ve·s contre leur exploitation mettent directement en jeu la contradiction qui meut la société capitaliste. Seules celles-ci peuvent déboucher sur une crise profonde du capital. Les sans-réserves improductif·ve·s n’ont pas, de par la place qu’illes occupent au sein de la totalité sociale, une telle capacité. Or, le prolétariat d’Astarian et de Ferro ne peut pas provoquer la crise en tant que prolétariat, parce que son activité de classe reste, chez eux, extérieure à la contradiction qu’est l’exploitation capitaliste (seule une partie de leur prolétariat est exploitée et donc impliquée par elle).
Plus largement, de la manière dont ils le pensent, le cours quotidien de la lutte des classes apparaît condamné à s’éterniser tant et aussi longtemps que n’intervient pas un événement extraordinaire. En effet, leur conception étriquée de la contradiction – et par là, du caractère contradictoire du cours quotidien de la lutte des classes – ne permet pas d’expliquer le passage en autre chose de celles-ci. Ce n’est qu’avec l’insurrection que s’établit un passage entre « cours quotidien » et « révolution ». Mais à peine ont-ils trouvé cette solution qu’ils font face au même problème : comment penser le passage du cours quotidien à l’insurrection, si celui-ci ne tend pas lui-même à se saborder? Ils font alors appel à la crise. Mais cette solution reste tout aussi partielle, parce qu’on ne voit pas, sur la base de leur conception de la « vraie contradiction » – qui se résume à un rapport d’antagonisme opposant prolétariat et classe capitaliste – ce qui doit mener à la crise. Il faut qu’il y ait, disent-ils, « pénurie de plus-value », qu’il y ait « des capitaux et des capitalistes en trop par rapport à la masse de plus-value socialement disponible.[63] » Mais comment parvient-on à une telle pénurie si, par hypothèse, le travail nécessaire permet de s’approprier du surtravail? Ne pourrait-on pas multiplier à l’infini l’exploitation du travail? Justement, non. Et la raison fondamentale de cette impossibilité repose dans la manière dont le capital, d’après son concept et en réaction aux luttes prolétariennes, est amené à se valoriser, à savoir : grâce à l’accroissement de la productivité du travail[64]. Or, cet accroissement se traduit par la hausse de la composition organique du capital et en cela, par la baisse tendancielle du taux de profit, c’est-à-dire par la diminution de la part du travail pouvant être exploité par rapport à une masse donnée de capital. Par cette façon qu’a le capital de se valoriser davantage, il sape la base même sur laquelle sa valorisation est possible : l’exploitation du travail. Plus le capital exploite intensivement, plus il cherche à accroître le taux de plus-value par l’augmentation de la productivité, moins il pourra exploiter par la suite. L’exploitation capitaliste, dont les modalités sont précisément l’objet des luttes du cours quotidien de la lutte des classes, est donc elle-même une contradiction et c’est cela qui explique qu’elle débouche sur des crises. Tant que le caractère contradictoire de ce cours n’est pas élucidé, les crises ne pourront manquer d’apparaître comme des événements fortuits, parce qu’extérieures à la lutte des classes.
Il est possible que ce texte n’ait pas répondu à la totalité des objections qui ont été faites à notre dernier numéro – ce qui ne peut surprendre compte tenu de leur nombre et, il faut le mentionner, de leur qualité variable. Toutefois, nous estimons avoir apporté des réponses décisives à l’essentiel d’entre elles. À travers leurs critiques, Astarian et Ferro nous auront surtout fourni une nouvelle occasion de montrer que le prolétariat ne peut en aucun cas être séparé de sa pratique spécifique de classe : le travail productif. Comme nous l’avons notamment vu dans la troisième section de ce texte, définir le prolétariat par le statut de « sans-réserves » ne peut mener à autre chose qu’à des aberrations. Ni le cours quotidien de la lutte des classes, ni la révolution, ni même la crise ne peuvent être pensés convenablement sans un solide concept de prolétariat. Or, ce n’est certainement pas sur la base de la « solution » d’Astarian au problème du travail productif qu’un tel concept peut être construit. Contre celle-ci, il importe au contraire de prendre au sérieux les rapports sociaux concrets au sein desquels s’inscrit tel ou tel travail.
Enfin, en ce qui a trait à la classe moyenne, nous avons pu voir encore une fois que ni le fait de recevoir un sursalaire, pas plus que le fait d’encadrer ne constituent des critères à même de rendre compte de la diversité des tâches qu’effectuent ses membres. Mieux : en s’attardant à cette diversité, la division sexuelle du travail qui s’y opère ne peut que sauter aux yeux. Nous laisserons donc aux lecteurs et lectrices le soin de juger quelle voie est la plus à même d’apporter une explication véritablement matérialiste à ce phénomène : celle qu’emprunte Temps Libre ou celle que préconisent Astarian et Ferro.
Montréal, décembre 2021.
[1] Astarian et Ferro, Le ménage à trois de la lutte des classes, L’Asymétrie, 2019, p. 34. Ainsi, il serait justifié de ne rien dire sur l’appartenance de classe des deux millions d’individus qui, en France, font partie de la classe moyenne non salariée, en tant qu’ils ne sont que deux millions – contre dix millions pour la partie salariée de la classe moyenne. Le prolétariat des pays capitalistes occidentaux est en déclin numérique depuis les années 70, devrions-nous cesser d’en parler?
[2] Temps Libre, n. 2, pp. 190-198.
[3] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 3.1.
[4] Astarian et Ferro, Le ménage à trois de la lutte des classes, p. 45.
[5] Ibid., p. 46.
[6] Ibid., p. 380.
[7] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 2.2.(Nous soulignons.)
[8] Ibid. (Nous soulignons.)
[9] Astarian, op. cit., pp. 175-176.
[10] Astarian et Ferro, op. cit., p. 385.
[11] Les études sur l’endettement des ménages au Canada indiquent une concentration de la dette chez les personnes dont le revenu excède 100 000$/année, concentration qui baisse corollairement au niveau de revenu. On note également un lien étroit entre le fait d’être propriétaire de son logement et le niveau d’endettement. Ces données confirment donc une concentration de l’endettement chez les personnes qui partagent les caractéristiques – en termes de revenu – de la classe moyenne sursalariée. Cf. Chawla et Uppal. « L’endettement des ménages au Canada », L’emploi et le revenu en perspective, été 2012, vol. 24, no 2, no 75-001-XIF au catalogue de Statistique Canada.
[12] INSEE, enquête « Histoire de vie et Patrimoine 2017-2018 ».
[13] Astarian, op. cit., p. 271.
[14] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 2.3.
[15] « Changes in U.S Family Finances from 2016-2019 », p. 11. Les différences de patrimoine médian net selon l’âge sont les suivantes (en $US) : moins de 35 ans, 13 900$ ; 35 à 44 ans, 91 300$ ; 45-54 ans, 168 600$ ; 55-64 ans, 212 500$ ; 65-74 ans ; 266 400$ ; 75 ans et plus, 254 800$.
[16]Statistique Canada. Tableau 36-10-0585-01. Comptes économiques répartis pour le secteur des ménages, patrimoine, par caractéristique, Canada, annuel, inactif.
[17] Astarian et Ferro, op. cit., section 2.3.
[18] Emploi-Québec, Guide des salaires selon les professions au Québec, édition 2017. Au Québec en 2016, le salaire médian s’élevait à 23$/heure alors que le salaire minimum était quant à lui de 10,75$/heure. Pour les métiers mentionnés dans le texte, les salaires médians étaient les suivants : 1. Plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs et latteurs : 31,25$/heure. 2. Briqueteurs-maçons : 34$/heure. 3. Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage : 22$/heure. 4. Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels : 25,55$/heure.
[19] Le prolétariat blanc étatsunien des années 60-70 est un exemple notoire d’une telle possibilité.
[20] Astarian, op. cit., p. 280.
[21] Comparez cette affirmation avec le reproche qu’il fait à R.S. de rassembler dans un rapport d’exploitation attrape-tout l’ensemble des prolétaires (productif·ve·s ou non). Cf. Ibid., p. 174.
[22] Ibid., p. 118.
[23] Ibid., p. 147.
[24] Ibid., p. 196.
[25] Ibid., p. 175.
[26] Curieusement, au chapitre 3 de son livre, Astarian nous parle de « l’exploitation du travail par le non-travail ». Le « non-travail » est-il un nom différent pour désigner la même chose (la « classe de la propriété »)? Ou bien s’agit-il d’un concept différent – ce qui contredirait l’idée selon laquelle seule la classe de la propriété peut exploiter un travail? Cf. ibid., p. 113.
[27] Temps Libre, n. 2, pp. 80-81.
[28] Marx, Le Capital, livre 1, t. I, p. 214.
[29] Marx, Le capital, livre 3, t. I, 1969, p. 309. (Nous soulignons.)
[30] Si le rapport d’exploitation capitaliste se distingue des autres types de rapport d’exploitation en ce qu’il reproduit de manière essentiellement économique ses propres conditions de possibilité, à peu près tous les types de rapport d’exploitation non capitaliste doivent faire intervenir des contraintes extra-économiques pour assurer leur reproduction. Le monopole des armes (et de la violence légitime dans le cas des sociétés à État) est précisément ce qui, en dernière instance, assure aux groupes exploiteurs une certaine stabilité en cas de contestation radicale de l’ordre social.
[31] Delphy, L’ennemi principal, t. I, Syllepse, 2009, pp. 42-43, 45 et suiv.
[32] Chadeau et Fouquet, « Peut-on mesurer le travail domestique?», Économie et statistiques, 1981, pp. 32-34.
[33] Cf. Tabet, La construction sociale des inégalités de sexe. L’Harmattan, 1998, pp. 58-62. Aussi, cf. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux. Maspero, 1975, p. 119.
[34] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 3.2.
[35] Dans leur réponse, Astarian et Ferro utilisent le concept de CMS inférieure. Ou bien ils utilisent leur concept de CMS (où tou·te·s reçoivent par définition un sursalaire) et alors aucun dialogue n’est possible, parce qu’ils assument d’emblée ce que nous rejetons, à savoir que tous ses membres sont sursalariés. Ou bien ils traduisent dans leur terminologie à eux notre concept de « couches subordonnées de la classe moyenne », couches caractérisées par l’absence de sursalaire et donc, par l’exploitation de ses membres. Nous supposons qu’ils optent pour la seconde option.
[36] Ibid.
[37] Cf. supra « La crise et le patrimoine de la classe moyenne ».
[38] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 3.3.
[39] Cf. Temps Libre, n. 2, p. 195.
[40] Ces services ne sont pas « gratuits » au sens où ils sont financés par la population et donc, payés indirectement. Mais ils le sont au sens où il n’y a pas de rapport strict entre la contribution à titre privé et l’utilisation qu’un individu en fait.
[41] Ibid., pp. 194-195.
[42] Ibid., p. 191.
[43] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 3.3.
[44] Ibid.
[45] Ibid.
[46] Ibid.
[47] Marx, L’Idéologie allemande, Éd. Sociales, 1968, p. 61.
[48] Federici, Caliban et la sorcière, Entremonde et Senonevero, 2014, pp. 150-151.
[49] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 3.3.
[50] Astarian et Ferro. Réponse à « Temps Libre ». section 3.3.
[51] Dorlin, Sexe, genre et Sexualité, Presses universitaires de France, 2008, p. 49. « Réalisée sur 500 hommes génitalement « normaux » – c’est-à-dire déclarés mâles à la naissance et vivant pleinement comme des hommes – ayant effectué un passage à l’hôpital entre novembre 1993 et septembre 1994 pour un traitement bénin à l’urètre ou pour un cancer superficiel de la vessie n’ayant pas nécessité une intervention chirurgicale, l’enquête montre que 275 d’entre eux, soit 55 % des hommes pouvaient être labellisés « normaux » selon les critères médicaux de normalité péniennes appliqués aux enfants intersexes. Le reste, soit 45 % des hommes, témoignaient de différentes caractéristiques anatomiques ou physiologiques pouvant signifier, dans le cadre des critères appliqués aux enfants intersexes, une identité sexuelle ambiguë. »
[52] Pour un traitement réellement étayé de cette question, se référer aux travaux d’Elsa Dorlin et, plus particulièrement, au chapitre « L’historicité du sexe » de Sexe, genre et Sexualité.
[53] Notons qu’en ce qui concerne les grandes étapes du passage du cours quotidien de la lutte des classes à la communisation proprement dite, nous nous accordons grosso modo Astarian et Ferro. Une fois posées les bases d’une théorie de la révolution, il est évident que leur contribution relative à l’insurrection, malgré quelques problèmes, constitue un jalon d’importance pour la théorie communiste. En effet, la révolution présuppose sans conteste un climat de crise aiguë, comme il semble raisonnable d’affirmer que l’éclatement d’un cycle de luttes quotidiennes ne peut pas mener illico presto à la communisation. Cela doit être dit.
[54] Astarian et Ferro, Le ménage à trois, pp. 369-372.
[55] Ibid., p. 370.
[56] Astarian. op. cit. p. 272
[57] Cf. Astarian et Ferro, op. cit., pp. 393-395.
[58] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 2.
[59] Ibid.
[60] Ibid.
[61] Cf. Astarian, op. cit., p. 256.
[62] Astarian et Ferro, Le Ménage à trois, p. 320. « La difficulté théorique est ici qu’il n’y a pas de précédent historique à un tel soulèvement (c’est-à-dire à une insurrection grâce à laquelle la communisation devient possible, nda). Les dernières insurrections prolétariennes ont eu lieu sur la base d’une structure très différente du rapport entre prolétariat et capital. La révolution allemande de 1918-21 ou l’insurrection de Barcelone en 1936 ne nous donnent que très peu d’indications sur ce que serait une insurrection à notre époque. » Or, c’est précisément à ce type d’insurrection que nous faisions référence dans notre critique comme étant un « scénario imaginé » par Astarian et non pas aux insurrections historiques.
[63] Ibid., p. 318.
[64] Comme le montrent Astarian et Ferro, le capital peut être contraint d’opter pour une « formule de la plus-value » différente, à savoir celle de la plus-value absolue. Mais cette formule n’est qu’un palliatif de courte durée, parce qu’en diminuant la taille du panier de subsistance du prolétariat à travers la réduction des salaires, le capital réduit par là même sa capacité à réaliser la plus-value qu’il a soutirée de cette façon. C’est pourquoi, sur le long terme, la formule de la plus-value relative – qui consiste à augmenter la productivité de manière à faire baisser la valeur des marchandises entrant dans la consommation du prolétariat et donc, la valeur de sa force de travail – apparaît plus appropriée à une relance véritable de l’accumulation.
Astarian, Ferro et critiques improductives : Sur quelques objections lancées à Temps Libre n. 2 (Première partie)
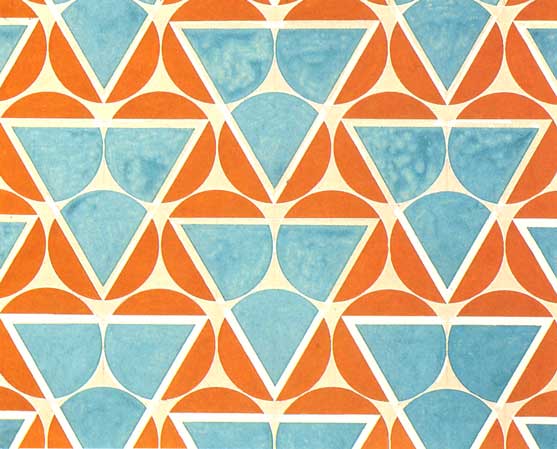
Première partie
Paru à l’hiver 2021, le second numéro de la revue Temps Libre consacrait une sous-section à la critique de la théorie des classes développée par Astarian et Ferro. Dans une réponse assez substantielle publiée en septembre de la même année, les deux auteurs combinent une défense de leur propre théorie avec des critiques de l’ensemble de notre revue. Bien qu’ils nous reconnaissent le « mérite d’avoir approfondi l’analyse des différentes activités qu’exerce la classe moyenne salariés (sic) pour justifier son sursalaire 1» – ce qui constitue en soi une critique importante du concept d’encadrement sur lequel se construit toute leur théorie de la classe moyenne –, ils s’efforcent de montrer l’inintérêt de notre contribution. Si certaines de leurs remarques commandent des précisions fécondes, une bonne partie d’entre elles repose sur une lecture tronquée qui nous forcera, malheureusement pour le lectorat attentif, à répéter parfois presque tel quel des arguments déjà présents dans notre revue.
Par ailleurs, il est important de comprendre que les deux auteurs rejettent l’ensemble de notre théorie du travail productif en tant qu’elle fait abstraction de celle exposée par Astarian dans son livre L’Abolition de la valeur paru en 2017. Au lieu d’argumenter frontalement avec notre théorie, ils se contentent de pointer des problèmes généraux relatifs à la question du travail productif en indiquant que les réponses se trouvent dans le livre d’Astarian; condamnant ainsi a priori toutes les théories ne l’ayant pas sagement recopié. Précisons d’emblée une chose : si nous avons consacré une partie de notre dernier numéro à la critique du concept de classe moyenne salariée que développent Astarian et Ferro, c’est parce qu’il représente à nos yeux une contribution véritablement nouvelle et fertile, à même de faire progresser la théorie communiste des classes. Or, c’est en vertu du même raisonnement que nous avons fait le choix de ne pas aborder la contribution d’Astarian au problème du travail productif. Nous considérons en effet impertinent de discuter des contributions desquelles nous jugeons n’avoir rien à retirer. Celle d’Astarian se range dans cette catégorie. Une telle décision était d’autant plus justifiée que la notion de travail productif joue un rôle absolument insignifiant au sein de leur théorie des classes, pour ne pas dire nul. Mais comme nos critiques jugent principalement de la justesse de notre théorie du travail productif à l’aune de l’attention portée à la leur, nous nous efforcerons d’aborder cette dernière de manière exhaustive. Si procéder ainsi nous force à étendre le terrain du débat et rend impossible une réponse succincte, cela nous offre néanmoins l’opportunité d’aller au fond des choses et de préciser les désaccords qui séparent nos positions respectives.
Notre réponse se décomposera donc en deux parties relativement autonomes. Dans la première (section 1), nous répondrons de manière détaillée aux reproches d’Astarian et de Ferro concernant notre concept de travail productif, ce qui ne pourra manquer d’apparaître à plus d’un·e comme un débat quelque peu scolastique. Pourtant, cette réponse n’en est pas moins importante en ce qu’elle constitue, à notre connaissance, la première critique approfondie de la contribution d’Astarian qu’on retrouve dans L’Abolition de la valeur et qui est présentée comme le nec plus ultra de la théorie de la valeur du courant de la communisation. La critique de son concept de travail productif nous mènera naturellement à mettre en évidence les graves problèmes qui plombent à la fois sa théorie de la valeur et celle du travail productif. Cette partie démontrera une fois de plus la nécessité de lier le concept de prolétariat à un concept de travail productif rigoureux. Dans la seconde, nous répondrons aux objections dont l’objet excède le thème du travail productif. Il sera entre autres question du problème de la classe moyenne, de l’exploitation, du genre (section 2) ainsi que de théorie de la révolution, notamment dans ses rapports à l’insurrection (section 3).
1. Travail productif, plus-value et prolétariat
Le problème du travail productif chez Temps Libre
Selon Astarian et Ferro, utiliser comme nous le faisons le critère du travail productif pour définir le prolétariat « pose plus de problèmes qu’il n’en résout », et ce, d’autant plus que nous n’aurions aucune définition « claire » et « probante » du travail productif. Nous tenterons donc, d’abord, de faire la lumière sur les supposés problèmes détectés par Astarian et Ferro pour ensuite nous concentrer sur la « solution » d’Astarian au problème du travail productif.
La première erreur que signalent nos critiques reposerait sur le fait qu’à l’instar de « la plupart des marxistes », nous affirmons que travail productif de plus-value = travail rapportant un profit au capitaliste. Si par là Astarian et Ferro veulent simplement dire que, pour nous, le travail productif de plus-value rapporte un profit au capitaliste qui l’emploie, alors nous n’y voyons aucun problème. Mais il est tout bonnement ridicule d’affirmer que selon nous « travail productif de plus-value » et « travail rapportant un profit au capitaliste » sont une seule et même chose, alors que nous montrons clairement que certains travaux rapportent un profit au capital qui l’emploie tout en ne produisant ni plus-value, ni valeur, c’est-à-dire que nous montrons qu’il existe un mode d’appropriation du profit spécifique au capital commercial, et qu’il s’oppose à celui du capital productif2. En fait, nous montrons précisément que, dans l’hypothèse où un capital commercial n’effectue que des fonctions commerciales (achats et ventes), celui-ci est improductif tout en touchant le taux de profit moyen. Et pourquoi? Parce qu’il réalise la plus-value contenue au sein du capital-marchandise du capital productif : en achetant le capital-marchandise de ce dernier et par là, en accélérant la rotation de son capital, le capital commercial permet au capital productif de fonctionner à nouveau comme tel et c’est ce « service » (qu’il rend par l’intermédiaire de ses salarié·e·s) qui lui permet de toucher le profit moyen3. Et s’il arrive que du capital commercial soit productif, c’est uniquement dans la mesure où il prend en charge certaines tâches nécessaires à la présence physique des marchandises sur le marché (transport, étalage, entreposage, etc.)4. Ainsi, le travail des employés de commerce rapporte un profit au capital commercial tout en étant absolument improductif, non producteur de plus-value. En ce sens, dire que, pour nous, « le travail improductif est seulement celui fait dans les administrations, les services publics, etc. » témoigne, au mieux, d’un esprit de polémique un peu trop téméraire et, au pire, de problèmes de lecture assez inquiétants5. Pourtant, Astarian et Ferro affirment sans gêne que nous ne distinguons pas bien les capitaux productifs des capitaux improductifs, alors que nous délimitons avec précision la sphère dans laquelle le capital existe comme capital productif de celle où il ne peut se valoriser davantage.
Se pourrait-il que le vrai problème consiste à travailler avec une définition « tautologique »» du travail productif, comme nous le reprochent précisément nos critiques? Selon Astarian et Ferro, il ne suffit pas de dire que le travail productif est acheté contre du capital pour prouver qu’il est productif, « ce qu’il faut, c’est distinguer entre dépense sous forme d’investissement productif et dépense de revenu notamment sous forme de capital improductif », pour ainsi montrer qu’il est réellement acheté contre du capital productif. Selon nos objecteurs, seul est productif le capital dont les produits sont, sous l’angle de leur valeur d’utilité, des facteurs du capital – que ce soit sous forme de moyens de production ou de moyens de subsistance40. Tout capital produisant des marchandises qui ne peuvent être directement réintégrées dans un procès de production capitaliste est donc improductif. Les exemples que donne Astarian indiquent qu’il s’agit principalement de l’industrie du luxe et de l’armement, mais nous verrons plus loin que les critères qu’il propose élargissent la sphère improductive bien au-delà de ces deux branches. Ainsi, notre définition du travail productif serait tautologique, sans substance, dans la mesure où nous aurions déterminé que tel ou tel travail est productif en fonction du fait qu’il est acheté par du capital supposé productif. Or, c’est précisément à l’inverse que nous procédons : nous ne déterminons qu’un capital est productif qu’une fois que l’on sait qu’il extrait effectivement du surtravail sous forme de plus-value, c’est-à-dire qu’il emploie du travail productif. Nous partons du constat qu’il existe d’innombrables entreprises qui emploient du travail salarié et qui touchent par ailleurs quelque chose qui se rapproche du taux de profit moyen. La question est donc de savoir comment elles y parviennent. Réponse : soit par la production d’une masse de marchandises dont la vente rapporte plus qu’elle n’a coûté (production de plus-value), soit par la diminution du temps de rotation du capital des producteurs (appropriation de plus-value). La première manière correspond au capital productif et la seconde au capital marchand (capital commercial et capital bancaire), c’est-à-dire au capital improductif. Ici comme ailleurs, c’est le travail productif qui explique le capital productif et non l’inverse.
Dans le quatrième chapitre de L’Abolition de valeur, Astarian critique dans les mêmes termes les exemples qu’utilise Marx pour illustrer ce qui confère à un travail un caractère productif :
L’exemple est celui du maître d’école qui est productif « parce qu’il rapporte des pièces de cent sous à son patron ». L’école en question est une entreprise comme une autre et n’existe que parce qu’elle rapporte un profit. Mais dire que le travail de l’instituteur est productif, c’est préjuger que l’enseignement fait partie du secteur productif.6
Dans l’exemple de Marx, cet instituteur s’oppose d’abord aux instituteurs « indépendants » en sa qualité de salarié. Celui-ci, en effet, est employé par un patron. Comme les autres, il produit une marchandise qui est un service : l’éducation. Mais à la différence de ceux-ci, l’instituteur-salarié ne vend pas son service à un acheteur : il vend sa force de travail à un patron qui, lui, vend une marchandise qu’il n’a pas lui-même créée. Mais comme aucun patron n’engage qui que ce soit pour le plaisir, c’est qu’il doit par là, d’une manière ou d’une autre, parvenir à empocher davantage que s’il vendait lui-même ses services. Or, comme l’instituteur-salarié produit une marchandise pour le compte de son patron et que celui-ci s’enrichit en vendant celle-ci et en empochant la différence, alors il s’agit d’un travail productif. Et ce, non pas parce que l’instituteur travaille pour un capital supposé productif mais 1. parce qu’il produit une marchandise 2. parce qu’elle matérialise une valeur supérieure à celle correspondant à son salaire effectif et 3. parce que, pour ces deux raisons, il accroît la masse de plus-value, c’est-à-dire qu’il valorise le capital global à travers la valorisation du capital de son propre patron. En fait, Marx ne préjuge d’aucune manière que l’enseignement fait partie du secteur productif, au contraire, il démontre que celui-ci fait partie de ce secteur en tant qu’il produit ce à quoi réfère le qualificatif « productif » dans le concept de « travail productif » : c’est-à-dire de la plus-value.
On a donc vu que ni notre définition du travail productif ni celle de Marx exemplifiée ici ne sont tautologiques et qu’en ce sens, les problèmes qui fondent le refus d’Astarian et Ferro de les réutiliser ne sont pas réels. En effet, ils n’imaginent pas qu’il existe d’autres moyens de déterminer qu’un travail est productif que celui consistant à se demander s’il est commandé par du capital productif. Or, puisque par hypothèse le capital productif est producteur de plus-value et partant, de profit, ils concluent qu’il s’agit d’un procédé circulaire. Et ils ont raison. Le seul hic, c’est que ce n’est pas ainsi que nous (Marx y compris) procédons. Venons-en maintenant à l’examen plus détaillé de la proposition d’Astarian relative au travail productif.
La solution d’Astarian au problème du travail productif
Astarian ramène le problème du travail productif à celui consistant à distinguer, parmi les agents employés par les différents capitaux (que l’on peut traduire par « entreprises touchant le taux de profit moyen ») ceux qui sont productifs de ceux qui ne le sont pas. Pour déterminer qu’un travail est productif, il se demande s’il est commandé par du capital (capital productif) ou par du revenu, qu’il identifie au capital improductif. Ainsi, la véritable tâche consiste pour lui à montrer quels capitaux sont productifs et lesquels ne le sont pas, c’est-à-dire qu’il rejette comme une fausse piste celle consistant à déterminer au sein de quels capitaux est produite de la plus-value. En effet, pour cela, il faudrait déjà savoir qu’un travail est productif alors qu’il n’entrevoit pas que cela soit possible autrement qu’en montrant qu’il est employé par du capital productif. Il devra donc chercher à distinguer le capital productif du capital improductif ou dit autrement, le secteur productif de l’improductif. À ce titre, Astarian trouve dans la notion de « valeurs d’usage qui deviennent ou non des facteurs du capital » une « piste intéressante 7». Suivant cette piste, il cite un passage du chapitre inédit dans lequel Marx fait une distinction entre les marchandises que les capitalistes achètent pour leur consommation privée et celles qui deviennent des facteurs du capital8. Il reprend donc la formule de Marx pour indiquer que le caractère productif ou non d’un travail pourrait résider dans l’usage fait des marchandises après leur vente (et non seulement l’usage après vente de la marchandise-force de travail). Astarian reconnaît lui-même que Marx « nous entraîne sur une fausse piste » lorsqu’il nous parle de l’usage des marchandises après la vente, parce que cela conduit « à des discussions sans fin sur ce qui se passe après la fabrication du produit 9», mais il s’enlise tout de même tête baissée sur cette voie en indiquant que la confusion de Marx donne un indice intéressant (qui était il y a quelques lignes une fausse piste) en mettant l’accent « sur la production de subsistances et de moyens de production ».10
En suivant cette « piste », Astarian précise ce qu’il entend par « facteurs du capital » et met ce concept en lien avec sa théorie de la valeur : « Produire des conditions de travail pour les autres procès de travail (ce que Marx appelle des facteurs du capital), telle est donc la première condition de la production de valeur. Si cette condition n’est pas remplie, ce n’est même pas la peine de se demander s’il y a production de plus-value. 11» En ce sens, les théories du travail productif qui diffèrent de celle d’Astarian ne se tromperaient pas uniquement parce qu’elles cibleraient mal quel travail produit de la plus-value, mais plus fondamentalement parce qu’elles ne saisiraient pas quel travail produit de la valeur. Toujours selon Astarian, toute marchandise qui n’est pas destinée à être utilisée comme capital constant ou comme moyen de subsistance du prolétariat est par le fait mêmeexclue de la sphère de la valeur et donc, ne peut jamais être le fruit du travail productif. Comme on le verra plus loin, l’auto sport, la bouteille de champagne et l’équipement de plein air dernier cri sont des marchandises sans valeur qui ne peuvent pas être le fruit d’un travail productif même si ce travail produit une marchandise qui contient du surtravail et dont la vente génère un profit pour l’entreprise qui l’emploie.
Le Mystère de la Péréquation du Taux de Profit sous les traits du capital improductif producteur de marchandises
Remettons à plus tard le plaisir d’évaluer la théorie de la valeur d’Astarian et examinons d’abord les conséquences auxquelles nous mène sa théorie du travail productif fondée sur la valeur d’usage des marchandises. Il y a ainsi, pour Astarian, des entreprises productrices de marchandises qui emploient des salarié·e·s – pour un salaire et des conditions de travail plus ou moins identiques –, mais qui, de par la nature des marchandises qu’elles produisent, appartiennent à des secteurs différents : le secteur productif et le secteur improductif. Ces entreprises, nous dit Astarian, sont des capitaux qui ont une composition elle aussi plus ou moins identique, étant donné que du point de vue de leur production, elles se décomposent toutes en c + v + pl. De plus, celles-ci touchent toutes, en situation d’équilibre, le taux de profit moyen. La seule différence, c’est qu’une partie produit effectivement la plus-value qu’elle s’approprie alors que l’autre la ponctionne du pool social de la plus-value que crée la première13. Avant même de tester les critères que nous fournit Astarian pour déterminer quelle entreprise est productive ou non, la question surgit de savoir pourquoi les entreprises improductives produisant des marchandises doivent être considérées comme des capitaux. En effet, d’un côté, à l’instar du capital commercial ou du capital bancaire, ces dernières diffèrent du capital productif – qui représente l’idéal type du capital individuel dont Marx décrit le mouvement dans le premier livre du Capital – en ce qu’elles ne créent pas elles-mêmes la plus-value sur laquelle repose en dernière instance la possibilité pour elles de faire du profit. De l’autre, ces entreprises ne correspondent pas non plus au type d’entreprises/sociétés qui appartiennent au capital marchand. Théoriquement, il ne va donc pas de soi que celles-ci soient effectivement des capitaux. En seraient-elles parce qu’elles emploient des salarié·e·s? L’État emploie des salarié·e·s et n’est pas un capital pour autant, on ne saurait donc y voir là un critère pertinent. Serait-ce parce qu’elles touchent elles aussi le taux de profit moyen? Admettons ici qu’il s’agit d’une bonne raison et que cela nous permet effectivement de les distinguer des autres entités économiques. Mais ce qu’il faut maintenant savoir, c’est pourquoi celles-ci touchent le taux de profit moyen. Pour ce qui est du capital productif, on comprend assez bien en vertu de quoi celui-ci y touche : il produit réellement de la plus-value. Pour ce qui est du capital commercial et du capital bancaire, on peut penser qu’ils y parviennent en accomplissant des fonctions économiques indispensables – ou à tout le moins utiles – du point de vue de l’accumulation du capital et qui se ramènent schématiquement à réduire le temps de rotation du capital. Plus précisément, le capital commercial permet au capital productif d’écouler son capital-marchandise plus rapidement, tandis que le capital bancaire avance, grâce au crédit, les liquidités nécessaires au capital productif pour que celui-ci n’ait jamais à interrompre sa production et pour qu’il puisse acheter sans attendre d’avoir vendu. Bien qu’ils ne concourent pas directement à la production de plus-value, on comprend qu’ils ne sont pas, économiquement parlant, de purs fardeaux, puisqu’ils contribuent directement à élargir l’échelle de la production. Mais que dire des entreprises productrices de marchandises qui sont par ailleurs improductives?
En effet, pourquoi ces entreprises touchent-elles le taux de profit moyen, alors même qu’elles ne produisent pas une once de plus-value et qu’elles ne dispensent au capital productif aucune des tâches propres à la circulation, bref alors qu’elles sont un pur frein à l’accumulation? Serait-ce parce qu’elles fournissent à la classe capitaliste les armes et les bijoux dont elle a besoin (ce qui serait déjà une raison plus que douteuse)? Mais si c’était bien pour cette raison, pourquoi dans ce cas le joaillier indépendant ne toucherait-il pas lui aussi le taux de profit moyen et ne serait pas lui aussi un capitaliste? Pourquoi la production artisanale d’objet de luxe n’est pas considérée comme capitaliste, alors que celle d’une multinationale comme Gucci l’est, si dans les deux cas, Astarian n’y voit ni production de plus-value, ni même de valeur. Pourquoi Gucci parvient-elle à se faire transférer une partie de la valeur produite dans le secteur productif et l’artisan non? Ici, Astarian incante la fameuse péréquation du taux de profit sans juger opportun d’expliquer le mécanisme par lequel des capitaux productifs en viendraient à transférer une part de leurs profits aux capitalistes improductifs. Nous sommes bien d’accord pour dire que les entreprises profitables qu’Astarian inclut dans le capital improductif sont des entreprises capitalistes, mais identifier le profit de ces entreprises n’explique en rien leur caractère capitaliste. Le raisonnement d’Astarian est donc purement circulaire : il présuppose qu’il parle de capitaux parce que les entreprises du secteur improductif touchent le taux de profit moyen et, comme il est admis que ce sont des capitaux, elles doivent forcément bénéficier elles aussi de la péréquation du taux de profit… Inutile de s’interroger plus longuement, les voies de la Péréquation du Taux de Profit sont impénétrables.
Astarian nous dit au surplus que « le secteur improductif consomme de la plus-value. Il n’en produit pas. 16» Cela s’entend : il s’agit de la définition communément admise du secteur improductif. Pourtant, si l’on accepte sa définition du secteur improductif, comment expliquer que les entreprises produisant des marchandises de luxe ou encore de l’armement pour les États consomment de la plus-value au lieu d’en produire? Concrètement, ces entreprises utilisent un capital afin d’acheter des moyens de production et des forces de travail; elles font produire des marchandises dont la vente rapporte un excédent par rapport à l’investissement initial, mais dans tout ce procès, pour Astarian, il n’y a ni production de valeur, ni plus-value et, comme si ce n’était pas assez, le profit réalisé par l’entreprise vient manger la plus-value produite par le capital productif. On fait donc face à l’alternative suivante : ou bien on fait comme Astarian et Ferro et on explique par le Mystère de la Péréquation du Taux de Profit le fait que les entreprises improductives produisant des marchandises touchent le taux de profit moyen tout en consommant la plus-value du secteur productif. Ou bien on admet, sur la base d’une analyse des rapports de production qui informent le procès de travail de ces entreprises, que c’est parce qu’elles sont productrices de plus-value que ces entreprises sont des capitaux et qu’elles touchent le taux de profit moyen. Ainsi, selon notre théorie et toutes celles permettant de rendre les phénomènes économiques minimalement intelligibles, la réponse est claire : si Gucci est une entreprise capitaliste et qu’elle empoche un profit, c’est parce qu’elle emploie des travailleurs et des travailleuses qui produisent une somme de marchandises dans laquelle ils et elles ont ajouté une quantité de valeur qui excède celle de leur rémunération.
Valeur d’usage des marchandises et retour à la sphère productive
Jusqu’ici, nous avons vu qu’Astarian et Ferro sont incapables d’expliquer pourquoi les entreprises productrices de marchandises du secteur improductif sont des capitaux. Nous avons montré que l’explication la plus rationnelle du caractère capitaliste de ces entreprises devait se fonder sur l’analyse du procès de production. En empruntant ce chemin, on constate alors qu’il n’y a aucune raison de penser que ces entreprises ne sont pas productives, étant donné qu’elles produisent effectivement un surproduit et que celui-ci prend, dans les conditions de la production capitaliste, la forme de la plus-value. Mais pour le besoin de la cause, faisons abstraction de tous ces résultats et considérons à part le critère que nous fournit Astarian pour déterminer à quel secteur appartient telle ou telle entreprise. Assumons qu’il existe une telle chose qu’une entreprise produisant des marchandises dans des conditions capitalistes de production (employant des salarié·e·s, empochant un profit et dont le mobile principal est justement la recherche du profit maximum) qui soit tout de même nécessairement improductive. Pour Astarian, le secteur productif est tel parce qu’il produit des marchandises qui, sous l’angle de leur valeur d’utilité, sont des facteurs du capital, c’est-à-dire des moyens de production ou des moyens de subsistance du prolétariat. Les marchandises qui en sont issues sont matériellement adaptées à la reproduction des multiples procès de travail et peuvent donc être consommées productivement. Pour les marchandises destinées à fonctionner comme moyens de production, on parle par exemple de combustibles, de matières premières, de machines, d’outils, de bâtiments, etc. Pour celles destinées à fonctionner comme moyens de subsistance, il s’agit de tout ce qui entre dans la consommation de la force de travail employée par des capitaux : nourriture, moyens de transport, logements, vêtements, etc. Le secteur improductif produit quant à lui des marchandises qui sont inutilisables pour la reproduction du procès de travail. En principe, tout va bien. Mais Astarian flaire rapidement les difficultés infinies qui accompagnent le fait de soutenir que les marchandises produites par le secteur productif doivent effectivement être consommées productivement pour pouvoir confirmer que ceux et celles qui les ont produites ont effectué un travail productif. C’est pourquoi il ne dira plus comme avant que, pour être productif, un travail doit produire une marchandise qui soit bel et bien réintégrée dans la sphère de la production comme facteur du capital17, mais uniquement que la valeur d’utilité de la marchandise doit permettre ce retour18. Ici, Astarian tente de prévenir ce à quoi conduit malgré lui sa théorie, à savoir la recherche de ce qui se passe pour chaque marchandise individuelle après la vente. Mais comme le fera apparaître l’examen de certains problèmes, il ne peut pas non plus se désintéresser entièrement de ce qui suit la vente sans rendre caduque sa tentative de définir le travail productif par la valeur d’usage des marchandises qu’il produit.
Prenons un premier problème. Plusieurs marchandises qui ne retournent presque jamais dans la sphère productive – et qui ne sont donc pas considérées par Astarian comme des « moyens de subsistance destinée à la force de travail » – ont tout de même une valeur d’utilité permettant ce retour19. Les champignons sauvages sont rarement achetés par des prolétaires au supermarché, mais ils deviennent néanmoins des facteurs du capital lorsqu’ils sont achetés et transformés par un restaurant gastronomique, puisqu’ils fonctionnent alors comme matières premières, donc comme moyens de production. Une arme à feu sort du secteur productif lorsqu’elle est achetée par l’armée, mais elle devient un facteur du capital lorsqu’elle est achetée par le champ de tir récréatif ou encore lorsqu’elle entre directement – comme elle le fait massivement dans les régions rurales des États-Unis – dans la consommation des sans-réserves20. Pareillement, le mobilier de luxe n’entre pas dans les subsistances du prolétariat, mais il réintègre tout de même la sphère productive lorsqu’il est acheté en gros par des chaînes d’hôtellerie et qu’il devient un moyen de production pour cette industrie. Dans ces trois cas, nous avons des marchandises qui peuvent parfaitement être réintégrées au procès de production, bien que ce retour ne s’effectue pas dans la majorité des cas. Prenons un autre exemple. La consommation du prolétariat, entendu ici comme les sans-réserves employés par le capital (l’un des multiples sens utilisés par Astarian), est très souvent identique à celle des employé·e·s les plus faiblement rémunéré·e·s des services publics et au moins en partie semblable à celle de ses patrons. Les mêmes souliers, les mêmes voitures, les mêmes objets culturels, les mêmes cigarettes, les mêmes vêtements, tout cela entre indifféremment dans le panier de subsistance du flic, de la postière et du mécano. Par conséquent, même si les pâtes alimentaires peuvent devenir des facteurs du capital à travers la consommation du prolétariat, cette possibilité ne supprime en rien le fait que, bien souvent, elles ne le deviennent pas, parce qu’elles sont consommées improductivement par les autres classes sociales. Si donc Astarian souhaite, en définissant le travail productif par son devenir matériel, discriminer les travaux dont les produits sont utiles à la reproduction matérielle du capital de ceux qui ne le sont pas, il ne peut pas se contenter de dire qu’une marchandise peut être consommée productivement pour conclure que sa production est productive. En effet, dans la réalité, cette possibilité est sans cesse contredite par le fait que de telles marchandises sont consommées par d’autres classes, et ce, sur une large échelle. De la même manière, une grande masse de marchandises qui semblent à Astarian ne pas pouvoir être consommées productivement le sont pourtant. Tout ceci illustre clairement qu’un tel critère est tout à fait inutilisable, parce qu’incapable de discriminer concrètement les types de travaux d’après leur caractère productif ou improductif.
Le critère d’Astarian le conduit donc à deux options peu souhaitables. 1) Ou bien il considère suffisant que la valeur d’utilité d’une marchandise lui permette de fonctionner comme facteur du capital pour que le travail qui la produit soit productif. Or nous venons tout juste de voir que cela contredit l’objectif qu’il s’était lui-même donné en formulant son critère. 2) Ou bien Astarian le prend au sérieux et le suit à la lettre, en tentant de lier le caractère productif d’un travail au sort subi par chaque marchandise après sa vente. Ainsi, le travail effectué dans une usine de pâtes alimentaires serait productif lorsque celles-ci seraient consommées par des prolétaires, improductif lorsqu’elles le seraient par un cadre ou par le personnel d’une école primaire. Mais que faire lorsque le capital-marchandise d’une entreprise n’est consommé qu’au 4/10 par des prolétaires? Disons au 3/10, au 2/10, au 1/10, au 6/10? Cela doit logiquement affecter le caractère productif d’un travail – puisque c’est ce qui lui confère son caractère –, mais comment sera-t-il affecté? Est-ce que ce sont les salarié·e·s qui seront individuellement plus ou moins productif·ve·s? Ou encore y aura-t-il une partie seulement des agents employés par l’entreprise qui seront productifs, proportionnellement à la masse du capital-marchandise consommée par des prolétaires? Heureusement pour sa santé mentale, Astarian renonce à retracer, pour chaque marchandise, la chaîne inextricable d’achats et de ventes qui la sépare de son lieu de production à celui de sa consommation productive (ou improductive). Mais par le fait même, il renonce à pouvoir affirmer que telle entreprise permet effectivement la reproduction matérielle du capital. Et ce renoncement s’explique : il est tout bonnement impossible de montrer que seuls les sans-réserves employés par le capital consomment tel ou tel produit; cela, pour la simple et bonne raison qu’ils ne sont pas les seuls à être payés au prix de la reproduction de leur force de travail21. Pour une définition « claire » et « probante » du travail productif, on repassera.
Rapport entre travail productif et plus-value chez Astarian.
Comme nous l’avons montré dans notre dernier numéro22, c’est précisément là où Marx s’est le plus dégagé d’une approche du travail productif fondée sur la détermination strictement matérielle du travail (sur la nature du produit et sa détermination comme « travail concret ») qu’il a pu offrir les solutions les plus satisfaisantes au problème du travail productif. C’est uniquement lorsqu’il abandonne la dimension la plus immédiatement concrète du travail productif (le fait de participer à produire une masse de marchandises) et qu’il se concentre sur sa dimension sociale (le fait de produire de la plus-value en étant exploité·e et donc, de reproduire directement les rapports de production capitalistes sur lesquels repose toute la structure sociale) qu’il parvient réellement à dépasser les théories du travail productif précédentes, telle que celle de Smith, pour qui le directeur, le surveillant et l’ingénieur sont tout aussi productifs que l’ouvrier23. Il montre que ce qui est réellement important, dans le travail productif capitaliste, c’est sa « forme sociale déterminée 24», car c’est cela qui permet au capital, comme valeur s’autovalorisant, de continuer d’exister comme tel. Il ne cesse de rejeter comme « vulgaires », voire « fétichistes » les tentatives de fonder la distinction entre travail productif et improductif sur la valeur d’usage des marchandises qu’il produit. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que la « contribution » d’Astarian au problème du travail productif se retrouve tout à fait en deçà de celle de Marx, voire des classiques. Nous nous excusons de reproduire une si longue citation, mais elle en vaut la peine, puisqu’elle exprime précisément ce que n’a pas compris Astarian :
Le résultat du procès de production capitaliste n’est ni un simple produit (valeur d’usage) ni une marchandise, c’est-à-dire une valeur d’usage qui a une valeur d’échange déterminée. Son résultat, son produit, c’est la création de la plus-value pour le capital et donc la transformation effective d’argent ou de marchandise en capital, ce qu’ils ne sont, avant le procès de production, qu’en intention, en soi, par destination. Dans le procès de production, il est absorbé plus de travail qu’il n’en est acheté, et cette absorption, cette appropriation de travail étranger non payé, qui s’accomplit dans le procès de production est le but immédiat du procès de production capitaliste; en effet, ce que le capital en tant que capital (donc le capitaliste en tant que capitaliste) veut produire, ce n’est pas immédiatement de la valeur d’usage pour l’autoconsommation, ni de la marchandise pour la transformer d’abord en argent et ensuite en valeur d’usage. Sa fin, c’est l’enrichissement, la valorisation de la valeur, son accroissement, donc la conservation de l’ancienne valeur et la création de plus-value. Et ce produit spécifique du procès de production capitaliste, il ne l’atteint que dans l’échange avec le travail qui, pour cette raison, s’appelle travail productif.
Pour produire une marchandise, le travail doit être du travail utile, produire une valeur d’usage. Et par conséquent, seul le travail qui se présente dans une marchandise, donc dans des valeurs d’usage, est un travail contre lequel s’échange le capital. C’est là une prémisse qui va de soi. Mais ce n’est pas ce caractère concret du travail, sa valeur d’usage en tant que telle – c’est-à-dire le fait qu’il soit, par exemple, travail de tailleur, travail de cordonnier, filage, tissage, etc. –, qui constitue, pour le capital, sa valeur d’usage spécifique, et donc qui le caractérise comme travail productif dans le système de la production capitaliste. Ce qui fait sa valeur d’usage spécifique pour le capital, ce n’est pas son caractère utile déterminé pas plus que les propriétés utiles particulières du produit dans lequel il se matérialise, mais c’est son caractère d’élément créateur de la valeur d’échange, de travail abstrait; plus précisément, ce n’est pas parce qu’il représente, en tout état de cause, un quantum déterminé de ce travail général, mais parce qu’il en représente un quantum plus grand que celui qui est contenu dans son prix, c’est-à-dire dans la valeur de la puissance de travail. (Tous les italiques sont de Marx)
En affirmant que c’est la destination matérielle des marchandises qui fait d’elles un produit du travail productif, Astarian revient tout simplement à une problématique de type physiocrate. Comme les physiocrates, pour qui seul était productif le travail agricole – parce qu’il est le seul à pouvoir multiplier la matière et donc, à servir de base à tous les autres travaux26 –, Astarian considère que seul est productif le secteur qui produit matériellement « les conditions de travail pour les autres procès de travail 27». Pour Astarian comme pour Quesnay, le secteur du luxe est stérile (et ses employé·e·s improductif·ve·s), car il ne fournit pas à la production ce qu’il faut pour qu’elle puisse s’effectuer sur une échelle plus large. Confusion entre forme matérielle de la production et production de plus-value, voilà le lien intime qui unit ce couple improbable.
Bien sûr, on pourrait nous objecter que, loin de faire fi de la contribution de Marx à ce problème, Astarian la peaufine en rendant plus exigeant encore le critère du travail productif : il ne s’agirait pas seulement de produire de la plus-value, mais aussi de produire matériellement des facteurs du capital. Mais cela ne tient pas la route, parce qu’Astarian rend totalement dépendant le fait de produire de la plus-value au fait d’œuvrer dans le secteur productif (entendre : son secteur productif); la production de plus-value n’intervient que comme consécration de ce fait. Jamais il ne s’intéresse aux formes socialesde la production, parce que s’il le faisait, il serait contraint de reconnaître qu’il y a, au sein de l’industrie du luxe et des armes, appropriation d’un surproduit et donc, de surtravail. Et cela ne peut que lui être désagréable, puisqu’il doit conjuguer ce fait avec l’absence proclamée d’exploitation « au sens propre 28» dans ce secteur et donc, de production de plus-value. Il est conséquemment aux prises avec un surproduit qui ne peut prendre aucune forme sociale connue jusqu’à ce jour – la plus-value étant évidemment exclue des formes possibles. Mais cela, c’est évidemment son problème à lui. Toujours est-il que la contribution d’Astarian ne fait aucune place sérieuse à la catégorie de plus-value. Or qu’est-ce qui faisait alors la nouveauté de la théorie de la plus-value chez Marx? 1) Il a, le premier, montré que la plus-value est formellement indépendante du profit et du revenu (intérêt et rente), 2) mais surtout, il a insisté sur l’indépendance du travail productif de plus-value par rapport à son contenu concret et à ses produits. Anticipant la « solution » d’Astarian, Marx nous disait :
Les travailleurs productifs eux-mêmes peuvent être vis-à-vis de moi des travailleurs improductifs. Par exemple, si je fais tapisser ma maison et que ces ouvriers soient (sic) les ouvriers salariés d’un master [patron] qui me vend cette prestation, c’est pour moi comme si j’avais acheté une maison déjà tapissée, comme si j’avais dépensé de l’argent pour une marchandise destinée à ma consommation ; mais pour le master qui fait tapisser ces ouvriers, ils sont des travailleurs productifs, car ils produisent pour lui une plus-value.29
Ce qu’il nous dit, en somme, c’est qu’il est indifférent au caractère productif d’un travail qu’il soit employé à produire des marchandises de luxe ou des valeurs d’usage appropriées au procès de travail, du moment qu’il crée un excédent de valeur pour celui qui l’emploie30. Cet excédent, voilà seul ce qui a de l’importance du point de vue de la reproduction du capital comme rapport social, voilà ce qui fait sa valeur d’usage spécifique pour le capital – lequel n’a cure de la forme concrète des marchandises par lesquelles il est médiatisé.
Sur la prétendue nécessité de distinguer le secteur dit productif de celui du luxe et de l’armement
À tout prendre, Astarian et Ferro ont-ils tort ou raison lorsqu’ils appellent à ce qu’on tienne compte des différences matérielles qui séparent le secteur productif du secteur dit « improductif » produisant des marchandises31? Ils ont certainement raison, dans la mesure où une société ne peut se permettre de produire uniquement des chocolats fins et des tanks si elle veut se maintenir davantage que quelques jours. À cet égard, il est clair qu’il doit exister une certaine proportion entre les différentes branches de la production matérielle, puisqu’une trop grande part du travail social consacrée, par exemple, aux produits destinés à la consommation de la classe moyenne sursalariée et de la classe capitaliste ne peut que grever la reproduction élargie du capital. Mais cela, de la même manière qu’une société ne doit pas produire trop de tel ou tel type de marchandise. Ce qui est sûr, c’est que ces différences matérielles ne peuvent avoir d’effet sur le caractère productif ou non d’un travail.
Pourtant, Astarian et Ferro insistent : oui, nous disent-ils, cela l’affecte. La preuve : voyez comment interagissent entre eux le secteur productif et improductif, voyez comment le type de produits qu’ils fabriquent correspond à des fractions de classes luttant les unes contre les autres pour le partage de la plus-value32! Mais qu’en est-il? Les capitaux occupés à produire des armes et des marchandises de luxe forment-ils des fractions distinctes? Si oui, il faut pouvoir montrer que ces fractions sont des forces sociales produisant des effets pertinents sur la structure sociale. Que le capital commercial représente une force sociale distincte du capital productif, qui le niera? Qu’à l’intérieur du secteur productif, l’industrie lourde s’oppose à l’industrie légère, cela aussi semble suffisamment confirmé par l’histoire. Il en revient à Astarian et Ferro de prouver, ou bien que les industries du luxe et de l’armement s’opposent au reste du secteur dit productif, ou bien qu’elles entretiennent un rapport aux fractions commerciale et bancaire significativement différent de celui qu’entretient avec elles le secteur productif. Évidemment, ils n’ont rien tenté de tel. L’auraient-ils tenté qu’ils se seraient heurtés à l’alliance historique constante de l’industrie lourde et de l’industrie militaire33, alliance (pour ne pas dire unité) sur laquelle se sont notoirement appuyés les fascismes en Allemagne et en Italie34. Comme l’ont montré de manière fort éloquente Sweezy et Baran, les dépenses militaires financées à même les fonds publics sont parmi les seules à être approuvées par toutes les fractions capitalistes35. Pourquoi? D’abord, parce que l’armée est un client idéal pour une partie importante de la classe capitaliste : les termes de contrats octroyés par l’État sont excessivement favorables aux vendeurs et leur font par conséquent toucher un taux de profit plus élevé. Mais surtout parce qu’étant donné la sous-utilisation chronique des capacités productives du capital au stade du capitalisme monopoliste, seules les dépenses militaires se sont révélées capables de mettre fin au chômage dévastateur qui plombait l’économie étatsunienne des années 3036. Ce qui veut dire que toute la classe capitaliste bénéficie, au moins indirectement, des commandes militaires, parce qu’elles contribuent à relever le taux de profit moyen37. Et enfin, que dire de l’opposition supposée entre l’industrie de luxe et le reste du secteur dit productif? Est-il arrivé à qui que ce soit de voir Honda et Ferrari, Jack Daniel’s et Lagavulin, Joe Fresh et Lacoste, le bâtisseur de logements à loyer modique et celui de logements de luxe s’opposer politiquement les uns aux autres, s’affronter sur des questions d’orientation économique générale ou même de détails? Nous avons très hâte d’entendre nos critiques là-dessus.
Digression sur la théorie de la valeur d’Astarian
La théorie de la valeur d’Astarian a indéniablement contribué à faire efficacement avancer le débat, en insistant sur les déterminations concrètes du travail abstrait, producteur de valeur, qu’il nomme « travail valorisant ». En effet, le travail abstrait n’est pas du tout « abstrait » au sens où il est concrètement déterminé par deux contraintes : la contrainte à la recherche d’une productivité maximale et la contrainte à la normalisation. Cela dit, sa théorie de la valeur – tout comme, nous l’avons vu, sa théorie de la plus-value – reste frappée d’un défaut important, à savoir qu’elle présuppose que la production de valeur est conditionnelle à la production d’un certain type seulement de marchandises : celles destinées à fonctionner comme facteurs du capital. Lorsque Marx dit « que le producteur doit légitimer sa place dans la division sociale du travail » et qu’il faut « que le travail ait été dépensé sous une forme utile », cela implique directement, pour Astarian, que « la première condition de légitimité d’un nouveau producteur c’est donc de produire un objet qui puisse servir soit de moyen de production pour un autre capital, soit de moyen de subsistance pour les prolétaires. » Pourquoi? Parce que « la production capitaliste est fondamentalement production de moyens de production et de subsistance. » Par conséquent, seul est « utile » – et peut donc légitimement s’appeler « capitaliste » – un travail qui produit les conditions de travail des autres procès de travail… Il s’agit là tout simplement d’un sophisme de bas étage. Ce n’est pas parce que la production capitaliste produit majoritairement des facteurs du capital qu’en produire est nécessaire pour parler de production capitaliste. Mais peut-être souhaite-t-il dire que la production capitaliste est fondamentalement « production pour la production »? Pourtant, lorsqu’on dit que la production capitaliste est une « production pour la production », on veut par là l’opposer à une « production pour la consommation », c’est-à-dire qu’on cherche à souligner que l’aiguillon de la production ne repose pas dans ce que le profit permet d’acheter en plus grande quantité, mais dans le profit lui-même. Or Astarian prend l’affirmation au sens littéral et nous dit (malgré lui peut-être) : ce qui meut toute la société capitaliste, c’est la recherche d’une plus grande production matérielle, c’est l’élargissement de la production pour elle-même, c’est la multiplication des procès de travail : « il faut que le capitaliste concerné propose au marché des marchandises qui puissent servir de moyens de production ou de subsistances pour les autres capitaux. » Pourtant, cette affirmation, prise à la lettre, est parfaitement fausse : les producteurs capitalistes n’ont cure de produire pour les autres producteurs capitalistes et n’ont d’ailleurs pas à le faire. Tout ce qu’ils doivent faire, pour fonctionner comme tels, c’est produire le maximum de plus-value et partant, de profits. Ce but, ils l’atteindront en produisant des madriers comme en produisant des fidget spinners.
Peut-être Astarian ne s’en rend-il pas compte lui-même, mais sa conception étriquée du travail valorisant (applicable uniquement à la production de facteurs du capital) lui cause de sérieux ennuis du moment qu’il doit expliquer l’échange de marchandises produites au sein de conditions capitalistes. En effet, il sera particulièrement difficile à Astarian d’expliquer comment et pourquoi des marchandises de luxe ou encore des armes qui n’ont, selon lui, aucune valeur, acquièrent un prix et s’échangent sur le même marché que les marchandises ayant de la valeur. Comme les premières ne peuvent fonctionner comme facteurs du capital39 – bien que nous ayons montré que cela n’est pas évident –, ces marchandises (des objets sans valeur sont-ils des marchandises au sens propre?) ne peuvent avoir été le fruit d’un travail valorisant. Aussi rien ne détermine-t-il donc le point d’équilibre à partir duquel l’offre et la demande font varier leur prix. Partant, comment peut-on alors expliquer de manière rationnelle la proportion dans laquelle elles s’échangent contre les autres marchandises? Serait-ce grâce au temps de travail (minimum) socialement nécessaire à leur production? Mais cela se rapproche dangereusement de la définition de la valeur d’une marchandise! Serait-ce parce qu’elles auraient un prix de production qui se décompose, à l’instar des autres marchandises, en coût de production + taux de profit moyen? Mais comment rendre compte du coût de production si ce n’est sur la base de la valeur des facteurs du capital (c + v) qui entrent dans la production d’une marchandise? Sans valeur, pas de coût de production, ni a fortiori de prix de production. Ou bien on rejette tout lien entre la théorie de la valeur et la détermination du prix des marchandises, ou bien on renonce à une conception étriquée du travail produisant de la valeur.
Les figures multiples du prolétariat d’Astarian et de Ferro
Dans leur réponse à notre critique, Astarian et Ferro tentent vainement d’esquiver l’objection selon laquelle leur définition du prolétariat est entièrement déterminée par un degré de rémunération. Rappelons que pour nos auteurs, le prolétariat correspond à la classe des sans-réserves, la classe moyenne à la classe recevant un sursalaire et la classe capitaliste à celle élue par la Péréquation du Taux de Profit pour recevoir le taux de profit moyen. Relativement à la définition du prolétariat, notre critique principale consiste à souligner qu’elle évacue ce par quoi le rapport fondamental du mode de production capitaliste se reproduit, c’est-à-dire l’exploitation du travail productif. Après un bref exercice de philologie qui plaira sans doute à une demi-douzaine de germanophiles, Astarian et Ferro suggèrent que nous aurions confondu le travail de subordination et la subordination économique du prolétariat au capital (« Subsumption » contre « Unterordnung », nous rappellent-ils). Notre ignorance des profondeurs de la langue allemande nous aurait interdit de comprendre que la définition d’Astarian et de Ferro s’ancre dans un rapport fondamental entre le prolétariat et le capital, parce que nous aurions compris la subordination strictement comme le « pouvoir des petits chefs »… Lorsque nous disons explicitement que, pour nos auteurs, « le prolétariat regroupe tous les sans-réserves qui subissent la contrainte au travail salarié 42», on ne voit pas comment cela peut ne pas référer à la subordination économique. Astarian et Ferro sont probablement les deux seuls lecteurs qui, face à ce passage, s’imaginent qu’il signifie que les contremaîtres vont chercher les prolétaires dans leurs demeures pour les tirer par l’oreille jusqu’au lieu de travail. Plus encore, lorsque nous expliquons sur plusieurs pages comment la séparation des travailleur·euse·s de leurs moyens de production – cause historique de la subordination économique du prolétariat au capital – est désormais un effet produit structurellement par le procès de production capitaliste43, nous semblons assez loin de « faire du prolétariat un échangiste parmi d’autres 44».
L’accusation d’Astarian et Ferro n’est pas vraiment sérieuse et elle ne confondra personne ayant lu notre revue ; elle sert plutôt à réaffirmer, sans argument nouveau, que la définition du prolétariat comme classe des sans-réserves se fonde également dans les rapports de production capitalistes dans la mesure où ceux-ci dépendent du « monopole de la propriété capitaliste 45». Dans notre deuxième numéro, nous avons suffisamment expliqué en quoi cette approche est erronée : identifier une condition de possibilité des rapports de production (le fait d’être contraint de vendre sa force de travail) ne peut se substituer à l’analyse des places que les agents occupent au sein de ces rapports. Astarian et Ferro n’ont pas jugé bon d’y répondre. Comme nous croyons avoir établi ce qui avait à l’être, nous nous contenterons pour la suite de montrer en quoi les affirmations d’Astarian et Ferro sont incohérentes pour leur propre théorie, puisqu’elles ont pour corollaire des définitions distinctes et incompatibles du concept de prolétariat.
La première définition, qu’on peut trouver dans Le ménage à trois de la lutte des classes par opposition au concept de sursalaire, est celle du prolétariat comme classe des sans-réserves. Ainsi, seraient prolétaires tous ceux et toutes celles dont le niveau de rémunération correspond directement au prix de la reproduction de leur force de travail, ne permettant donc ni surconsommation, ni épargne. C’est contre cette définition que nous nous sommes prononcé·e·s, dans la mesure où Astarian et Ferro utilisent constamment la catégorie de « sans-réserves » et que seule cette définition permet à leur théorie des classes d’être minimalement exhaustive. Si l’on suit rigoureusement cette définition, la place des agents au sein des rapports de production n’importe pas, seul le degré de rémunération compte.
Toutefois, leur texte de réponse insiste sur le caractère soi-disant fondamental de la subordination du prolétariat au capital et elle pose une nuance lorsqu’il est affirmé que « la contrainte au travail et au surtravail ne découle plus, fondamentalement, d’un rapport d’autorité, de pouvoir, mais du dénuement absolu où se trouve le prolétaire s’il ne travaille pas pour le capital 46» (nous soulignons). On voit apparaître une nouvelle condition pour appartenir au prolétariat, à savoir vendre sa force de travail au capital. On pourrait croire que c’est un ajout mineur, mais le résultat est en réalité significatif ; il implique d’exclure du prolétariat l’ensemble des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas employé·e·s par du capital et qui ne gagnent pas de sursalaire. Ainsi, le personnel faiblement rémunéré de la fonction publique se trouverait sans détermination de classe, puisqu’il ne vend pas sa force de travail au capital et qu’il ne gagne pas de sursalaire. Les éducatrices et éducateurs en garderie, les préposé·e·s aux bénéficiaires ou encore les concierges des bâtiments de la fonction publique ne sont que quelques exemples d’agents du mode de production qui n’entrent dans aucune des classes selon cette définition, implicite dans la réponse d’Astarian et Ferro. Il faudrait donc identifier clairement ce qui détermine l’appartenance de classe de ces agents, comment ceux-ci participent à la reproduction du mode de production capitaliste et quels liens ils entretiennent avec le prolétariat et la classe de l’encadrement s’ils n’appartiennent à aucune de ces classes. C’est notamment pour saisir la place d’une partie de ces agents que nous nous sommes penché·e·s sur la division sexuelle du travail qui explique la surreprésentation des femmes au sein de ces métiers qui, selon nous, appartiennent aux couches subordonnées de la classe moyenne. Il est dommage qu’Astarian et Ferro n’aient pu y voir qu’une trace d’un « néo-féminisme » (nous sommes loin d’y voir une insulte), alors qu’ils auraient pu y trouver des outils utiles pour corriger l’incohérence de leur propre théorie des classes.
Un autre flou plane sur leur définition du prolétariat lorsqu’on s’intéresse à la théorie du travail productif d’Astarian. Rappelons brièvement que celui-ci définit le travail productif comme celui qui produit une marchandise dont la valeur d’usage peut être réintégrée à la sphère productive, soit comme moyen de production, soit comme moyen de consommation du prolétariat. Mais ici, de quel prolétariat s’agit-il? Évidemment, les sans-réserves qui ne sont pas employé·e·s par le capital ne peuvent pas être concerné·e·s, puisque leur travail ne devient pas facteur du capital pour la simple et bonne raison que ce n’est pas du capital qui achète leur force de travail. En ce sens, lorsqu’Astarian indique que les marchandises entrant dans la consommation du prolétariat sont le fruit d’un travail productif, il ne parle pas des sans-réserves au sens large, mais bien d’un autre prolétariat dont la définition reste à expliciter. On comprend néanmoins pourquoi Astarian laisse cette affaire de côté, car s’il abordait cette question, il mettrait à nue un des multiples problèmes de sa théorie du travail productif, à savoir la difficulté qu’il y a à distinguer les marchandises qui entrent dans la consommation du prolétariat de celles qui entrent dans la consommation des autres classes sociales. Dit autrement, les sans-réserves consomment le même type de marchandises, mais ce ne sont pas tous les sans-réserves qui sont employé·e·s par du capital. Cela implique que pour une même marchandise, Astarian devrait admettre qu’elle est, en avant-midi, le fruit d’un travail productif et, en après-midi, celui d’un travail improductif.
On le voit, Astarian et Ferro sont pris avec un problème d’exhaustivité parce qu’ils veulent préserver l’illusion que leur définition du prolétariat a un lien avec la contradiction que cette classe entretient avec le capital alors qu’elle s’intéresse strictement au niveau de rémunération. Bien qu’une telle alternative leur soit désagréable, il leur faut nécessairement choisir : soit la subordination économique du prolétariat au capital n’est pas un critère pertinent et le prolétariat est effectivement la classe des sans-réserves qu’on peut identifier par un simple coup d’œil sur un chèque de paye ou un rapport d’impôt, soit le prolétariat est la classe contrainte de vendre sa force de travail au capital et une bonne partie des agents du mode de production capitaliste n’ont aucune détermination de classe. De notre côté, la réponse est claire : le prolétariat est la classe qui subit l’exploitation spécifiquement capitaliste par la production de plus-value; ce qui implique que pour appartenir à cette classe il faut 1) être employé·e par du capital 2) participer à la production d’une marchandise et 3) être exploité·e (donc produire non seulement de la valeur, mais de la plus-value)
Notes
[1] Astarian, Bruno et Robert Ferro. Travail productif, question féminine et autres problèmes fâcheux. Réponse à « Temps Libre », 2021, section 2.2.
[2] Cf. La sous-section « Procès de circulation et travail productif ». Temps Libre, n. 2, 2021, pp. 72-83.
[3] Ibid., pp. 77-78. « [Les profits du capital commercial viennent] du fait qu’ils achètent au capital productif les marchandises en deçà de leurs valeurs, parce qu’ils dispensent le capital productif des tâches propres à la circulation – ce qui permet à ce dernier de convertir plus rapidement ses marchandises en argent et, ainsi, de diminuer le temps de rotation de son capital. Dit autrement, le capital productif verse au capital commercial une part de la plus-value qu’il a lui-même extorquée à ses prolétaires, parce que le capital commercial lui permet de réinvestir plus rapidement pour reproduire et élargir sa production. »
[4] Cf. Temps Libre, n. 2, pp. 73-77.
[5] Il faut par ailleurs noter que nous ne limitons pas l’emploi du travail improductif au capital improductif. Ainsi, lorsque nous décrivons le travail de subordination qui s’effectue au sein du procès de production proprement capitaliste, nous prenons soin d’expliquer comment le capital productif utilise une partie de son capital de façon improductive afin de faire régner sa volonté directrice sur les lieux de travail : « Il faut […] mobiliser certaines personnes afin qu’elles dédient une partie de leur temps à des tâches improductives liées à la discipline de la force de travail ». Ibid., p. 96.
[6] Astarian, L’abolition de la valeur, Entremonde, 2017, p. 153.
[7] Ibid., p. 156.
[8] Marx, Un chapitre inédit du Capital, UGE, 1971, p. 228. « Les marchandises que le capitaliste achète en raison de leur valeur d’usage pour sa consommation privée ne sont pas employées productivement et ne deviennent pas des facteurs du capital. Il en est de même des services qu’il achète volontairement ou par la force des choses (services fournis par l’État, etc.). Ce ne sont pas des travaux productifs, et ceux qui les effectuent ne sont pas des travailleurs productifs. »
[9] Astarian, op. cit. p. 157
[10] Ibid.
[11] Ibid.,p. 158.
[12] Astarian et Ferro, op. cit., section 2.2.
[13] En réalité, Astarian va beaucoup plus loin, puisque pour lui, ce n’est pas uniquement le profit des entreprises du luxe et de l’armement qui provient du pool de la plus-value globale, mais bel et bien tout leur capital : c + v + pl, tous ces éléments sont directement financés à même la plus-value du secteur productif. Cf. Astarian, op. cit., p. 170.
[14] Dans le segment sur « La formation du secteur improductif », Astarian cherche à prouver l’existence de ce type d’entreprises en s’appuyant sur le fait qu’elles seules permettent la conversion complexe de la plus-value en revenu pour les capitalistes. Puisque pour lui, le secteur productif produit, « par définition » , uniquement des marchandises devant fonctionner comme facteurs du capital, une petite partie seulement de celles-ci peut être directement convertie en moyen de consommation pour la classe capitaliste. En effet, les capitalistes veulent consommer autre chose que du beurre d’arachide et des conserves, nommément des marchandises de luxe spécifiques qui nécessitent une production spécifique. Il faut donc qu’une partie de la plus-value soit matériellement convertie en de telles marchandises. Or celles-ci ne peuvent l’être (par hypothèse) que par l’intermédiaire de capitaux et du travail improductifs spécifiquement destinés à cette fin. Cette conversion indirecte, Astarian la nomme conversion complexe. La plus-value que la classe capitaliste se destine à elle-même ne peut donc être totalement réalisée sans ce secteur improductif : voilà fondée la nécessité d’un secteur improductif parmi les entreprises productrices de marchandises! Malheureusement, cela ne prouve rien, puisqu’une telle conséquence était déjà présente dans la prémisse suivant laquelle « le secteur productif, par définition, ne produit que des facteurs du capital ». Ce qu’il faut prouver, c’est précisément que le secteur productif n’englobe que la production de facteurs du capital. Comme nous le verrons, Astarian n’y parvient pas. Cf. Astarian, ibid., p. 163.
[15] Ibid., p. 161. « La question est donc la suivante : si ce ne sont pas les salariés du secteur improductif qui ont créé la valeur de l’investissement et du profit que le banquier en retire, d’où vient cette valeur ? La réponse est: du secteur productif. Ce n’est pas le lieu de dire ici comment la plus-value se répartit sur l’ensemble des capitaux dans la péréquation du taux de profit. »
[16] Ibid. p. 162.
[17] Ibid. Comme cela est sous-entendu dans ce passage : « en raison de leur valeur d’utilité propre, les mêmes marchandises peuvent retourner au secteur productif ou en sortir et être utilisées de façon improductive. Chaque fois que le retour dans la sphère productive ne se fait pas mais est remplacé par un usage dans la sphère de la circulation, nous disons qu’une partie de la plus-value produite est stérilisée pour les besoins de cette circulation. »
[18] Ibid., pp. 171-172.
[19] Le Capital, livre 1, t. I, Éd. Sociales, 1978, pp. 184-185. Cette possibilité générale était déjà signalée par Marx : « Un produit qui déjà existe sous une forme qui le rend propre à la consommation peut cependant devenir à son tour matière première d’un autre produit ; le raisin est la matière première du vin. (…) On le voit : le caractère d’un produit, de matière première ou de moyen de travail ne s’attache à une valeur d’usage que suivant la position déterminée qu’elle remplit dans le procès de travail, que d’après la place qu’elle y occupe, et son changement de place change sa détermination. » (Nous soulignons).
[20] Pew Research Center, « America’s Complex Relationship With Guns », juin 2017. Environ 30 % de la population étatsunienne possède une arme à feu. Parmi les personnes blanches – qui sont les plus nombreuses à posséder une arme à feu –, cette proportion atteint 40 % pour celles qui possèdent au plus un diplôme du secondaire (high school diploma) contre 20 % des bacheliers (graduates students). Bien que les chercheur·euse·s aient fait le choix de ne pas ventiler leurs résultats selon le revenu, de tels chiffres ne peuvent manquer d’indiquer que les armes à feu entrent bel et bien dans la panier de subsistance des sans-réserves – à tout le moins dans celui des sans-réserves provenant de régions rurales.
[21] D’ailleurs, comme Astarian s’en rend lui-même compte, un salaire plus élevé ne garantit pas nécessairement une consommation en tout point qualitativement différente.
[22] Temps libre, n. 2, pp. 61-67.
[23] Marx, Théories sur la plus-value, t. 1, Éd. Sociales, 1974, p. 176.
[24] Ibid., p. 168.
[25] Ibid., pp. 467-468.
[26] Ibid., p. 42.
[27] Astarian, op. cit., p. 158.
[28] Ibid., p. 175.
[29] Marx, op. cit., p. 475. Dans ce passage et les précédents, le « je » réfère à un capitaliste qui emploie des travaux productifs ou improductifs.
[30] Marx, Un chapitre inédit du capital, p. 143 « Le procès de travail lui-même n’est toutefois que le moyen du procès de valorisation, tout comme la valeur d’usage du produit n’est que le support de sa valeur d’échange. L’auto-valorisation du capital, création de plus-value est donc l’âme, le but et l’obsession du capitaliste, l’impulsion et le contenu absolus de son action ».. (Les italiques sont de Marx).
[31] Notions qui ne sont pas elles-mêmes sans poser problème. Cf. Supra.
[32] Astarian et Ferro, op. cit., p. 3.
[33] Pour l’anecdote, voici comment se composaient les conseils d’administration des entreprises qui étaient, en 1975, parmi les plus grandes compagnies d’aéronautique du Canada : « on retrouve au poste de président de la Pratt & Whitney, Thor Stephenson ex-ingénieur du Ministère de la Défense nationale canadienne ; à ses côtés, l’ex-maréchal de l’Air canadien F.R. Miller ; à la vice-présidence, James Ferguson, vétéran de la deuxième guerre mondiale et de la guerre de Corée. Ces administrateurs sont secondés par T.M. Ford, avocat attaché à la CIA de 1952 à 1955 et M.R. Bissel, ex-assistant-directeur de la CIA de 1949 à 1953. On retrouve à la Canadair, T. Rodgie McLogan de la Canadian Steamship Lines, propriété de Power Corporation et liée à la Banque royale du Canada ; J. Geoffroy Notman, de la Banque canadienne impériale de commerce ainsi que R.H. Winter, directeur de l’Alcan. Au conseil d’administration de C.A.E. Industrie : H. Benson, président de Benson limitée, G. Drummund Birks, président d’Henry Birks & Sons et P.D. Curry, présent de Power Corporation of Canada ainsi que P. Côté, président de Laiterie Laval. » Lefebvre, « L’industrie du matériel de transport au Québec », dans Fournier, Le capitalisme au Québec, Éd. Coopératives Albert St-Martin, 1978, p. 423.
[34] Cf. Guérin, Fascisme et grand capital. Maspero, 1965, ch. 1 « Les bailleurs de fonds », pp. 17-38.
[35] Sweezy et Baran, Le capitalisme monopoliste, Maspero, 1970, pp. 192-193. Citant un article du New York Times daté du 14 juin 1962, on pouvait y voir que la « loi de finance militaire, qui est la plus importante de l’histoire américaine en temps de paix, fût approuvée (par le sénat) par un vote de 88 à 0. »
[36] Ibid., p. 163. « En 1939 par exemple, 17,2 % de la force de travail était en chômage et l’on peut estimer, grosso-modo à 1,4 % de cette force le potentiel ouvrier travaillant à la production de biens et services destinés aux militaires. En d’autres termes, plus de 18 % de la force de travail était en chômage, ou bien dépendait des dépenses militaires. En 1961, (qui, comme 1939, est une année de reprise faisant suite à une récession cyclique), les chiffres comparables étaient de 6,7 % pour les chômeurs et de 9,4 % pour ceux dont le travail dépendait de la dépense militaire, soit un total de 16 %. Il serait possible de détailler et d’améliorer ces calculs mais nous n’avons aucune raison de croire que cela modifierait la conclusion générale : le pourcentage de la force de travail inemployée, joint à celui de la force de travail dépendante des dépenses militaires était à peu de chose près le même en 1961 et en 1939. Il s’ensuit que si le budget militaire était ramené à ses proportions de 1939, le chômage retrouverait lui aussi son volume de cette année là. »
[37] Ibid., pp. 212, 218 et 222. L’utilisation de la capacité productive nationale en 1939 était, sur un indice de 100, de 72 pour un taux de chômage de 17,2 %, contre 80 en 1961, avec un taux de chômage de 9,4 %. Or, le taux de profit d’une entreprise est, toute chose étant égale par ailleurs, en rapport direct avec le taux d’utilisation de ses capacités productives (cf. p. 88). Évidemment, les transformations graduelles de la nature des marchandises achetées par l’armée (passage d’une « quincaillerie » militaire produite en masse à des dépenses consacrées « à la recherche et au développement, au génie, au contrôle et à l’entretien ») tend à réduire la capacité « stimulante » des commandes militaires sur la production, étant donné que ces transformations ont pour effet de limiter la demande de force de travail.
[38] Astarian, op. cit., p. 134.
[39] Ibid., p. 109.
[40] Ibid., p. 110.
[41] Ibid., p. 112. (Nous soulignons).
[42] Temps Libre, n. 2, p. 163.
[43] Ibid., p. 15-19.
[44] Astarian et Ferro, Réponse à « Temps Libre », section 2.2.
[44] Astarian et Ferro, op. cit. « la subordination n’est pas une problématique contingente et indépendante de la contradiction travail nécessaire/surtravail. C’est sa condition d’existence fondamentale du point de vue du prolétariat – classe des travailleurs « libres » et « libérés » de tout. »
[46] Astarian, op. cit., p. 175. On peut aussi identifier un passage qui pointe en ce sens dans L’Abolition de la valeur où Astarian dit : « la subordination du travail au capital soumet tout le prolétariat aux mêmes formes de la contrainte au travail ».
Temps Libre II en librairie
Contribution à la théorie des classes est désormais disponible dans certaines librairies au Québec et en France.
Montréal :
Québec
Marseille :
Lyon :
Paris :
- Librairie Le Point du Jour
- Librairie Petite Égypte
- Librairie Parallèles
Temps Libre II maintenant disponible en ligne
La version imprimée est présentement sous presse. Bientôt disponible aux bonnes adresses.